
Business classe

Le magasin est posé là, au numéro 36 de Dover Street, l’une des artères les plus snobs de Londres. Une Porsche grise est garée juste devant, une Bentley est en approche. Sur la vitrine s’étale un bouquet de fleurs géant, conçu par Andy Hillman, l’homme que les marques s’en vont chercher quand elles veulent donner à leur devanture un air d’œuvre d’art. Les portes s’ouvrent automatiquement sur un immense espace en béton. À l’intérieur de la boutique, une nouvelle fleur, en silicone, court le long d’un grand escalier. Suspendus à des racks, le long de murs gris, des vêtements hors de prix –compter 800 euros pour certains t-shirts– sont protégés par des vendeurs habillés de noir et blanc, mains dans le dos, sourire figé, cheveux laqués. On appelle ça la mode.
Ici, dans le tout premier magasin de la marque qui porte son nom, inauguré en septembre 2014, Victoria Beckham a tout pensé elle-même. “C’est elle qui a pris chaque décision, raconte un collaborateur, impliqué dans l’aménagement de la boutique. Si les tapis sont gris dans la cabine d’essayage, c’est parce qu’elle trouve que c’est la couleur qui met le plus en valeur quand on essaie une fringue. Si les cintres sont rigides et ne tournent pas sur eux-mêmes, c’est parce qu’elle trouve que c’est plus chic comme ça. Et ainsi de suite.” Pendant les longs mois de travaux, supervisés par l’architecte Farshid Moussavi, Victoria est passée chaque semaine sur le chantier. Souvent le jeudi. En fin de journée. Au moment de regagner la maison familiale de Holland Park, située à vingt minutes de voiture. “Les ouvriers étaient surpris de la voir débarquer les premières fois, et puis c’est devenu la routine. À chaque fois qu’elle devait mettre un casque pour aller visiter le chantier, elle faisait la même blague. Elle disait: ‘Oh non, je viens juste de faire mon brushing!’ Et tout le monde rigolait, surtout elle.”
Elle peut se le permettre. Son magasin, planté juste en face du temple de la mode Dover Street Market, raconte son ascension dans le milieu. Les chiffres complètent le tableau. Cinq ans seulement après la création de la marque, son chiffre d’affaires annuel atteint les 50 millions d’euros et son nombre de salariés dépasse allégrement la centaine. En pourcentage, c’est plus vertigineux encore. Les ventes de la marque ont progressé de 2 900% ces trois dernières années. Les effectifs de 3 233%. Fin 2014, ces résultats ont même valu à Victoria Beckham d’être élue “entrepreneur de l’année” en Angleterre par le très sérieux magazine Management. Juste devant Amit et Meeta Patel, patrons d’un énorme laboratoire pharmaceutique. Mais la vraie reconnaissance est ailleurs. À chacun de ses défilés, désormais, Anna Wintour, la patronne du Vogue US, celle qui n’aime jamais rien, s’assoit à côté de David –et des gosses, quand ils n’ont pas école. Et elle sourit. Aussi incroyable que cela puisse paraître.
Entre gros son hip-hop et lunettes de mouche
Victoria, pourtant, partait de loin. “Pendant des années, disait-elle l’an dernier au Guardian, j’ai été l’objet de moqueries… Je sais qu’on rigolait de moi.” De quoi rigolait-on au juste? De son manque criant de classe, de son corps squelettique, de ses seins refaits pointant sous des t-shirts trop moulants et des aventures extra-conjugales supposées de son mari footballeur, David. On rigolait surtout de ses “talents” de chanteuse. “J’ai toujours été démoralisée d’entendre dire que j’étais la plus inutile, la seule Spice Girl à avoir moins de talent qu’une noix de coco”, écrivait-elle dans son autobiographie en 2001. Quand les Spice Girls ont cessé d’émettre, Victoria a tenté de convaincre en solo. En 2001 toujours, est donc sorti son premier album. Le premier single a marché. Pas le suivant. L’album s’est avéré un échec. “C’est vrai que tout le monde a été déçu par les ventes, confirme le producteur Steve Kipner, qui l’aida à composer trois titres. Mais le label avait des problèmes, il n’a pas tout fait à l’époque pour attirer l’attention des radios…” Victoria s’est entêtée. Elle a signé un contrat avec le label Telstar Records. Elle s’est attaché les services du producteur Damon Dash pour se trouver un nouveau son. Plus hip-hop. Puis elle s’est enfermée en studio pendant des mois. Mais, entre embrouilles et vocalises imparfaites, l’album ne sortira jamais. Damon Dash conclura même l’épisode dans un claquement de porte: “Si j’avais réussi à rendre cette nana hot, j’aurais pu rendre n’importe quelle nana hot.”




À l’époque, l’ancienne popstar déprime un peu: “Les gens continuent de dire que je suis une incapable et ça me frustre, écrit-elle alors. Je ne veux pas la notoriété pour la notoriété. Je veux être célèbre pour ce que je fais de mieux.” Entre 1999 et 2005 naissent Brooklyn, Romeo et Cruz (Harper naîtra plus tard, en 2011). Victoria devient alors soccer mum. Mais n’oublie pas les apparences. “Elle a toujours été obnubilée par l’image qu’elle projetait, et donc par les vêtements, raconte Richard Jones, promoteur et organisateur de la tournée mondiale des Spice Girls. La mode a toujours été sa grande passion.” Victoria dépense donc sans compter, et se montre. Dans les soirées, les défilés, les dîners, elle pose. Sourire crispé. Lunettes de mouche. Cheveux effilés. La mode pouffe. Avec méchanceté. L’attachée de presse d’une grande maison française se souvient même qu’elle tenta un jour de joindre le management de l’Anglaise pour la convaincre de ne plus porter publiquement les vêtements de la marque: “La consigne venait d’en haut, on considérait que ce n’était pas bon pour nous que Victoria Beckham s’affiche dans nos vêtements. Même si elle les avait achetés elle-même…” Les coups de fil resteront sans réponse.
“Je ne veux pas la notoriété pour la notoriété. Je veux être célèbre pour ce que je fais de mieux”
Victoria Beckham
Mais la passion de Victoria pour la mode suscite aussi des intérêts. En l’espace de quelques mois, des marques de jeans (Rock & Republic), de lunettes de soleil (Linda Farrow) et de parfum (Coty) proposent à l’Anglaise de créer des lignes à son nom. Le label japonais Samantha Thavasa, spécialisé dans les collaborations avec des célébrités à destination d’une clientèle jeune, la fait également travailler. Quelque temps après avoir sollicité Paris Hilton. Victoria est au même niveau que l’héritière: une égérie approchable pour marques commerciales. Mais elle serre les dents. Elle s’implique. Elle bosse. Un jour, en 2006, elle se retrouve dans une suite de l’hôtel Costes, à Paris, pour présenter la collection de lunettes de soleil qu’elle a dessinée pour Linda Farrow. Elle doit simplement glisser quelques mots. Mais elle fait beaucoup mieux que ça. “Elle était hyper impliquée, très pro, se souvient Sarah, patronne du magasin Colette. En fait, elle faisait un véritable travail de vendeuse.” Dans la foulée, le créateur Marc Jacobs, spécialiste dans la réhabilitation d’icônes has been, lui teint les cheveux en rose et la fourre dans un énorme shopping bag pour une campagne publicitaire. L’image restera culte. Au moins auprès des amateurs de shopping bags.
Dans un bureau sans fenêtre
L’idée de monter sa propre marque naît à ce moment-là. “J’ai adoré collaborer avec toutes ces enseignes, racontait encore Victoria au Guardian. J’ai beaucoup appris comme ça, notamment ce qu’il ne fallait pas faire. En arrêtant de travailler avec elles, j’ai renoncé à beaucoup d’argent. Mais il fallait que je me lance.” Les contours de la marque sont posés début 2007, dans les bureaux de l’agence 19 Entertainment, celle de Simon Fuller, l’homme qui a fait les Spice Girls, un homme de flair, un prédateur. Victoria lui fait confiance. Avec lui, au fil des ans, elle a appris que “pour survivre dans le business comme dans la savane africaine, il faut être impitoyable”. Contre un tiers de la marque en création, Fuller garantit son soutien financier absolu à Victoria. Il lui donne aussi un minuscule bureau, au rez-de-chaussée de l’agence, au bord de la Tamise. Il n’y a pas de fenêtre aux murs. Mais il y a des souvenirs. Quinze ans plus tôt, les Spice Girls débarquaient dans ce même bureau pour se faire recruter par l’agent providentiel.
Simon Fuller, qui gère également les intérêts de David Beckham, Jennifer Lopez, Bradley Wiggins ou encore Andy Murray, aide Victoria à structurer sa future marque. L’avocat de Fuller, Zach Duane, est détaché pour la paperasse. La dénommée Melanie Clark est recrutée pour assister Victoria au design. Tracy Lowe se charge de la production. Les trois femmes s’activent dans leur coin de bureau, pendant des mois. La première collection est finalement prête en septembre 2008. Elle tient sur un simple rack. Dix modèles. Une poignée de couleurs. L’esthétique est épurée. Elle ressemble au style qu’affiche désormais la chanteuse: jupes sculpturales s’arrêtant aux mollets et tailles hautes. Pour montrer sa collection, Victoria organise des rendez-vous privés avec les acheteurs et la presse. Cela se passe au Waldorf-Astoria Hotel, sur Park Avenue, à New York, dans une suite royale, pendant la Fashion Week. David est à Los Angeles avec les enfants. Journalistes et acheteurs se succèdent sur la moquette à fleurs. Le premier jour des présentations, Victoria porte une jupe noire issue de la collection et des talons vertigineux. Un acheteur d’une boutique de Tokyo se souvient: “Victoria était, comme tous les jeunes créateurs qui montrent leur collection, nerveuse. Elle montrait les pièces une à une, elle même. On sentait du stress. Mais elle essayait de faire comme si tout était normal.”




Victoria Beckham se sait attendue. D’autres célébrités ont tenté de lancer leur collection avant elle. Beaucoup se sont fait descendre. Mais la réaction est cette fois unanimement positive. Dans The Times, la journaliste de mode Lisa Armstrong se surprend elle-même: “Je n’arrive pas à croire que j’écris cela. Mais cette première collection était un sans-faute.” Pourtant, l’affaire n’est pas encore gagnée. Quand la collection arrive dans les neuf boutiques que Victoria a fini par retenir parmi toutes celles qui se sont manifestées pour passer commande, les clients sont sceptiques. “Dans certains pays, il fallait que nous soyons extrêmement malins pour faire oublier aux clients le nom de la marque et le nom de Victoria, se rappelle Zach Duane, devenu directeur exécutif de la marque. Certains vendeurs dans les boutiques retiraient même les étiquettes des robes et proposaient aux clientes de les essayer sans rien leur dire. Les clientes essayaient, se trouvaient magnifiques et demandaient le nom de la marque. Alors le vendeur donnait le nom de Victoria.”
Rumeurs de copie et canard boiteux
Les préjugés ne s’arrêtent pas là. La rumeur court que cette première collection n’a pas été dessinée par Victoria elle-même. Elle ressemble beaucoup aux collections du Français Roland Mouret. Dont l’agent n’est autre que… Simon Fuller. Le rapprochement est vite fait. Victoria doit se justifier. Elle admet connaître Roland. Aimer ses créations. Les porter régulièrement. Lui avoir parlé de sa propre collection. Mais elle dément son implication directe dans la création. “Il n’y avait pas d’équipe de design cachée, j’étais là à toutes les étapes, confie-t-elle alors. Roland n’a absolument pas aidé au design, il m’a simplement conseillée de recruter Melanie, une ancienne de chez lui, pour m’aider.” L’intéressé confirmera cette version: “Oui, je lui ai donné des conseils, des noms. C’est tout, rien de plus.” Cinq ans plus tard, les doutes sont dissipés. Victoria Beckham a diversifié son offre à un point tel que les rapprochements sont devenus totalement vains. Et que même Karl Lagerfeld se prosterne. À sa façon. “C’est pas mal du tout ce qu’elle fait.”
“Ce qui motive Victoria Beckham aujourd’hui? La peur, l’insécurité”
Zach Duane, directeur exécutif de sa marque
La suite? Des ouvertures de boutiques. Plein de boutiques. Le développement de la marque passe par là. Il passera aussi bientôt par un déménagement. Les anciens bureaux de Simon Fuller, désormais entièrement squattés, sont devenus trop petits pour accueillir tout le monde. Et ce, malgré l’ouverture d’un bureau permanent l’an dernier à New York. Ce qui motive Victoria Beckham aujourd’hui? “Je pense que c’est la peur, l’insécurité, répond Zach Duane. C’est toujours ce qui pousse les gens célèbres et qui ont réussi à avancer encore. Victoria est toujours la première à admettre qu’elle s’est longtemps sentie considérée comme un canard boiteux, et elle a eu envie que cela change. Elle a eu du succès en tant qu’artiste, elle a gagné beaucoup d’argent, elle a épousé le sportif le plus célèbre du monde, elle aurait pu dire ‘stop, je vais me reposer’. Mais elle ne l’a pas fait.” Victoria Beckham n’est pas de celles qui abandonnent facilement. À l’école, elle était loin d’être la meilleure. Pareil en cours de danse. Le casting des Spice Girls aurait également pu lui échapper. Cela s’est joué à rien. “Rien n’a jamais été facile pour moi. Je n’attends pas que les choses se passent. Je vais les chercher. Je n’attends pas qu’on m’appelle. Je prends le téléphone moi-même, j’appelle et je harcèle les gens. Les choses finissent toujours par arriver.” Surtout sur Dover Street.
Society #1


Tinder Délice

“C’est lorsqu’on habite dans la case que l’on sait où sont les fuites d’eau”

Le bateau ivre

Bombes à retardement

L’art et le pyromane

“Le jihadiste n'est pas quelqu'un qui crie fort”

Le pays où le karaoké tue
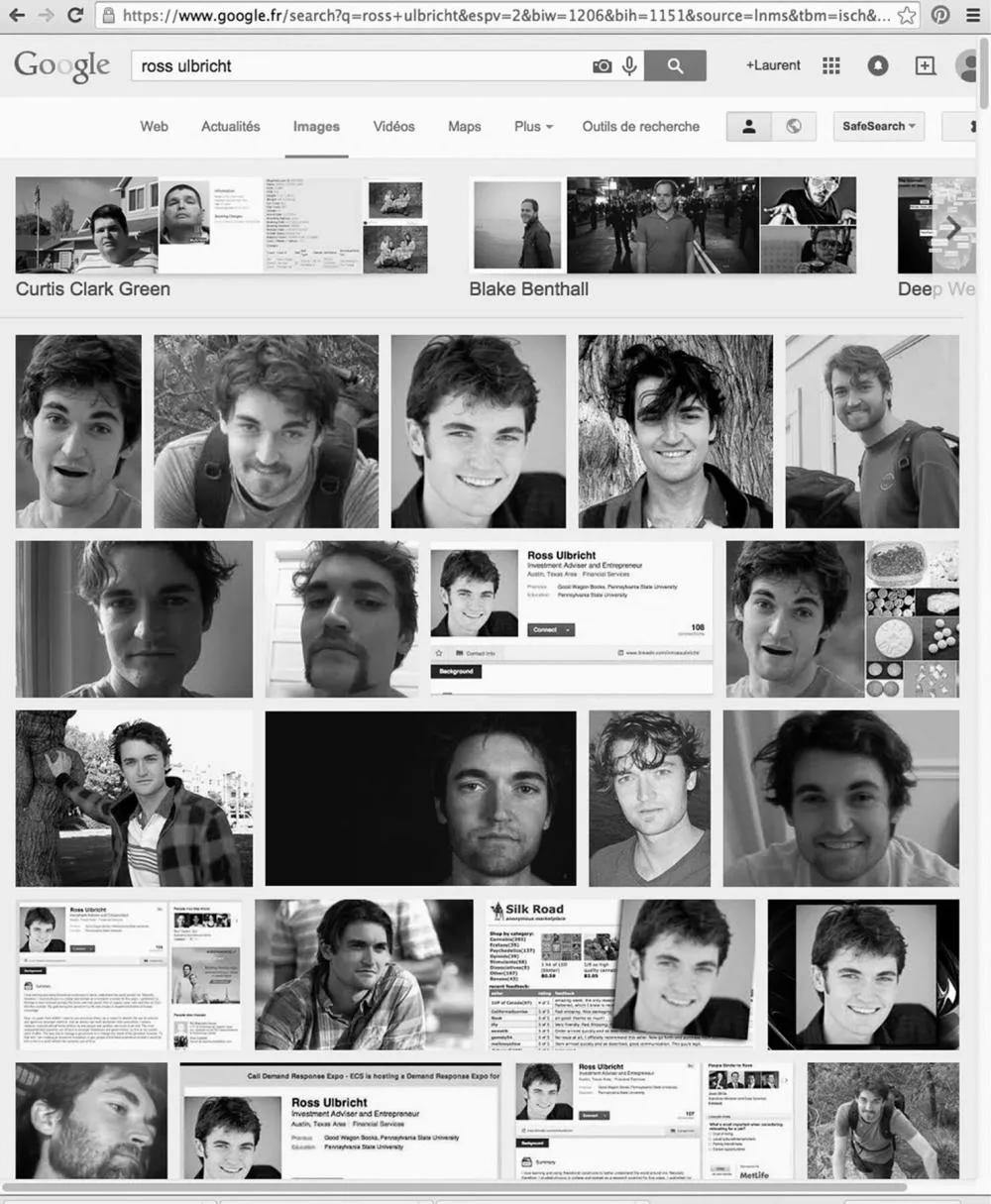
L’ennemi public N° 2.0

“Cela n’a pas besoin d’être propre”
À lire aussi

Crash
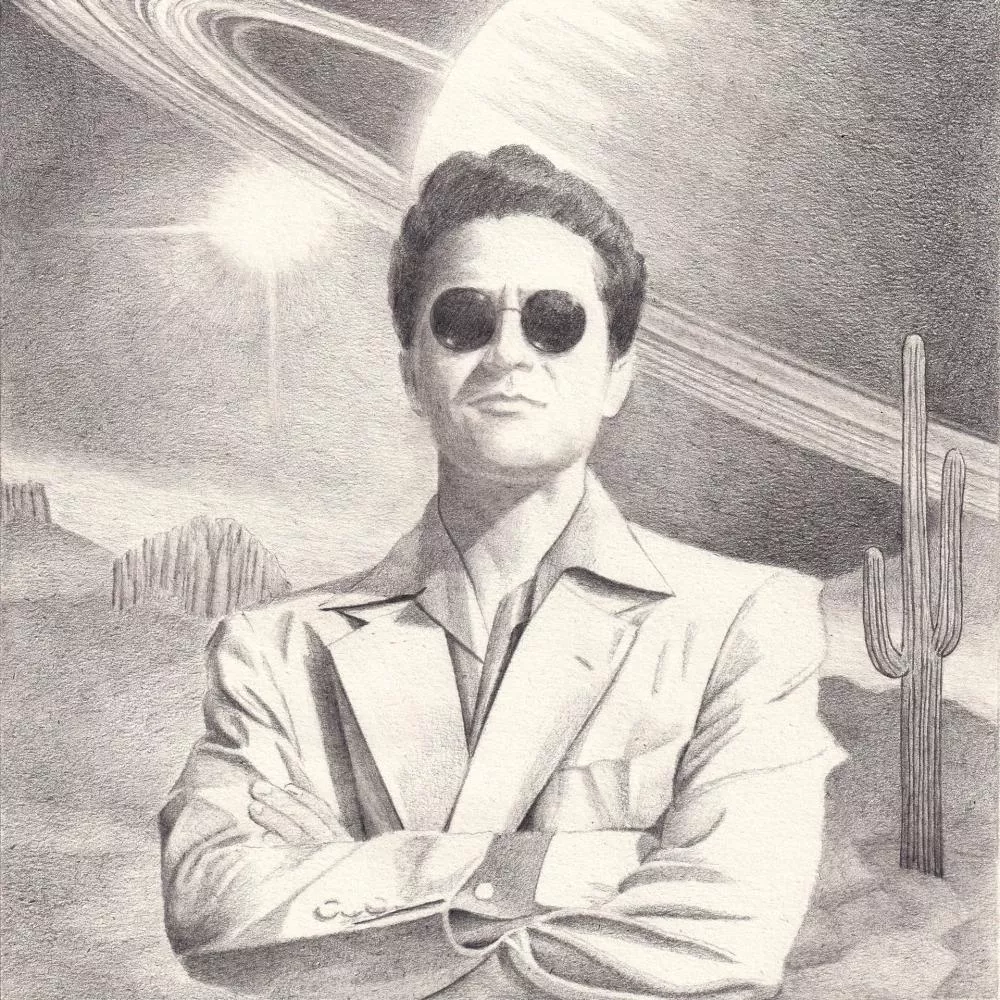
Le gourou et ses femmes disparues
