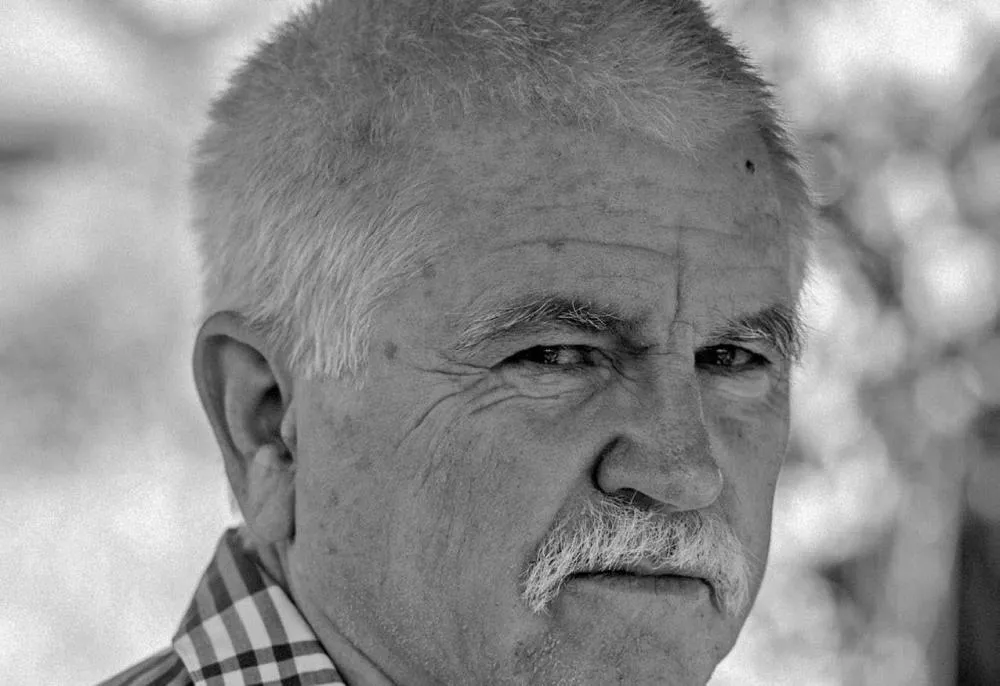
“C'est pas pour autant qu'on a la peste”

C’est un TGV du vendredi, l’un de ceux remplis de “city breakers ” qui profitent de la grande vitesse pour se rendre à Milan depuis Paris, en sept heures. Ce n’est ni rapide ni donné, juste une autre expérience que les vols low cost qui atterrissent sur des pistes d’aéroport situées à 80 kilomètres de l’endroit que l’on est censé(e) rejoindre. Nous sommes le 6 mars, et cela fait plusieurs semaines que la Lombardie tente de limiter l’expansion du coronavirus et se barricade progressivement du reste du monde. Le train est aux trois quarts vide au départ de la gare de Lyon. Comme si, dans la tête des Français, l’Italie était le coronavirus. “Cela fait dix jours que c’est comme ça”, soupire le “barista” en disposant les boissons sur le comptoir du wagon-restaurant rebaptisé “Caffè centrale”, pour faire italien. Les employés de Newrest, le prestataire de la SNCF pour la restauration à bord, descendent désormais en gare de Modane, la dernière halte française avant le passage de la frontière. Une mesure prise le 25 février par la direction, pour ne pas exposer les salariés au risque d’infection. Le train quitte Paris. Les Italiens portent un masque, les Français font comme s’ils n’en voyaient pas l’utilité. Les statistiques disent alors: 3 000 cas d’un côté des Alpes, moins de 500 de l’autre. L’Italie, depuis le début, est le pays le plus touché d’Europe. Mais l’existence normale fait encore illusion. Les quelques Français présents dans le TGV partent faire du ski en famille, sans avoir le sentiment de risquer leur vie dans une zone contaminée. Ce n’est pas -encore- le retour du Dernier Train pour Busan, le film d’horreur coréen où un virus inconnu infecte progressivement tout un train.
Dossier coronavirus
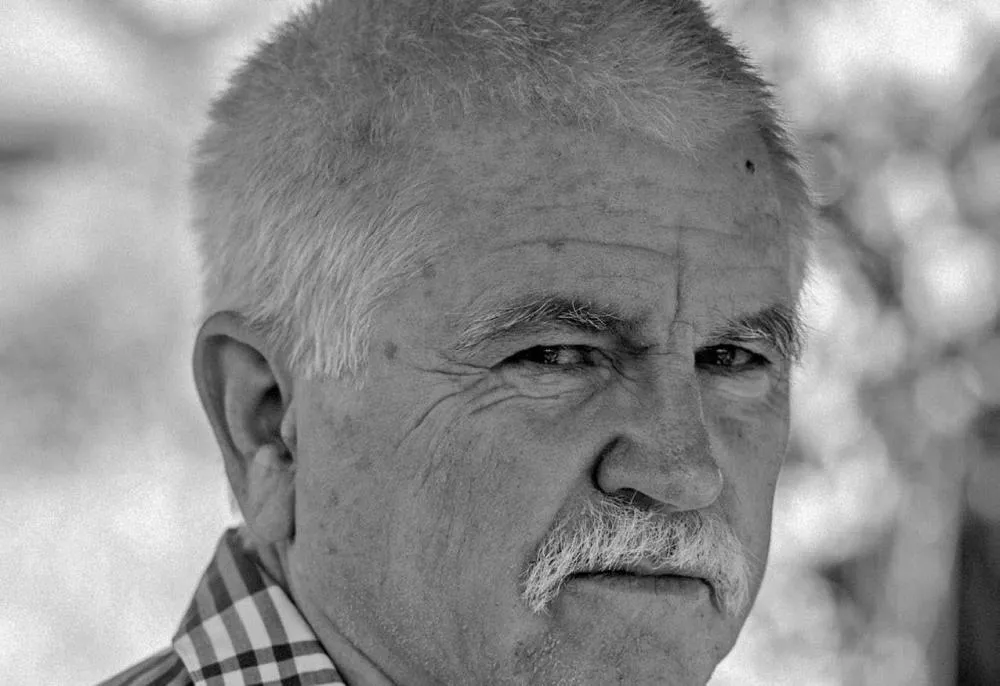

Quand la bise fut partie

David Quammen et le virus maudit

Le care confidentiel

Le zéro et l'infini

Leurs enfants après eux

L'Île aux morts

“On savait quand on partait, pas quand on allait revenir”

“Ces épidémies sont un miroir dans lequel l'humanité voit son propre reflet”

La revanche du pangolin
Society #127

“Ces épidémies sont un miroir dans lequel l'humanité voit son propre reflet”

La revanche du pangolin
À lire aussi

Les voix de Naples

La valse des mineurs
