“Je te jure, quand il a descendu les marches pour Tennessee, j’ai chialé. J’ai chialé comme une madeleine.” Au-delà de la vapeur des cafés et de la fumée des cigarettes symptomatiques des lendemains de soirée, la salle de l’AccorHotels Arena s’élève non loin derrière la véranda. La veille au soir, les quatre membres de Last Train s’y produisaient devant une bonne douzaine de milliers de personnes, ouvrant la soirée pour Johnny Hallyday et devenant au passage les plus jeunes musiciens français de l’histoire de la salle. Pas transformés pour autant, Jean-Noël, Julien, Antoine et Tim chantonnent Marie et se demandent si Johnny abandonne vraiment une paire de Ray-Ban par soir. “Je lui ai dit bonjour”, précise Jean-Noël, 21 ans. On a eu genre une conversation d’une minute. Il a dit: ‘Bienvenue chez nous.’ Mais mec, c’est Bercy, c’est pas chez toi!” Le verdict est unanime: “C’était assez dingue.” “En fait, ça fait deux mois qu’on sait qu’on va faire la première partie de Johnny. Depuis deux mois, on se dit à chaque concert ‘allez, c’est Bercy ce soir!’ alors qu’on joue dans des bleds pourris, on est là genre: ‘Alors, il est où Johnny?’ Sauf qu’hier, il était là.”
“Julien, il savait pas jouer de la guitare. Peut-être qu’il sait toujours pas”
Il y a dix ans, dans un village “pas super sexy” en Alsace, les garçons ont 11 ans, vont à l’école avec des cartables de sixième, s’intéressent parfois au foot, ont une enfance “commune”. Autour, c’est la campagne, les champs. Parfois, ils vont acheter des t-shirts au H&M de Mulhouse. Plus tard, ils pousseront jusqu’à Strasbourg pour des concerts à La Laiterie. Surtout, entre les premiers cours d’anglais et la vie de famille dans la campagne du Nord, on cherche à s’occuper. Jean-Noël joue de la guitare dans sa chambre, Antoine de la batterie dans la sienne. Le premier se souvient: “J’ai dû dire ‘bon ben je viens chez toi’, ensuite on a invité Julien à venir jouer avec nous. Sauf que Julien, il savait pas jouer de la guitare. Peut-être qu’il sait toujours pas… Et puis c’est devenu ‘viens, on monte un groupe de rock’. Mais avec une plus petite voix, parce qu’on n’avait pas encore mué.” Il existe des photos, quelque part dans une boîte à chaussures, des Last
Train à 11 ans, s’efforçant de maîtriser des instruments plus grands qu’eux –peut-être réapparaîtront-elles un jour, quand il faudra répéter à l’infini l’histoire de la création du groupe. Pour l’instant, on enchaîne les cigarettes en regardant les gens passer sur le trottoir, et en essayant de se souvenir du premier concert. “C’était chez Fanny!” Et puis, non. Est-ce que c’était le Téléthon? Ou dans un quelconque bar local? La mémoire leur revient: c’était le 19 juin 2009. Ils avaient 13 ans. “Dans le local d’une association qui faisait de l’éveil à la nature pour les enfants, dans un petit village perdu en Alsace. Ils avaient fait les choses en grand: il y avait une sono, une scène et même une banderole avec le nom du groupe. Une banderole, putain. Presque mieux que Bercy.” Les garçons grandissent et se perfectionnent, sans trop y penser. Ce qui leur plaît, ce sont les concerts. Les concerts n’importe où, devant n’importe qui, n’importe comment. Au collège, puis au lycée, dans les bars du coin. Mais vite, le coin ne suffit plus. À 17 ans, ils organisent leur première tournée –six dates sur le territoire– et passent par Strasbourg, Paris, Bordeaux, Lyon. Il y a des soirs où, pour un cachet symbolique de 100 euros, tout se passe bien ; et d’autres, moins. “On a fait trois dates d’affilée à Paris, les deux premières bien, et la troisième… C’était à Belleville, il y avait personne. Peut-être cinq personnes dont trois potes. C’était glauque.” Tant pis, les garçons rentrent chez eux avec une conviction: il va falloir repartir au plus vite. Il y a le bac, il y a les études pendant deux ans, un effort non négligeable pour une jeunesse qui veut voir au-delà de Strasbourg. Pendant six mois, “jour et nuit”, Jean-Noël et Julien ne travaillent plus qu’à l’organisation de la tournée suivante, plus ambitieuse, plus longue. Aujourd’hui, le souvenir répond au doux nom de “tournée-suicide”: “On s’est endettés de 5 000 euros pour acheter un van. On a produit notre premier clip, on a produit deux morceaux. Et on est partis pour 22 concerts en 25 jours, en France et en Europe. On n’était pas payés, on dormait souvent chez l’habitant, c’était n’importe quoi, presque suicidaire. Là, on sortait de nulle part. Quand on en parle aujourd’hui avec des groupes qui commencent, ils nous demandent comment on a fait pour avoir autant de dates, mais il faut se donner la peine, on jouait pour que dalle, si on n’avait pas pris de risques, on serait toujours en train de faire griller des burgers au Quick.”
Refus fiers et système D
Prendre des risques, tout faire tout seuls: un processus qui devient peu à peu une habitude tenace. Une façon de faire de la musique popularisée aux États-Unis dans les rues sombres de Brooklyn, avant que le DIY ne devienne surtout synonyme de bijoux en papier kraft sur Pinterest. Mais les mecs de Last Train ne regardent pas vers les États-Unis, ils ne regardent pas grand-chose, d’ailleurs, à l’exception de la prochaine étape. Auréolé de sa victoire au tremplin des Inouïs au Printemps de Bourges, le groupe voit son nom se murmurer dans les couloirs des labels parisiens. Le téléphone sonne. “On faisait le booking tout seuls, remet Tim, mais on prévenait quand même les tourneurs pour dire: ‘Hey coucou, regardez ce qu’on fait.’ Quand ils ont commencé à nous rappeler, on répondait: ‘Non merci, mais venez quand même à notre concert.’ Il y avait un peu de fierté dans nos refus, mais on voulait prouver qu’on pouvait se débrouiller seuls.” De cette volonté de garder le projet en main, naîtra Cold Fame Records, le label créé
par Jean-Noël et Julien qui, histoire de contourner encore la facilité, décident de produire trois autres groupes de la région. À Lyon, leur petit bureau vit sa vie pendant que Last Train s’apprête à passer l’année 2016 sur la route. “On n’a pas de thunes, mais on paye nos bureaux, on paye deux employés, on produit et réalise nos clips”, annonce Jean-Noël, avant de jeter un regard par la fenêtre. “Bien sûr qu’on peut se planter, soupire-t-il avec un sourire en coin qui ne laisse présager aucune intention de laisser cette possibilité au hasard. “Mais si on tente pas, si on reste dans le confort, on prend pas de risque et c’est le risque qui paye.”
Et effectivement, le risque commence à payer. S’enchaînent Bars en Trans, Garorock, Rock en Seine, la Flèche d’Or, les articles dans la presse et un florilège d’apparitions dans des “tops 5 des groupes à surveiller”. Dans les conversations d’après minuit, on fait des raccourcis allant des “nouveaux Brian Jonestown Massacre/Black Keys/Arctic Monkeys/Black Rebel Motorcycle Club” à “l’esprit Wu Lyf”. Bien avant minuit, Francis Zegut repousse les limites de ses plages horaires et offre à Last Train une émission de deux heures sur RTL2 le 10 novembre dernier. Aujourd’hui, il est encore “plutôt fier d’avoir croisé leur chemin” et s’émerveille de leur “intensité incroyable”: “des racines, de l’électricité, autour de guitares rageuses à une époque où cet instrument est banni des médias, c’est ça le rock et Last Train en est l’exemple incarné”, assure-t-il. Les superlatifs se mêlent, la tournée s’allonge, et dans une industrie qui pousse chaque artiste à pondre un LP au premier alexandrin dans Les Inrocks, Last Train a dix ans d’expérience et pas d’album à l’horizon. “On a sorti deux EP et encore, on vous a bien niqué sur le deuxième, il y a trois chansons déjà sorties”, rectifie Jean-Noël. “C’est tout bête, on est un groupe qui vit par le live. Pour l’instant, on considère que c’est plus excitant de nous voir et de nous entendre en vrai que d’écouter notre EP chez soi. Ça sert à rien de sortir un album si personne n’est là pour l’écouter.” “Et puis on n’a pas envie de le foirer”, ajoute Julien.
15h. La scène 360 les attend pour de nouvelles balances. Et demain, ce sera le départ pour l’Angleterre. “On n’a pas voulu faire de ces deux soirs à Bercy un événement en soi, remet Julien. On a notre histoire, on y tient, on veut pas être ‘le groupe qui a fait la première partie de Johnny’. Pour nous, ce n’est pas un but, c’est une étape vers la suite. On continue.” Faut-il encore retourner sur scène ce soir, devant 15 000 personnes venues entendre Que je t’aime. “On a 30 minutes, faut y aller à fond et ne jamais s’arrêter parce que si tu t’arrêtes… les mecs se souviennent qu’ils sont pas là pour toi”, rappelle Tim. Mais ce soir, c’est sûr, ils seront en place, plus à l’aise que la veille. Bercy, un peu du déjà-vu.
Aller : le 10 mars à la Maroquinerie, Paris
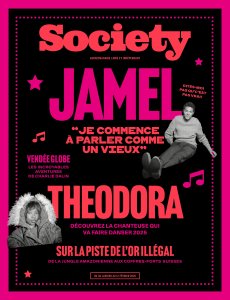
 Photo : Christophe Crénel
Photo : Christophe Crénel