Tous les ans, courant octobre, Philip Roth traverse la 59th West, longe Central Park dont les arbres tournent déjà au rouge et orange, puis contourne Columbus Circle. Il est encore trop tôt pour la vente de bretzels et l’annonce du prix Nobel. Mais Roth continue, descend Broadway jusqu’à la 57ème rue et l’immeuble en briques marron du 250. Il monte au deuxième étage, jusqu’à la suite 2114. Derrière cette porte, la Wylie Agency, crée par l’agent littéraire du même nom en 1980. Andrew Wylie, grand chauve aux yeux très bleus, lui ouvre. Il sait pourquoi Philip Roth a quitté sa maison de Cornwall Bridge, Connecticut, pour être là ce matin, à l’aube. L’écrivain de 82 ans s’installe dans une salle de réunion. Il attend que le téléphone sonne. Mais en 2015, comme les 30 années précédentes, le téléphone ne sonne pas. Ceux des personnes autour de lui viennent de biper : Svetlana Alexievitch vient de remporter le prix Nobel de littérature.
Quand celui que beaucoup considèrent comme le plus grand écrivain américain vivant rentre dans sa grande maison en forme de cube gris clair trônant au milieu d’une immense pelouse verte, entourée par des frênes de 200 ans, il n’y a personne à qui parler. Et c’est ce que Philip Roth apprécie. Pendant 50 ans, c’est dans la dépendance qu’il a écrit ses romans. Debout face à un pupitre. Aujourd’hui, il a un peu mal au dos. Mais surtout, il n’écrit plus. Et depuis qu’il l’a distraitement mentionné en 2012 lors d’une interview aux Inrocks, tout le monde le sait. Dans les mois qui ont suivi cette annonce involontaire, les journalistes ont défilé chez lui, chez son éditeur, à son studio de Manhattan. Tous avec la même question : “Pourquoi?” Au New York Times, celui-ci raconte l’après Némésis (son dernier roman, publié en 2010) : “J’ai traîné pendant un mois ou deux à réfléchir à la suite et je me suis dit : ‘Peut-être que c’est fini.’ J’ai tenté de me redonner une dose d’inspiration en relisant tous les écrivains que je n’avais pas lus depuis 50 ans et qui m’avait tant apporté à l’époque, Dostoïevski, Conrad, Tourgueniev, Faulkner, Hemingway.” Ensuite, Philip Roth a décidé de faire ce qu’un écrivain ne fait jamais : relire ses propres livres. “J’ai commencé par le dernier, et j’ai pensé : ‘C’est pas mal.’ Mais après, je suis remonté jusqu’à Portnoy et son complexe (publié en 1969, ndlr) et j’en ai eu marre, je n’ai pas lu les quatre premiers. J’ai su que je n’aurais plus de bonnes idées. Je sais que je n’écrirai plus aussi bien qu’avant. Je n’ai plus l’endurance pour toute cette frustration. Écrire est une immense frustration, c’est une frustration quotidienne, sans parler de l’humiliation. C’est exactement comme le base-ball : vous perdez les deux tiers du temps.”
Des débuts et des scandales
Pourtant, prendre sa retraite n’a pas été facile pour Philip Roth, une trentaine de livres derrière lui, 26 récompenses et aucun Nobel. En 2008, il racontait déjà à un journaliste du New Yorker vouloir se détacher de l’écriture, “cette habitude de fanatique” : “Je suis allé au MET voir une expo. Super. Magnifiques tableaux. Alors, j’y suis retourné le lendemain. Je l’ai revue. Génial. Et après j’étais censé faire quoi, y aller une troisième fois? Je me suis alors remis à écrire.” Issu de la classe moyenne juive de Newark, né dans les années 30, qu’est-ce que Philip Roth aurait pu faire d’autre? Vendre des assurances, comme son père? Dès 1960, sa nouvelle Goodbye, Columbus s’ouvre sur: “Elle me souriait à moi tout au fond de la piscine du Country Club, j’allais l’attirer vers moi quand elle commença à remonter à la surface, ma main s’accrocha au devant de son maillot et le tissu se décolla, ses seins glissèrent vers moi comme deux poissons au nez rose.” Comme si, en 1960, la semi-pornographie ne suffisait pas, c’est aussi le début de l’autopsie de sa relation passive-agressive avec sa judéité “à l’américaine”. Il est encore à la fac, et déjà deux scandales en un. Mais le vrai, le gros, celui qui le suivra toute sa carrière durant et déterminera la façon dont les Américains des années 60 liront toute son œuvre, arrivera dix ans plus tard avec la publication de son troisième roman Portnoy et son complexe. Une sorte de In Treatment en avance, Portnoy raconte les séances de thérapie d’Alexander, 33 ans, juif de Newark obsédé par le sexe. Somme toute, 280 pages de masturbation. Philip Roth, 36 ans, est porté par la fin des années 60, la liberté de la femme, la guerre du Vietnam, le mouvement des droits civiques. Il se sent libre, un peu trop. La communauté juive ne lui pardonnera jamais: elle l’accuse de trahison et, comble, d’antisémitisme. Certains rabbins comparent Portnoy à Mein Kampf, les féministes américaines le prennent en grippe. Longtemps, l’Amérique des banlieues le renommera “Portnoy” et celle des dîners littéraires mondains le méprisera plus ou moins discrètement.
La période tchécoslovaque
Tout comme Hemingway s’était exilé à Key West, Portnoy tombe amoureux de la Tchécoslovaquie et s’éloigne de l’Amérique, pourtant pierre angulaire de son œuvre à venir. En voyage à Prague en 1971 sur les traces de Kafka, il rencontre Ivan Klíma, Milan Kundera, Ludvík Vaculík, tous écrivains dissidents dans la capitale post-Printemps. Pendant cinq ans, l’américain passe une dizaine de jours par an à Prague. Peu à peu, des grands louches se mettent à le suivre dans la rue, il sait sa chambre d’hôtel sur écoute, ainsi que son téléphone. L’écrivain passe ses journées avec des universitaires, des artistes, des journalistes, des hommes interdits d’exercer leur métier, qui, entre deux ouvrages clandestins, vendent des cigarettes au coin des rues, livrent du pain à vélo, lavent des vitres. “Ils m’ont fait prendre conscience de la différence entre l’absurdité d’être écrivain en Amérique et celle d’en être un en Europe de l’Est, se souvient-il en 2004 dans les colonnes du Guardian. Ces hommes et femmes se noyaient dans l’histoire. Ils travaillaient sous une pression énorme et c’était nouveau pour moi. Ils souffraient pour avoir le droit de faire ce que moi je faisais librement.” En 1977, Philip Roth est arrêté par deux policiers dans le centre-ville de Prague. Pendant longtemps, les tchèques seront curieux de l’intérêt que peut porter cet écrivain américain à leur pays. Lors d’une de ses multiples arrestations, Ivan Klíma se voyait toujours poser la même question : “Mais pourquoi est-ce que l’Américain est là tous les printemps?” Réponse : “Vous n’avez pas lu ses livres? Il vient uniquement pour les filles!” Le lendemain de son interrogatoire, Philip Roth quitte la Tchécoslovaquie et rentre à New-York. Il continuera à communiquer avec ses amis, par courriers codés, mais ne pourra pas revoir Prague pendant douze ans.
Mais Roth n’a plus envie de New York, cette métropole “où l’art de meurtrir les âmes atteint la perfection”. Alors l’écrivain s’exile encore, immobile. Il ne lit plus que des livres venant d’Europe de l’Est, prend le ferry toutes les semaines pour assister à la classe de culture tchèque d’Antonin Liehm dans une petite université de Staten Island. “Ma vie à New York après Portnoy n’était qu’un exil dans la communauté tchèque, j’écoutais, j’écoutais, j’écoutais. Tous les soirs, j’allais dans des restos tchèques de Yorkville, je parlais à qui voulait bien me parler. J’ai construit mon monde tchèque à New York et c’est cela qui m’a sauvé. J’ai laissé toute ces conneries de Portnoy derrière moi. Ce n’était pas important, ça ça l’était. La célébrité n’est qu’une distraction sans intérêt”, déclarait-il au Guardian en 2004. Pourtant, à l’exception de L’Orgie de Prague (1985), Philip Roth n’écrit pas sur l’Europe de l’Est et ses aventures tchèques. Ses voyages ne le poussent qu’à une chose: commencer sa grande fresque américaine. “Il fallait que je méprise tout le côté commercial de la vie américaine pour devenir un certain type d’écrivain”, raconte-t-il dans le documentaire Philip Roth: biographie d’une œuvre. Maintenant que Roth est persuadé de détester l’Amérique, il peut l’écrire. Ou plutôt, Nathan Zuckerman peut. Car Philip a bien appris sa leçon, et il n’écrira plus que par double littéraire interposé. Nathan Zuckerman, c’est cet écrivain, universitaire à mi-temps, solitaire, curieux mais reclus, qui suce le sang et les histoires de ceux qu’il rencontre. Tout en restant dans l’ombre. “J’avais envie de rendre compte de la comédie sociale que peut représenter la vie d’un écrivain aux États-Unis”, se justifie-t-il. Mais Nathan Zuckerman, c’est Philip Roth et rien d’autre. Et surtout, ce n’est pas Alexander Portnoy. Si le sexe et le désir font toujours partie de la fresque que peint l’écrivain, ils ne sont plus les thèmes principaux des neuf romans narrés par Zuckerman. Roth nouvelle génération, c’est la famille (dysfonctionnelle), le monde universitaire (mesquin), l’écriture (addiction) et bientôt les grandes périodes de la vie américaine: la guerre du Vietnam, l’anticommunisme, l’ère Clinton.
L’hommage du président Clinton
Il lui reste pourtant un ou deux coups durs avant d’arriver au firmament tardif de sa carrière. Operation Shylock d’abord, en 1993. Roth pense écrire son chef-d’œuvre, c’est un échec public et critique. La même année, il divorce avec l’actrice Claire Bloom, qui ne manquera pas de l’épingler dans un livre à charge. Roth se fait interner, il déprime. Prozac, lithium, alcool l’accompagnent. Mais voilà, l’écrivain est encore bien énervé et a des choses à dire contre la vie, les gens et l’univers: il peut écrire. À 60 ans, le voilà sur l’autoroute qui est censé le mener au Nobel. À cet âge, les autres écrivains meurent ou s’essoufflent: la voix est libre. Il a gardé son studio de l’Upper West Side, son histoire d’amour-haine avec New York le sauve: “Ce n’est qu’en étant dans la grande ville que quelqu’un se rend compte qu’il veut à nouveau faire partie de la vie”, écrira-il dans Exit le fantôme, en 2007. Le Théâtre de Sabbath, féroce conte sur la ville et la vieillesse, raconte la vie d’un vieux marionnettiste lascif, vindicatif, et autodestructeur. Il remporte le National Book Award. Vient la fameuse trilogie américaine: Pastorale américaine –“la vraie merde de la folie américaine, l’Amérique du chaos”–, l’histoire d’une famille, d’un homme parfait qui met au monde un enfant que le gouffre des générations l’empêchera toujours de comprendre, puis J’ai épousé un communiste, récit d’une descente aux enfers à l’américaine, et enfin La Tache –“le vertige de l’indignation hypocrite”, melting-pot de guerre, sexe, vieillesse et race, sur fond d’affaire Lewinsky. Souvent, tout commence bien, tout finit mal. Prix Pulitzer, Meilleur livre étranger, Faulkner Award, Médicis étranger. À deux ans de la fin du siècle, le président Clinton lui remet la National Medal of the Arts, et déclare: “Ce que James Joyce a fait pour Dublin, William Faulkner pour Yoknapatawpha County, Philip Roth l’a fait pour Newark.”

Désormais, il y a un post-it sur l’ordinateur de Philip Roth, dans son bureau de l’Upper West Side : “Le combat contre l’écriture est terminé.” Quand il la voit, il est heureux, soulagé. François Busnel a rencontré l’homme pour sa dernière interview télévisée, en 2014. Un rendez-vous presque raté, que le producteur-animateur de La Grande Librairie sur France 5 raconte aujourd’hui: “Il n’aime pas les interviews et encore moins la télévision. Mais je le rencontre régulièrement à New York, en dehors de toute promotion et loin des caméras. L’idée d’un film documentaire sur lui, dans lequel il pourrait s’exprimer librement sur chacun de ses livres, est venue lorsqu’il a annoncé sa décision d’arrêter d’écrire. Un jour de 2014, il a annoncé dans la presse qu’il avait donné sa dernière interview à la BBC. Je lui ai aussitôt écrit, il m’a répondu : ‘Ah oui, bien sûr, votre film sur moi. Bon, eh bien, venez me voir dans quinze jours et tournez votre film. Mais pas plus tard : cette fois-ci, c’est dit : je ne donnerai plus aucune interview à la télévision.’ Quinze jours plus tard, nous étions chez lui.”
Pourtant réputé difficile avec les journalistes, l’écrivain ouvre très grand ses portes. “Il nous a ouvert sa maison du Connecticut en nous laissant aller où bon nous semblait : bureau, bibliothèques, salon, on pouvait ouvrir les manuscrits, les albums photo… Rien à voir avec l’image, volontiers véhiculée par la légende médiatique, d’un ermite misanthrope qui détesterait les gens en général et les journalistes en particulier. En réalité, il est d’une extrême gentillesse et très drôle. Il sait qu’il est impressionnant, il s’amuse avec cela. Surtout quand il a face à lui quelqu’un qui l’admire et a lu tous ses livres, ce qui est la condition pour être accepté. Il a besoin de savoir que ses interlocuteurs sont familiers de son œuvre. Il est excellent lorsqu’il s’agit de raconter telle ou telle anecdote sur l’écriture d’un roman mais déteste en revanche avoir à expliquer ou à justifier tel ou tel livre.” Busnel se risque à l’exercice, enfile ses gants, et se lance. Avec la question. La littérature, vraiment fini? “Il a ri”, se souvient le journaliste. “Il dit qu’il n’a jamais été aussi heureux depuis qu’il n’écrit plus, qu’il a abandonné un fardeau et vit enfin comme tout le monde. Il s’amusait avec son nouveau téléphone en racontant que c’était la première fois qu’il en avait un. Il découvre, il parle à ses amis, chose qu’il n’a jamais eu le temps de faire. Il était décontracté et… heureux.” Mais les lecteurs veulent-ils que Philip Roth soit heureux? N’a-t-il pas écrit ses meilleurs bouquins quand il ne l’était pas? Le Monde a bien tenté de le piéger lors d’une interview en 2013. Philip Roth est obligé d’admettre qu’il écrit toujours: oui c’est vrai, il travaille bien à des nouvelles en tandem avec une certaine Amélia, 8 ans. “Nous avons écrit plusieurs nouvelles assez longues ensemble, par e-mail. Elle écrit un paragraphe, j’en écris un autre, et on fait un va-et-vient, en nous obligeant à nous montrer de plus en plus imaginatifs au fil des échanges. En ce moment, nous travaillons à une nouvelle dont les personnages sont deux savants, et ces deux savants sont des chiens. L’idée était d’Amelia. Elle a l’imagination d’Ovide. Mais je ne suis évidemment pas en train d’écrire de la fiction. Je m’amuse avec une petite fille très intelligente et exceptionnelle que j’adore.” Le monde n’a plus qu’à attendre que Philip Roth change d’avis. Tout comme il attend que le comité suédois du prix Nobel change d’avis. Dans sa campagne du Connecticut, en regardant les frênes par la fenêtre, l’écrivain y pense toujours. L’année dernière, il murmurait au New York Times: “Si j’avais appelé Portnoy et son complexe, ‘L’Orgasme au temps du vorace capitalisme’, je me demande si je n’aurais pas gagné la faveur de l’Académie.”
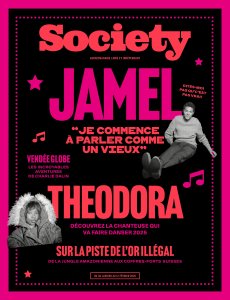
 Philip Roth dans son appartement de Manhattan, en 2010.
Philip Roth dans son appartement de Manhattan, en 2010.