Il est environ 19h ce mardi soir de la fin novembre, et la nuit a déjà enveloppé Antananarivo, alias Tananarive, en pleine île de Madagascar, lorsque trois silhouettes apparaissent au détour d’une rue du quartier d’Andravoahangy. Aux avant-postes, il y a Eddy et son frère Mahefa. Tous les deux ont la petite vingtaine. Si ce n’était leur lieu de naissance et de résidence exclusive, l’un comme l’autre feraient de parfaits modèles pour une de ces pubs Dior, période Hedi Slimane, censées vanter les mérites de la maigreur rock et son corollaire de jeans serrés à la taille, de poses arrogantes et de cheveux ébouriffés juste ce qu’il faut. Seul accroc au cliché : au lieu de se balader dans la rue collés-serrés avec des Kate Moss de Madagascar encore mineures, les deux leaders du groupe punk malgache The Dizzy Brains ont fait le déplacement accompagnés par… leur père. Ce dernier ne tenait pas à laisser sortir ses fils de 25 et 21 ans tout seuls la nuit. Car Madagascar ne ressemble pas au New York hipster des environs de Williamsburg, à l’East End londonien ni aux abords du Bus Palladium dans le IXe arrondissement parisien. Alors même si Eddy et Mahefa connaissent par cœur
ces rues de Tananarive où ils ont souvent dormi après leurs concerts à même le bitume, ils n’ont pas forcément envie de les magnifier : “Pour ne pas prendre le risque de nous prendre un coup de couteau en rentrant chez nous après nos concerts, on a souvent préféré dormir dans la rue.” Il faut dire qu’à cet endroit même, fin octobre, un dessinateur de presse, Rakima, a été poignardé par deux voleurs, venant s’ajouter à la liste des victimes de l’insécurité dans cette partie de la capitale. Mais si le père des deux Dizzy Brains est ici, c’est également car il n’est pas pour rien dans les velléités rock’n’roll de ses fils. Il vit même sans doute son rêve de découverte du monde grâce au rock à travers le groupe de ses enfants. Du coup, rien de plus normal que de l’entendre rembobiner, avec une certaine fierté, sur ce qui l’anime et ce qui forme également la bande originale de sa génération : “Moi-même je suis musicien. Pas réputé, hein, mais je sillonne les scènes avec des gens qui ont déjà une petite aura, des groupes qui jouent dans les cabarets. On joue du rock, du blues, parfois de la country. Pendant mon enfance, on a vécu la musique rock à fond dans l’île en écoutant les groupes célèbres de l’époque : Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, etc.” Eddy à la relance : “Avant, dans les années 70, il y avait les Kinks. Ils étaient très populaires ici, je crois. En tout cas, j’en ai entendu parler. Les mecs de la génération de mon père n’arrêtaient pas de nous vanter les disques de ces gars. Mais avec le temps, ce feeling rock s’est dilué dans l’île. C’est même devenu une pratique underground. Nous, on joue dans des bars minuscules pour pratiquement rien. Au maximum 40 personnes viennent nous voir. De toute façon, les gens de mon âge préfèrent la pop commerciale qui vient des États-Unis et les trucs tropicaux qui font remuer les fesses.”
Serge Gainsbourg, Jacques Dutronc et les clones de Beyoncé
Le père et ses deux gamins allument une petite lumière et guident à travers le dédale des ruelles d’un Tana à l’éclairage public rare, voire absent lorsque surviennent les très fréquentes coupures d’électricité. Une grille en fer, une petite cour d’immeuble, une porte d’entrée exiguë et quelques étages dans un escalier sombre avant d’entrer dans un appartement douillet. Les Dizzy Brains accueillent à domicile et indiquent le chemin du salon. Un vrai salon familial, avec canapé, fauteuils, télé et chaîne hi-fi. C’est d’ailleurs grâce à cette dernière, en 2011, qu’est né le groupe, comme le proclame fièrement Eddy : “J’étais descendu aux toilettes, il y avait cette chanson que mon père jouait sur la chaîne hi-fi : 7 heures du matin, de Jacqueline Taïeb. Ça m’a fait un déclic dans la tête : pourquoi ne pas faire du rock ? Et le déclic s’est confirmé quand, quelques semaines plus tard, on est tombés sur des vidéos de Serge Gainsbourg et Jacques Dutronc à la télé. On a vu ces mecs tellement cinglés, qui déchiraient avec leurs textes, qui déchiraient avec leur attitude sur scène. On a eu l’idée du nom du groupe : The Dizzy Brains. Parce que tout chez ces mecs nous filait le vertige. Là encore, c’est grâce à notre père qu’on a été exposés à ça !” Même si Eddy dit avoir voulu devenir avocat avant de réellement se consacrer au rock, le parcours du combattant qu’il se remémore ressemble à une vieille histoire.
D’abord, le groupe commence à répéter dans des caves. Il fait avec les moyens du bord et un art consommé de la débrouille, emprunte la guitare du paternel, les amplis d’un ami de la famille, écrit des chansons sur quelques accords saturés, se gave de vidéos YouTube des Arctic Monkeys, de The Stooges ou de The Strokes pour parfaire son attitude. Les thèmes des chansons ? Ce qu’ils connaissent le mieux : la corruption à chaque coin de rue à Tananarive, le danger, le manque d’argent et de perspectives, la sexualité qu’on réprime, la censure. À tous les coups, cela donne des morceaux pleins de fièvre punk assez loin de ces clones de Beyoncé un peu cheap dont les disques mal produits se vendent sous le manteau ou de ces musiciens tropicaux qui peuvent parfois réunir jusqu’à 40 000 personnes sur leurs seuls noms. Naissance d’un nouvel underground ? Ce qui est certain, c’est que parmi ces morceaux, il y en a un, immense, qui s’intitule Vangy et dont la vidéo en noir et blanc commence à beaucoup se relayer sur les réseaux sociaux entre jeunes malgaches restés au pays et expatriés. Ici, caché derrière quelques accords saturés, de l’urgence et des paroles qui doivent parler à pas mal de jeunes de Tananarive (“Pauvre comme tu es tu n’as que 1 200 ariari ((la monnaie locale, ndlr) et une clope pour affronter cette dure journée”), il y a donc ce que les Sex Pistols appelaient clairement le no future. Car en fin de compte, la rage d’être un jeune punk sans perspective est la même dans tous les pays du monde, à toutes les époques, comme le souligne Eddy : “Depuis que les réseaux sociaux existent, on sait que les jeunes de Tananarive ont les mêmes préoccupations que les jeunes, disons, de Paris ou des environs, hein. On parle de sexe, de soirées avec de l’alcool, de l’impasse dans laquelle on est tous. Parce qu’on n’a pas beaucoup de perspectives. Sauf que nous, on est juste plus pauvres encore et peut-être plus censurés qu’ailleurs.”
La peau dure
Avant de raccompagner et de remercier chaleureusement pour la visite chez eux, Eddy, Mahefa et leur père font comme s’ils n’avaient pas remarqué qu’un flic se livre à un contrôle plutôt musclé sur un taxi local en pleine rue d’Andravoahangy. Devenu hermétique à ce genre de scènes, Eddy préfère soulever les épaules et dresser ce constat : “Faire du rock à Madagascar, ce n’est pas une carrière, ça ressemblerait même plutôt à un combat permanent. D’abord, dans la rue, tu te fais constamment racketter par les flics pour aller d’un point A à un point B. Ensuite, si tu veux jouer, tu n’as pas le choix. Il faut passer par l’underground et tenir bon. Tu dois te produire dans les petits bars de nuit, les cabarets assez glauques. Si tu tombes sur un programmateur de soirées cool, on te file l’équivalent de 100 euros pour tout le groupe. Mais le plus souvent, tu tombes sur un patron bourré. Lui va te laisser jouer dans un premier temps. À un moment il va quand même venir te dégager de la scène à coups de pied au cul si ce qu’il entend de ta musique ne lui plaît pas.” En esquissant un sourire désolé, Mahefa cloue même : “On a connu ce genre de situations un peu borderline tout le temps. On est restés parmi les mendiants, d’accord, mais ça ne nous a pas empêchés de persévérer. Alors maintenant, quoi qu’il nous arrive, on a la peau dure…”
La peau dure, c’est sans doute ce qui pourrait permettre aux Dizzy Brains de ne pas perdre le sens de leurs réalités. Depuis qu’ils ont appris leur présence à l’affiche du festival français des Transmusicales de Rennes, là où Nirvana, Daft Punk, Björk, Noir Désir, Portishead et plus récemment Rodriguez ont donné leurs premiers concerts français voire européens, tout s’est subitement emballé : intérêt croissant des médias, des producteurs, articles dans la presse de Madagascar soulignant “la fierté nationale” à voir un groupe punk représenter dignement (?) hors de l’île. “Il y a encore quelques mois, personne n’aurait misé le moindre ariari sur nous et maintenant, même des anciennes copines veulent reprendre le contact avec nous”, frime un peu Eddy.
“Elle est pas belle la vie ?”
Pour rationaliser son illumination de programmer, quasi en tête d’affiche, un groupe punk inconnu et originaire de Madagascar, Jean-Louis Brossard, directeur artistique du festival, a décidé de pousser au maximum ses capacités d’enthousiasme : “Ces gamins, donc, ils font du rock. Ils vont me mettre le feu, j’en suis persuadé. Parce que le rock, enfin ce qu’il véhicule de révolte contre quelque chose, ça a sans doute un peu perdu de son sens dans nos pays occidentaux. Alors que chez eux, à Madagascar, dans un pays pas facile, ils incarnent ce truc qu’on avait aimé dans l’Angleterre punk de la fin des années 70 ou à New York. Ce qu’ils chantent à un sens. Ça vient vraiment de la rue. Il y a une révolte !”
Et sa révolte, c’est peu dire que le groupe malgache n’a pas l’habitude de l’exporter. Eddy se met à raconter son premier voyage hors de Tananarive, encore jetlagué : “Ça a été 14 heures de vol, quand même. Donc, on a tous ressenti une grosse fatigue. Jamais on n’avait pris l’avion de notre vie. On n’était jamais sortis de Tananarive. C’était une expérience bizarre parce qu’il y avait de la bonne bouffe gratuite et des films. On ne savait pas que dans l’avion, les choses étaient gratuites. Moi, j’ai maté Batman sur le petit écran en face de mon siège. Mais quand tu arrives en France, tu compares forcément avec l’ambiance à
Tana et tu vois que les gens, ils ont tous l’air stressés, même si tu ne comprends pas pourquoi. Dans les rues, tout le monde marche vite, tu te fais bousculer, on ne te regarde jamais.” Il marque une pause et s’illumine : “Et malgré cette sensation bizarre de gens qui sont stressés pour aucune raison, tu te dis : ‘Elle est pas belle la vie ?’” Pour ce qui est du festival, Eddy avoue : “On ne sait pas à quoi s’attendre ici. On n’a jamais su à quoi ressemblait une grande scène. Notre plus gros concert jusqu’à présent, c’était chez nous, au festival Libertalia devant 300 ou 400 personnes. Là, on nous a dit qu’on allait voir des milliers de têtes. Alors, bien sûr, on est impatients, mais on a peur aussi de décevoir !” Car les gazettes locales, parlent de cette série de concerts en France comme d’une véritable fierté pour le pays. Les anciens potes d’adolescence, celles et ceux qui ont toujours pris Eddy, Mahefa et leur bande pour des losers, reprennent le contact. Le père, resté au pays (“On ne pouvait pas lui payer un billet d’avion pour la France. On a essayé, mais c’est plusieurs mois de salaire rien que pour l’aller”), attend des nouvelles, mais attendra longtemps car, là encore, impossible de se permettre d’investir dans des communications entre l’Europe et Madagascar, trop coûteuses.
Un vrai potentiel scénique
En ce début de mois de décembre rennais, les quatre Dizzy Brains observent, les yeux écarquillés et à bonne distance, les us et coutumes d’un festival occidental. Dans un coin de la salle du Liberté, le spot principal des Transmusicales, c’est la soirée d’ouverture. Une fanfare venue de Thaïlande, le Khun Narin Electric Phin Band, joue une musique qui mélange des éléments de folklore traditionnel et de psychédélisme sentant très fort le champignon hallucinogène. Les quatre remuent la tête mais sans en faire trop. Encore un peu sur la réserve. Puis, les voilà qui fondent sur le buffet dinatoire. Mais au moment de piocher dans ces assiettes où les toasts côtoient des fars aux pruneaux, ils hésitent : “A-t-on vraiment le droit de se servir ? N’y aurait-il pas un flic caché dans un coin pour demander un bakchich en échange d’une crêpe ?” Mahefa : “Ici c’est tellement calme. Les gens parlent doucement. Ils se saluent doucement.” Pour faire le lien entre ce nouveau monde et l’ancien, les Dizzy Brains sont accompagnés par Christophe David, un homme dont le CV dégaine des expériences de producteur dans la musique, de documentariste globe-trotter, de programmateur de concerts du côté de La Réunion. S’il n’est pas à proprement parler leur manager, ce quinquagénaire aux cheveux gris et longs avec des faux airs d’ancien surfeur encore capable de raconter sa rencontre avec “une vague métaphysique”, est un des premiers à avoir perçu un vrai potentiel scénique, mais surtout une vraie histoire derrière le groupe. Une histoire qui coïncide avec sa découverte de
Madagascar en 1992, après son premier divorce, un nouveau mariage, puis son installation sur place : “Madagascar, c’est le même principe que l’Inde. C’est un pays qui ne te laisse pas intact. J’ai fait deux mois et demi de pirogue pour les besoins d’un documentaire sur les pêcheurs Vezo. À partir de là, Madagascar m’a fait comprendre ce qu’est le fatalisme et l’animisme. C’était en 2003, et j’y suis toujours.” Si le lien que Christophe David a tissé avec Madagascar lui permet de relativiser ce qu’il se passe ailleurs dans le monde (“Ici, des villages entiers sont massacrés par les voleurs de zébus. Les hommes politiques en place détournent l’aide envoyée par l’ONU pour leur profit personnel. Si tu as un euro en poche, la police va venir te racketter et te prendre 80 centimes”), il s’est également très vite intéressé à la culture et en particulier à la musique nationale. Sa rencontre avec les Dizzy Brains part d’ailleurs de ce constat : si tout cela est encore frais, peut-être que ce groupe est à l’avant-garde. “Ça s’est passé dans une cave du centre ville de Tananaride. À l’époque, ils répétaient dans leur coin et c’était un ami qui m’avait conseillé d’aller les voir. C’était en 2013, je crois. À Madagascar, normalement, il n’y a pas de showman et Eddy, lui, savait occuper la scène, se déplacer. Ce qui est très étonnant pour un Malgache. Donc, comme ils me touchaient, je leur ai proposé de jouer au festival Libertalia, mais à cette condition que les deux frères, Eddy et Mahefa, remplacent leur guitariste de l’époque et leur batteur. Ces deux-là n’étaient vraiment pas au niveau et depuis, ils se sont adjoints deux très bons musiciens pour les pousser. Ils jouent du rock, mais surtout, ils sont les seuls à dénoncer un peu de ce qui ne va pas dans ce pays. Ils représentent cette nouvelle génération malgache qui veut le changement.” Celle qui commence à revendiquer de meilleures conditions de vie dans le Madagascar des années post-décolonisation.
Une première partie pas comme les autres
Avant leur concert d’hier soir, avant de devenir peut-être l’avant-garde incontestable d’une deuxième attaque punk qui viendrait, cette fois-ci, des pays du Sud, les Dizzy Brains savent qu’il va falloir apprendre à maîtriser d’abord leur sève rock devant un public qui en a vu d’autres. Les organisateurs des Transmusicales de Rennes ont eu la bonne idée de proposer au groupe un tour de chauffe devant le public… de la maison d’arrêt de Rennes. Il est 14h30 ce mercredi 3 décembre, et dans le coin du gymnase réquisitionné pour le live, c’est devant la batterie préalablement disposée sur scène que les quatre membres des Dizzy Brains écarquillent les yeux. Les deux frères Eddy et Mahefa se poussent même du coude en se demandant s’il y aura autant de monde pour leur vrai concert aux Transmusicales alors qu’il devrait y en avoir… 100 fois plus au minimum. Si la vingtaine de taulards qui se sont installés avouent avoir fait le
déplacement plutôt pour encourager le passage sur scène d’un groupe sorti de l’atelier hip-hop de la prison que pour écouter les Dizzy Brains dont ils ne connaissent rien, il ne faudra pas plus de cinq minutes à Eddy, Mahefa et les autres pour électriser le gymnase. Alors bien sûr ce n’est pas l’ambiance du célèbre live au pénitencier de Folsom, Californie où Johnny Cash recevait des cris d’extase de son public quand il chantait “et j’ai tué à mec à Reno juste pour le plaisir de le voir crever”, mais c’est quand même la vraie énergie du punk.
Cette semaine rennaise est peut-être bien la première du reste de la vie des Dizzy Brains. Eddy marque une pause et fixe un point imaginaire à l’horizon : “On est étonnés d’être ici, hein, parce que tout est nouveau, mais on apprécie chaque moment. Déjà, on sent que rien ne peut arriver de mal ici. À l’aéroport, en présentant notre passeport pour partir en France, on a encore dû donner de l’argent à un fonctionnaire. C’est toujours comme ça. Corruption et violence. Quand tu marches dans la rue, le moindre regard peut dégénérer. Tu te fais attaquer à l’arme blanche. Si l’alcool le veut, les choses s’enveniment très vite. Tu es littéralement mort pour rien du tout chez nous.”
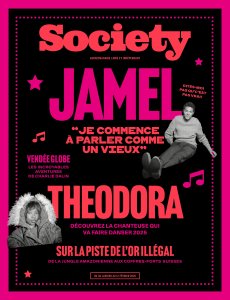
 The Dizzy Brains / © Rijasolo
The Dizzy Brains / © Rijasolo