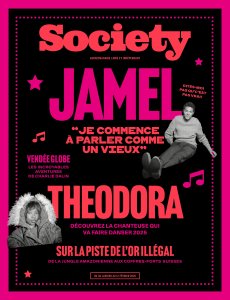Prince – Free jazz in the dark
En 2001, Prince annule toute sa tournée mais conserve la date de Montréal. On n’a jamais su vraiment pourquoi et c’était juste un peu plus compliqué à organiser, mais bon, ça ne se refuse pas. Pourtant, au matin du concert, le grand quotidien anglophone de la ville nous dézingue. Le journaliste du Montreal Gazette se prend pour la police du jazz, nous qualifie d’infâmes opportunistes et déclare qu’un artiste comme Prince n’a rien à faire dans notre festival. L’après-midi, ce dernier ne dit rien et fait ses balances comme prévu. Elles durent juste beaucoup plus longtemps que d’habitude. On voit bien que les musiciens se demandent ce qui se passe et ont hâte d’aller manger. Prince s’en fout, les convoque dans la foulée pour une réunion et s’enferme avec eux dans les loges jusqu’au début de spectacle.
À l’heure du concert, seuls Larry Graham (bassiste de Sly & the Family Stone, inventeur de la technique du ‘slap’, ndlr) et lui en sortent. Prince laisse presque toutes les lumières éteintes. Le public, lui, se demande qui est réellement sur scène. Et dans la pénombre absolue, pendant une heure, Prince fait un set totalement free. Il s’attaque au clavier, joue un peu de guitare, parle dans le vocoder pendant que Larry Graham balance de grosses lignes de basse. C’était quasiment de la non-musique, à mille lieues de ce que les gens attendent de lui. Enfin, Prince décrète un entracte, ce qui n’était pas non plus planifié. L’atmosphère est très bizarre, des spectateurs quittent la salle, des journalistes de la radio viennent me voir pour me demander si Prince est vraiment présent ce soir. Dix minutes plus tard, les lumières s’allument soudain, et il prend tout le monde de court. Les gens s’empressent de regagner la salle et tombent nez à nez avec un Prince au micro qui demande : ‘Qui est le type qui joue cette merde depuis le début ? Si nous sommes ici, c’est pour du rock and roll !’ Sur ce, tout le groupe monte sur scène et c’est parti pour deux heures de hits. C’était n’importe quoi, totalement imprévisible. Comme toujours avec lui.
De toute façon, tu n’as pas intérêt à aller le voir pour lui dire ‘hey coco, tu me fais des hits ce soir’, c’est le meilleur moyen de ne jamais en entendre un. Au Stade de France, en 2011, il a tout de même joué en majorité que des jams et des covers. Il n’y a que lui pour traiter un stade de cette manière. Si t’es les Grateful Dead, je dis pas, mais lui ? Pas avec un tel répertoire. Mais c’est comme ça, personne dans ce milieu ne dit à Prince quoi faire, personne… Tu ne sais jamais à quoi t’attendre, il contrôle tout et saque sans cesse son personnel. Au final, d’une journée à l’autre, tu changes d’interlocuteur. Les gros tourneurs ne sont pas habitués et flippent souvent avec lui. Récemment, il a donné un concert à Montréal qui n’a été annoncé que… quatre jours avant. Après, il peut se permettre, c’est l’artiste live le plus talentueux au monde.
Prince en concert à Montreal, en juin 2011.
Paco de Lucia – La menace des doigts brisés

À l’été 1986, Paco de Lucia annule au dernier moment sa tournée américaine. Sans le prévenir, le tourneur l’a mis en première partie du brésilien Milton Nascimento, une situation inacceptable pour le maître du flamenco. Il ne garde en fait qu’une seule date : la nôtre, où, pour la peine, il est tête d’affiche. Sur le coup, je me suis dit que cela expliquait sa présence. Mais, en fait, non. Des gens de Toronto –je n’ai jamais su qui– lui ont raconté que nous étions un peu mafieux sur les bords, que nous avions pour sale habitude de briser les doigts des artistes qui nous faisaient faux bond. On est en train de dîner quand il me raconte tout ça. Puis, il me toise et finit par dire : ‘Plus je te regarde, plus je me dis que t’as vraiment pas l’air d’un dur. Je crois bien qu’on m’a raconté des conneries.’ Je n’ai pu que confirmer. Venir d’Espagne pour une seule date à Montréal n’était vraiment pas rentable. Il a perdu pas mal d’argent dans l’aventure mais moi, j’ai eu mon concert. Alors après, on s’est rattrapés, on a beaucoup bossé ensemble.
À chaque fois qu’il revenait à Montréal, on rigolait de cette histoire de mafia. D’ailleurs, une fois, je lui ai sauvé la peau. C’était l’année où il avait fait venir sa maîtresse. D’après ce que je sais, sa femme de l’époque était un peu une emmerdeuse. Or, un matin, l’un des employés du festival m’appelle de l’aéroport. Il est en charge du transport des artistes et a, en face de lui, une personne non prévue sur la liste, une dénommée Madame de Lucia. Elle vient d’atterrir et réclame qu’on la conduise directement à son mari. Évidemment, je leur ai demandé de jouer la montre, puis j’ai couru tout droit à l’hôtel de Paco. Lui n’en menait pas large, il avait probablement peur de perdre des plumes dans un divorce. On a vite déplacé les affaires et j’ai installé sa maîtresse dans un autre hôtel du centre-ville. Quand sa femme est arrivée, elle a reniflé partout dans la chambre, en quête d’une odeur féminine. Un vrai vaudeville. Quelques années plus tard, j’ai dîné avec Paco à Londres et entre-temps, la fameuse maîtresse était devenue son épouse. Elle a levé sa coupe de champagne en ma direction et m’a appelé son ‘sauveur’.
Jaco Pastorius : ‘Mais où est Pat ?’
Il est 3 heures du matin, et Jaco Pastorius est défoncé. Il me harcèle pour savoir où est Pat Metheny qui a joué le même soir que lui, mais plus tôt. Nous sommes à l’hôtel et je sais très bien où il est. Évidemment, je ne lui dis rien. ‘Je crois qu’il est au même étage que moi, je l’ai croisé dans l’ascenseur cet après-midi’, me répond-il surexcité. Sur ce, il grimpe au fameux étage et tire l’alarme. Tous les clients sortent en panique dont un Pat Metheny totalement nu. Et là, Jaco Pastorius, hilare, le pointe du doigt : ‘Pat ! Mon pote !’
James Brown : ‘Mon million ! Donne-moi mon putain de million !’
C’était en 1985 et nous l’avions booké dès l’hiver. Mais, entre-temps, était sorti Rocky IV. Living In America faisait un carton et l’avait remis sur le devant de la scène. De notre côté, ça roulait, la salle de 2 000 places fut vite sold-out, et même la télé publique canadienne, CBC, voulait filmer le concert. Et c’est là que ça s’est compliqué. L’année précédente déjà, j’avais vu James Brown à New York pour le New Music Seminar. Un événement pro ou se mêlaient des tourneurs, des producteurs, des patrons de label, mais aussi toute une flopée d’artistes. Je me souviens, il y avait la jeune Madonna qui n’avait, à l’époque, que son single Lucky Star. Au milieu de tout ça, James Brown était un peu la vedette. Il devait donner une sorte de conférence sur l’industrie du disque mais n’avait visiblement pas bien compris à qui il avait affaire. Le voilà donc qui prend le micro et déclare : ‘Vous savez les jeunes, vous n’avez pas besoin d’un manager, d’un agent, etc. Tout ce qu’il vous faut, c’est un bon comptable et un avocat ! Tous ces gars de la musique ne sont que des incompétents.’ Après ces mots, les trois quarts de l’assemblée commençaient à faire la gueule. Mais James Brown ne s’est pas débiné et a continué sur le même ton. ‘La dernière fois, j’étais à Paris. Savez-vous ce que mon agent m’a dégotté ? Une pauvre salle de 1 000 places. Et savez-vous combien de Parisiens veulent voir James Brown en concert ? Au moins un million ! Résultat, ce sont 999 000 personnes qui sont restées sur le trottoir !’

Pendant des mois, j’ai beaucoup ri avec cette histoire du million, mais je ne pensais pas que j’allais moi-même en faire les frais. Lorsque j’ai appelé son manager –car il en avait tout de même un– pour lui soumettre la demande de captation de CBC, James Brown était dans son bureau. Depuis la sortie de Rocky, il était furibard, il estimait qu’au regard du succès du film, il n’avait pas été assez bien payé. Chose que je ne savais pas. Bref, le manager, sentant le coup venir, m’a passé directement son boss au téléphone. Je me présente donc à James Brown et lui évoque le projet. Mais j’ai eu le malheur de prononcer le mot ‘film’ dans la phrase… Il me coupe d’emblée : ‘Un film ? Je veux un million de dollars !’ Je tente de lui expliquer que ce n’est pas un film, plutôt une émission et de la télé publique en plus, le gouvernement, etc. ‘Le gouvernement ? Que des enculés !’, crache-t-il. Il revient sans cesse sur cette histoire de million. Ça n’en finissait pas : ‘Trouve-moi ce million et je le fais, sinon oublie direct !’ – ‘Mais, c’est une émission de télévision…’ – ‘Me prends pas pour un con, c’est un film, donne-moi ce million.’ – ‘Ils ne font qu’enregistrer votre live !’ – ‘Ah, vous allez pas filmer peut-être, il n’y aura pas de caméras ? C’est donc un film, mec ! Donne-moi ce putain de million !’
Bon, autant dire que la télé canadienne ne s’est jamais pointée. Dommage d’ailleurs, le concert fut fantastique. C’est amusant, à Montréal, je crois qu’il a dû faire toutes les salles de la ville. Dans les années 1980, je l’avais aussi programmé pour deux soirs au Club Soda. À cette époque, il se remettait d’une attaque cardiaque. Or, comme à chaque fois, il y avait ce rituel de fin de concert avec la cape et son assistant qui essaye tant bien que mal de le faire sortir de la scène. James Brown jetait alors la cape en l’air et au lieu de partir, reprenait le micro pour continuer à performer. Mais ce soir-là, ils avaient raffiné un peu plus la chose. Contrairement à d’habitude, l’assistant s’est emparé du micro et a gueulé : ‘S’il vous plaît, dites-lui d’arrêter, il sort d’une attaque et s’il continue, il va mourir sur cette scène, je vous en supplie !’ En face, le public braillait. Du genre rien à carrer, qu’il crève mais qu’il continue à chanter… Quelle mégalomanie (rires) ! On ne s’est jamais ennuyé avec lui.
Keith Jarrett – Le matelas en jet privé

Il a mis du temps à rendre publique sa maladie, son ‘syndrome de fatigue chronique’. Donc, je dois bien avouer que la fois où il a annulé son concert pour une histoire d’infection urinaire, j’étais un peu échaudé. Moi qui ait vu mon père, fourbu de rhumatismes, prendre sa vieille voiture à 5 heures du matin pour aller bosser en plein hiver, j’avais peu de sympathie pour ce genre d’excuses. Mais il s’est avéré finalement que c’était plus grave. Alors, dorénavant, Keith Jarrett fait venir son propre matelas. On le sort donc à la hâte de son jet privé puis on se presse de le déposer au Ritz avant qu’il n’arrive. C’est sûr que le Ritz n’a que des matelas de merde (rires) ! C’est un rituel un peu bizarre, mais bon…
Avec lui, la question des retours est toujours délicate aussi. Une fois, il nous a donc demandé s’il pouvait faire venir, à nos frais, son mec de Philadelphie. Il ne voulait pas bosser avec nos ingénieurs du son. Bon, d’accord. Juste avant le show, on lui avait remis le prix Miles Davis, mais il n’a même pas voulu y toucher. C’était trop lourd a priori, il avait peur de se défaire les doigts. C’était un peu spécial, mais pourquoi pas. Le concert débute et assez vite, on sent qu’il y a quelque chose qui cloche. Il s’adresse alors au public : ‘Mouais, merde, je m’entends très mal.’ La chose à ne jamais dire dans une salle. Car une fois que tu as mis ça dans la tête des spectateurs, c’est foutu. Tout le monde a l’impression que le son est pourri. Puis, il enchaîne : ‘Ouais, je ne sais pas pourquoi ces festivals me refilent des prix, ils feraient mieux de me donner une sono décente.’ La vache, c’était son gars qui gérait le son mais il nous foutait ça sur le dos. Là, je me suis levé et j’ai filé voir Manu Chao qu’on programmait le même soir.
Retrouvez la première partie de cet article ici.