Comment t’es-tu ouvert au rap ?
Je suis originaire de banlieue parisienne et j’en ai toujours écouté. Mais c’est à l’adolescence que ça a commencé à prendre de l’importance dans ma vie: tu commences à écouter cette musique, elle représente ce que tu peux vivre ou ce que tu vois dans le quartier, et tu t’y attaches vraiment. C’était notamment l’époque de LIM, qui a été un rappeur hyperimportant pour moi. Violences urbaines, c’était incroyable et fou à la fois : c’était l’époque des émeutes et on écoutait tous ça en boucle dans le 91, à Vigneux. Et il avait eu un disque d’or avec de la musique aussi dure ! Ce qui est intéressant, c’est que le rap de LIM n’est plus le reflet exact de la banlieue d’aujourd’hui, elle a évolué. Quand on était plus jeune, il y avait des quartiers où on n’osait jamais aller, et sa musique voulait dire ça. Aujourd’hui, tu peux aller où tu veux sans problème. Les gens là-bas ont compris, ils ne vont pas te chasser mais plutôt faire leur business de leur côté.
Que faisais-tu de ta vie à ce moment-là ?
Franchement, pas grand-chose, je faisais beaucoup d’intérim. Mais je n’ai jamais été fait pour travailler pour un patron. À chaque fois, ça finissait par mal se passer. Je me suis fait virer de plein de boulots, pas parce que je ne travaillais pas, mais plutôt parce que j’ouvrais ma gueule. La base de tout ça, c’est que je n’étais pas vraiment fait pour le système scolaire, je crois. Je n’ai jamais eu mon brevet ni passé mon bac, par exemple. Du coup, ma vie se résumait à des petits boulots et des déplacements. J’ai vécu deux ans tout seul dans le Sud, où je bossais chez McDo, quelques mois en Bretagne dans une école désaffectée avec des potes… Aux yeux des gens, on était des SDF. Mais pour moi, c’était franchement l’un des meilleurs moments de ma vie.
Comment te retrouves-tu avec un appareil photo entre les mains ?
En rentrant de mes deux années dans le Sud, j’avais mis de l’argent de côté et mon frère, qui faisait du rap, voulait se créer un Myspace et faire quelques photos. Je me suis dit que ça pouvait être marrant d’essayer, alors je me suis acheté un 550D de Canon, pas très cher, et j’ai fait ses photos. Le manager de Tito Prince, qui était un rappeur de mon quartier, a alors vu les clichés et m’a incité à bosser avec d’autres rappeurs. J’ai eu de la chance parce que les choses sont allées assez vite pour moi: trois semaines après avoir commencé la photo, je me retrouvais au Planète Rap de Sexion d’assaut où il y avait Sinik, qui était mon idole. Les gens de mon quartier avaient pété un plomb quand ils l’avaient su (rires). Je n’étais pas fort à l’époque, mais disponible et motivé. Et à force d’entraînement, j’ai progressé. Je me suis fait un petit studio photo dans mon appartement, je bougeais tous les meubles, et je regardais des tutos sur YouTube, des making of de photographes de mode. En fait, j’emmagasinais.
Il paraît que c’est grâce à Oxmo Puccino que tu as eu l’idée de ton livre.
Il a été le déclencheur, oui. J’avais arrêté les jobs alimentaires et je prenais des photos pour quelques rappeurs tout en faisant des shoots pour des marques de vêtements. Je ne roulais pas sur l’or mais je commençais à gagner ma vie.
Parallèlement, je réfléchissais à un projet pour mettre mon travail en valeur, tout en faisant quelque chose sur le hip-hop, parce que c’était mon autre passion. Et il se trouve que j’écoutais beaucoup d’artistes des années 90 et que je voyais que les gamins ne les connaissaient pas du tout, alors qu’ils étaient superimportants. J’ai alors appelé un pote, qui a appelé un pote à lui, qui a contacté Oxmo Puccino pour lui parler du projet. Il était très enthousiaste et on a passé la journée en voiture ensemble, sur Paris. Et cette rencontre-là a été cruciale. Oxmo, c’est un bonhomme, et dans ses paroles, il m’a fait comprendre que si c’était bien fait, ça pouvait avoir une importance. Si tu veux, il m’a un peu conforté dans mon idée en me disant : ‘Vas-y coco, fais-le.’
Tu t’es alors mis à contacter tous les rappeurs français ?
Exactement, je voulais en contacter un maximum. J’ai dressé un arbre généalogique du rap et j’ai essayé de tous les retrouver. Pour pouvoir dresser ma liste, j’ai cherché sur Internet, dans les magazines sur le rap français, les émissions RapLine, et je me suis aussi fié aux artistes eux-mêmes, qui me faisaient leur liste. J’en ai retrouvés pas mal, quand même, mais ça a été une galère totale.
Le livre présente des rappeurs importants pour le milieu mais complètement tombés dans l’anonymat. Comment est-ce que tu arrivais à les convaincre de sortir de leur silence pour poser pour toi ?
Parce que c’est un pan de leur vie, tout simplement. Ils ont laissé une trace. Je leur faisais comprendre qu’être dans mon livre c’était une grande marque de respect, puisque souvent, c’était des rappeurs plus connus qui m’avaient donné leur nom. Ils faisaient partie des gens ayant œuvré pour le hip-hop et ils devaient être dedans, c’est tout.

Tu as senti une différence entre les différentes générations dans la manière de concevoir cette musique ?
Oui, mais ce n’est pas vraiment une histoire d’âge. C’est plus une question de personnalité, je pense. J’ai rencontré des mecs des années 80 qui pouvaient aimer Jul, tout comme j’ai croisé des jeunes rappeurs qui ne pouvaient pas le blairer. Le rap est à l’image de la France et de son peuple, il y a des gens ouverts, et d’autres totalement fermés. C’est pour ça qu’il faut se méfier du ‘c’était mieux avant’. J’ai parlé à beaucoup d’artistes du début des années 80 et ils me disaient qu’à cette époque-là, la conscience n’existait pas tant que ça dans le rap. Ce sont les premiers succès commerciaux des années 90 –Assassin, IAM, NTM– qui ont fait qu’aujourd’hui, on pense qu’il a toujours été politisé. Mais il y a eu des gens avant ! Certains mecs qui rappaient dans les années 80 s’en foutaient de ce qu’ils disaient, aussi bien en France qu’aux États-Unis. Ils ne faisaient que s’amuser.

Tu t’es fait tatouer le nom de ton livre sur ta main gauche. Pourquoi ?
Le livre était commencé depuis un an et demi, et j’avais envie de le faire, ça me paraissait logique. Ce projet reste pour l’instant celui de ma vie en tant que photographe. Que le livre marche ou pas, ça aura été un truc de fou. J’ai voyagé dans des pays, j’ai rencontré quasiment tous les artistes que j’écoutais quand j’étais gosse, et aujourd’hui, je passe du temps avec des artistes que les gens rêveraient de rencontrer une fois dans leur vie, c’est quand même quelque chose. Et je ne suis pas lassé du tout ! Je ne dirais pas que je suis chanceux d’être là où je suis, parce que j’ai travaillé pour ça, mais ça reste une chance en soi.
Lire : Le Visage du rap, de David Delaplace
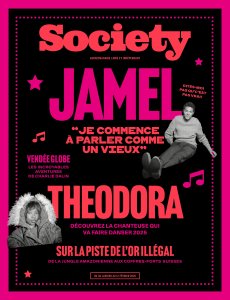
 David Delaplace.
David Delaplace.