Le 16 mars 1975 à 9h30 précises, une vingtaine de types envahissent la Cittadella, le terrain d’entraînement des pros du Parme AC. C’est un dimanche matin, et le champ est libre: l’équipe de Parme, alors en Serie B, joue à l’extérieur un match de championnat à Pescara. Les squatteurs se divisent en deux parties. D’un côté, onze hommes en complet chaussettes-short-maillot du Bologna FC : c’est l’équipe de Pier Paolo Pasolini. De l’autre, onze hippies à la dégaine fantaisiste, maillot arc-en-ciel psychédélique et cheveux longs : c’est l’équipe de Bernardo Bertolucci. Ce match entre les deux cinéastes possède un drôle de nom de code : “Centoventi” (pour Les 120 Journées de Sodome qu’est en train de tourner Pasolini dans la région) contre “Novecento” (pour 1900, le nom de la fresque communiste à laquelle s’attelle alors Bertolucci). C’est un derby, sinon un duel à l’ancienne. Derrière la raison officielle –les 34 ans de Bertolucci– se cache en vérité un méchant différend à aplanir. Bertolucci, ancien assistant réalisateur de Pasolini, a très mal pris la sévère critique que ce dernier a dressée de son film Le Dernier Tango à Paris, sorti trois ans auparavant. Depuis, les deux hommes sont fâchés. Laura Betti, actrice et confidente des deux metteurs en scène, peut bien espérer que la partie réconcilie tout le monde ; des deux côtés, la défaite est interdite. Et tous les coups permis. Si Pasolini joue avec ses copains habituels –simples techniciens, acteurs prolétaires–, Bertolucci s’est arrangé pour débaucher les vedettes du centre de formation de Parme. Dés pipés, score idoine. Novecento met la pâtée à Centoventi. Si le score diffère selon les sources (5-2, 4-2 ou 19-13?), une chose est certaine : Pasolini, excédé de voir ses coéquipiers se gâcher et ses adversaires l’humilier, quitte le terrain avant la fin du match. “Narcissistes!” crie-t-il alors, sans que personne ne comprenne à qui il s’adresse. Peu après, dans la Gazzetta di Parma, Hugo Chessari, l’un des coéquipiers de Pasolini, délivre un genre d’explication générale : “Pasolini n’est pas comme nous autres, à jouer pour s’amuser. Il ne supporte pas de perdre.”
Trente-huit ans plus tard, Bernardo Bertolucci livre le même témoignage : “À un moment, il leur a dit : ‘Vous êtes tous des petits machistes.’ – ‘Pourquoi tu dis ça?’ ai-je demandé. Et lui me répond : ‘Parce qu’aucun ne me passe le ballon.’ Il tenait vraiment beaucoup au football.”
La fièvre bolognaise
Pier Paolo Pasolini malade de football, donc. L’affirmation peut sembler enthousiaste, elle est encore en deçà de la vérité. À la question de savoir ce qu’il aurait aimé devenir s’il n’avait pas eu l’écriture ni le cinéma, l’intellectuel répond dans La Stampa du 4 janvier 1973 du tac au tac : “Un bon footballeur.” Qu’importe l’art, le communisme, la poésie, la religion ou la sexualité. Quand la discussion en vient au football, Pasolini se comporte comme tout tifoso normalement constitué : le foot d’abord, le reste après. Sa passion pour le ballon vient de loin, des premières années de l’enfance. Même si la famille Pasolini part vite s’installer dans le Frioul, au Nord-Est de l’Italie, c’est à Bologne que naît Pier Paolo, en 1922. C’est là aussi qu’il effectuera ses études. L’époque est alors au “grand” Bologna, dont il épouse la cause. “En 1925 et 1929, Bologne gagne le championnat. Puis, de 1936 à 1939, enchaîne trois scudetti d’affilée. On disait de cette équipe qu’elle faisait peur au monde entier. Ces premiers victorieux expliquent que Pasolini soit toujours resté fidèle aux couleurs de Bologne”, éclaire Valerio Piccioni, auteur du livre Quando giocava Pasolini. Dans une interview de 1973 accordée à Giulio Crosti, Pasolini confirme: “Le tifo est une maladie infantile qui dure toute la vie. Lorsque j’habitais à Bologne, je souffrais pour cette équipe. Ça ne m’a jamais quitté. Encore aujourd’hui, je souffre atrocement pour Bologne, toujours.” Devenu adulte, installé à Rome, Pasolini ne rate pas un derby Lazio-Roma, en sort émerveillé à chaque fois, mais rien ne remplace son équipe de
cœur. Dans son livre Vita di un ragazzo di vita, l’acteur Franco Citti raconte un Roma-Bologne du début des années 60 partagé en compagnie de Pasolini : “Nous sommes allés ensemble au stade voir le match. La Roma a battu Bologne 4-1. Il était dans un état pas possible. Il n’aurait jamais réussi à se défaire de sa fièvre pour Bologne.” En 1956, quand le journal Paese Sera lui demande s’il est supporter d’une équipe en particulier, Pasolini se montre une fois encore aussi clair que fougueux : “Tous les dimanches, je vais au Stadio Olimpico, à Rome. Mais je suis un tifoso de l’équipe de Bologne, ma ville natale. En ce qui concerne le tifo en général, je pense qu’il est inséparable du sport.” Loin donc de Pasolini l’idée de regarder le foot avec des pincettes, en esthète. Le foot, ça se vit avec les tripes, dans des endroits glauques, de préférence. “Devant Italie-Yougoslavie, je me suis amusé au point de sauter sur ma chaise et de hurler, comme tous les autres, autour de moi, aux tables réunies, de jeunes ouvriers ou chômeurs, enroués dans les odeurs de friture”, écrit-il en septembre 1960 dans Vie Nuove. Foutez-lui un sifflet dans la bouche et une écharpe autour du cou, Pasolini aura l’air d’un tifoso comme un autre.
Une course brûlante
Son amour du foot va même au-delà de la simple fidélité du supporter. Dès son plus jeune âge, Pasolini passe des après-midi entiers à jouer au ballon, parfois jusqu’à six heures d’affilée. Durant l’enfance, puis l’adolescence, ces matchs constituent les meilleurs moments de sa vie ; même s’il est un élève brillant, Pasolini préfère nettement jouer au foot qu’étudier. En 1940, inscrit à la faculté de lettres de Bologne, il s’ennuie ferme. Dans une missive à son ami d’enfance Franco Farolfi, il écrit alors : “La meilleure chose qui me soit arrivée depuis que je suis ici a été le tournoi de foot interuniversitaire. J’étais capitaine de l’équipe de Lettres. Une chose magnifique. Je suis dans la meilleure forme de ma vie.” Son équipe se classe quatrième, et lui avoue n’attendre qu’une chose : le prochain tournoi étudiant. Des années plus tard, devenu une personnalité en vue de l’Italie intellectuelle, Pasolini n’abandonnera pas ses habitudes. Sur chaque tournage, le rituel est immuable. À midi, foot. À la pause, foot aussi. Et le soir, foot encore. Le terrain est secondaire : ce peut être une pelouse en bon état, un pré mal labouré, la place d’un village ou le plateau de Cinecittà. L’important, c’est d’avoir un ballon à portée de pied. Pasolini y croit tellement qu’en 1966, il met sur pied une équipe officielle, “l’équipe nationale du spectacle”, dans laquelle figurent metteurs en scène, acteurs, et chanteurs. Le cinéaste impose à ses camarades de jouer l’après-midi, afin d’être au maximum de ses capacités –myope, il se considère désavantagé par rapport aux adversaires lorsqu’il doit jouer dans la pénombre. Sur les photos, on est frappé par le sérieux de la chose : l’équipe pose avec le maillot azzurro, l’air concentré et professionnel, comme si elle s’apprêtait à jouer un match officiel. Et quand elle abandonne les couleurs de la Nazionale, c’est pour revêtir la copie du maillot du Brésil de Pelé, rien de moins. Mais sur le terrain, il faut reconnaître que Pasolini assure. Positionné en latéral, milieu ou ailier… gauche, il joue tête levée, dans une posture élégante. Son atout principal est son excellent physique.
“Pasolini ne fumait pas, buvait très peu, faisait beaucoup d’exercice. Par exemple, il nageait beaucoup. C’était un joueur très athlétique”, explique Valerio Piccioni. Ninetto Davoli, amant, acteur favori et mémoire du cinéaste, l’expliquera à de multiples reprises : “Nous l’appelions Stuka à cause de sa façon typique de s’élancer sur l’aile et de sa course brûlante. Dans les matchs que nous jouions, il était presque toujours celui qui était le plus en forme. Jamais un kilo de trop.” De fait, Pasolini jouissait d’un niveau suffisamment élevé pour se permettre de jouer en compagnie de professionnels sans se couvrir de ridicule. Chaque été, à Grado, lieu de villégiature prisé de l’époque, l’intellectuel prend part à des matchs organisés par des joueurs de Serie A. Parmi lesquels Fabio Capello, qui se souvient aujourd’hui d’avoir joué “tous les ans” avec Pasolini. “Lui jouait sur le côté gauche et moi au milieu. Puis, le match terminé, on s’asseyait autour d’une table et on parlait de tout, de foot, de cinéma, de politique.”
Football, peuple et homosexualité
Et pourtant, Pier Paolo Pasolini n’est jamais aussi heureux que lorsqu’il joue avec des sans-grade. Dans Pasolini, la langue du désir, le documentaire que lui ont consacré Ludwig Trovato et Jean-Luc Muracciole, Ninetto Davoli, gamin des bidonvilles, est formel : “Pier Paolo était plus à l’aise à taper dans la balle avec nous qu’à passer des soirées avec les grands intellectuels de l’époque, Moravia, Dacia Maraini, Elsa Morante…” Et pour cause : c’est en grande partie via ces matchs disputés au sein du petit peuple que Pasolini a découvert le prolétariat, imaginé ses personnages et construit son œuvre. À son arrivée à Rome, dans les années 50, Pasolini habite avec sa mère dans le quartier de San Basilio, zone désœuvrée à l’écart de la ville, recouverte de terrains vagues, de barres d’immeubles et autres bidonvilles –de ce quartier sortira plus tard un type comme Paolo Di Canio. “C’est à l’ombre de ces baraques que Pasolini a pris contact avec la réalité romaine de l’époque. Il descendait jouer au foot avec les gamins du coin, dans les bourgades périphériques. Cela lui a permis d’apprendre le langage du peuple, ses préoccupations et ses espoirs”, explique Flaviano Pisanelli, qui a traduit en français le livre de Pasolini Les terrains : écrits sur le sport. En clair,
sans football, peut-être pas de Mamma Roma, d’Accatone, de Ricotta. À travers le calcio, Pasolini embrasse le peuple les bras grands ouverts. Quitte à mal l’étreindre, comme ce jour d’automne 1963 où il monte à Bologne interroger les joueurs de son équipe favorite, pour la plupart issus des quartiers défavorisés, sur le sexe et la politique. Un moment de malaise rarement égalé.
Exaltation du corps, jeunes garçons taciturnes, masculinité exacerbée… Difficile également de ne pas dresser un parallèle entre le football de rue et l’homosexualité de Pasolini. “Le football est un milieu fortement homosexuel, il n’y a pas besoin d’être Freud pour voir ça. En même temps, l’homosexualité y est réprimée. Je suis très sensible à cette répression-là, sous couvert de la famille et de la religion. Ce machisme des politiques représente la mauvaise vision de la masculinité. Lors d’une remise de prix, Pasolini est arrivé couvert de terre après un match, par provocation. Il est évident que pour lui, c’était l’homosexualité qui était au cœur du football”, avance le metteur en scène italien Pippo Delbono. Le corps des jeunes voyous avec lesquels il tape la balle n’a en effet pas l’air de laisser Pasolini insensible. “J’ai remarqué à quel point les jeunes gens du peuple sont supérieurs à ceux de la bourgeoisie. C’est une supériorité essentielle, absolue, qui n’admet aucune réserve –comme la beauté d’un paysage ou la fraîcheur d’un fruit”, ose-t-il ainsi dans son journal de l’époque.
Totti ou Cassano, personnages pasoliniens
Mais qu’importent ces emballements. De la même façon que l’artiste abandonne la littérature et ses codes compliqués pour le cinéma, un art qu’il considère davantage “direct”, le football représente pour lui un langage encore plus simple, le moyen le moins formaliste pour communiquer avec autrui. Le foot, c’est ce moment où Pasolini peut à nouveau tomber en enfance, le contrepoint idéal d’une vie intellectuelle, artistique et politique menée à cent à l’heure. C’est aussi, bien sûr, un objet d’étude sans pareil. “Pasolini se servait du foot pour mener une véritable étude sociale sur l’Italie de l’époque. Le stade était pour lui un lieu pour lire et interpréter les changements culturels et sociaux du pays”, avance Pisanelli. En tant que journaliste, Pasolini écrit de nombreux textes sur le foot, le cyclisme et la boxe, en théoricien brillant : “Le football brésilien est un football de poésie, car fondé sur les buts et le dribble. Le foot européen est un football en prose puisque fondé sur la syntaxe, c’est-à-dire sur le jeu collectif et organisé, le buteur étant un ‘poète réaliste’, qui conclut un travail organisé et collectif”, édicte-t.il en janvier 1971. En 1960, il va jusqu’à couvrir pour Vie Nuove les Jeux olympiques de Rome, avec un plaisir évident, comme lorsqu’il souligne la “vision jeune et colorée du monde réuni dans un défi pacifique, cette évocation du bien et du mal, ébauche d’une conscience plus grande et sereine, celle-là même qui les jugera demain”.
Ce qui intéresse Pasolini au premier chef, c’est l’aspect rituel, grand-messe, du calcio. Tarte à la crème aujourd’hui, cette théorie est plutôt avant-gardiste à la fin des années 60, un moment où les intellectuels refusent d’accorder toute sorte d’intérêt au sport. “Le football est la dernière représentation sacrée de notre temps. C’est un rite dans le fond, même s’il est évasion. Si d’autres représentations sacrées sont en déclin, le football est la seule qui nous reste. Le football est le spectacle qui a remplacé le théâtre. Le cinéma n’a pas pu le remplacer, le football, oui. Parce que le théâtre est un rapport entre un public en chair et en os et des personnages en chair et en os qui agissent sur la scène. Tandis que le cinéma est un rapport entre un public en chair et en os et un écran, des ombres. Au contraire, le football est à nouveau un spectacle dans lequel un monde réel, de chair, celui des gradins du stade, se confronte avec des protagonistes réels, les athlètes sur le terrain, qui bougent et se comportent selon un rituel précis”, déclare-t-il dans les colonnes de L’Europeo le 31 décembre 1970. Son deuxième angle d’étude est plus critique. Durant ces années décisives, Pasolini voit la société italienne se transformer, et le football la suivre –à moins que ce ne soit l’inverse. Le miracle économique, la médiatisation, le spectacle : le football est une bonne symbolique de ces évolutions. “Pasolini s’est intéressé à la transformation du sport pour le sport en sport comme forme de spectacle”, juge Flaviano Pisanelli. “Dans les années 70, il se penche notamment sur la starification des sportifs, un phénomène nouveau à l’époque. Il met alors au point un archétype, qu’il nomme Walter ou Pierre. Généralement issu des banlieues, c’est un jeune sous-prolétaire qui se retrouve du jour au lendemain star du sport. Il s’inscrit alors dans un processus de spectacularisation qui le prive de son caractère personnel pour le jeter lui et sa culture dans la bourgeoisie moyenne. Cette dilution de la culture minoritaire dans la culture majoritaire, Pasolini la considère comme un génocide culturel. Et le foot est un de ses vecteurs”, explique l’universitaire. Totti ou Cassano, aujourd’hui, auraient sans nul doute intéressé Pasolini : ce sont les Walter et les Pierre des années 2000. Du reste, la question se pose : comment Pier Paolo Pasolini, s’il avait vécu plus longtemps, aurait-il pensé le football italien actuel, ses magouilles, son dopage, ses morts ? Comme une dérive logique et irréversible, sans doute. Mais au moins aurait-il parlé. “Lorsque j’ai interviewé Ettore Scola, il m’a avoué que la mort de Pasolini avait tué le monde intellectuel italien. Pasolini était une vigie : il empêchait les autres de s’endormir”, confie Jean-Luc Muracciole. De telle sorte que la nuit du 2 novembre 1975, lorsque Pasolini meurt assassiné sur un terrain de foot de fortune, près des plages populaires d’Ostie, c’est une bonne part du football de “périphérie”, comme l’appelle Valerio Piccioni, qui disparaît avec lui. Le lendemain du crime, le journal Stadio publie une dépêche qui dit ceci: “Pier Paolo Pasolini, assassiné la nuit dernière par un garçon de 17 ans, aurait dû jouer au stade de Favorita comme ailier gauche dans l’équipe des gens du spectacle qui, à l’initiative de la Roma Actors Organisation, rencontre depuis quelque temps dans plusieurs tournées une formation faite de vieilles gloires du football.” Le match ne se tiendra évidemment pas, les suivants non plus. À la place, dans la décennie qui suivit, le football italien connut le scandale du Totonero, une victoire en coupe du monde, l’arrivée de Berlusconi à la tête du Milan AC, et le Heysel. Pasolini mort, les années 80 pouvaient arriver plus vite que prévu.
Article publié dans le hors-série So Foot “Best of culture” (décembre 2013).
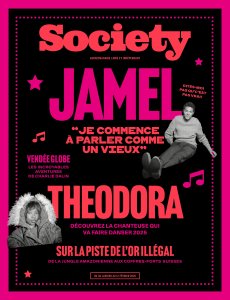
 Qui dit foot du dimanche dit habits du dimanche.
Qui dit foot du dimanche dit habits du dimanche.