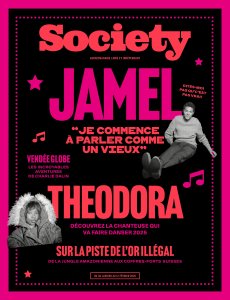Kohh, le “Kanye West de l’Asie”

Entre soirées de la Fashion Week, concerts et interviews, Kohh est très, très pris. C’est d’ailleurs très, très en retard qu’il pénètre dans la cave du Carmen, au 34 rue Duperré. Il commande un rhum-coca, puis dévoile son personnage, sa passion pour l’art, son histoire. Yūki Chiba –de son vrai nom– n’a que 3 ans quand son père se suicide en sautant d’un immeuble. Sa mère tombe dans la dépression et devient une toxicomane, accro à la méthamphétamine. Ses grands-parents l’accueillent chez eux et il grandit dans les à Oji, un quartier de Tokyo, avant de devenir Kohh, artiste incompris, blasé, et instable. “Je me fais appeler Kohh, en hommage à mon père. C’est son nom de famille.” De son enfance, il ne dit pas grand-chose : “Je sais pas trop comment je passais mon temps. J’ai pas forcément d’événements marquants, je traînais avec mes potes, on taguait des murs et on volait des trucs. J’ai volé des fringues, des vélos et j’ai même volé de l’argent à ma grand-mère”, dit-il en riant.
“Je sais pas, je m’en fous”
Kohh ne cite personne qui l’inspire, car pour lui, l’inspiration est partout. “Dans quelque chose qui se passe dans la vie des autres, dans ma vie, dans tout.” Il a quand même certaines idoles, comme “Kurt Cobain”: “J’aime le hard rock. J’y connais pas grand-chose, mais Nirvana, les Sex Pistols, Slipknot, etc. j’aime beaucoup. Le seul rappeur avec qui j’aimerais collaborer, c’est Kanye West.” D’ailleurs, son manager l’affirme : “C’est le Kanye West de l’Asie. Quand il fait une tournée là-bas, il lui faut une quantité de managers, il est partout à la télé, tout le monde le connaît. Ici, c’est différent, mais prions pour que ça puisse devenir la même chose.” Autre chose qui lui permet de créer : le LSD. “La première fois que j’ai pris de la drogue, c’était avec ma mère, elle m’a fait fumer mon premier joint, j’avais 14 ans. C’est peut-être pas très drôle, mais moi ça me fait rire.” Kohh rit beaucoup. Quand il n’a pas l’air absent. Car la moitié du temps, il ne répond même pas aux questions qu’on lui pose. Son entourage affirme que “soit il ne sait pas, soit il en a juste rien à foutre et il a la flemme de répondre”.
Ce je-m’en-foutisme, entre timidité et arrogance, fait la particularité de Kohh. Et c’est cette insolence qui attire son public. Sa musique est pleine de références, d’images, de prises de position, mais en dehors de la scène, il ne “sai[t] pas”. Ce qu’il a fait évoluer au Japon ? La scène, il en est sûr. Mais la politique, comme un gimmick, il n’en a “rien à foutre”.
Art et mode
Kohh, ne veut pas de l’étiquette “rappeur”. “Je suis un artiste.” Grand amateur de Marcel Duchamp, couvert de tatouages, il peint, il sculpte : “Avant de rapper, je voulais être tatoueur. J’ai fait mon premier tatouage tout seul quand j’avais 14 ans, je me suis fait celui-là sur la jambe”,
montre-t-il. Ce qu’il aime le plus, c’est l’art contemporain. Il cite Picasso, le MOMA et le Centre Pompidou. “Je ne suis pas encore allé au Palais de Tokyo, mais j’irai.” Il expose même lui-même et dit ne pas faire de différence entre la musique, l’art et la mode. “Ce sont des hobbies pour moi, pas mon boulot.”
Aujourd’hui, Kohh est devenu le symbole de l’underground japonais. Sam Tiba, Club Cheval, ainsi que Jeremy Chatelain et Chassol se sont intéressés à lui dernièrement et certains de ses sons ont été enregistrés à Paris, l’une des destinations favorites de ce féru de voyages. Kohh s’y entoure de designers et assiste à des défilés de mode. Ce dont il parle dans son dernier single : Paris (remixé par Sam Tiba de Club Cheval). Proche du designer Hiromichi Ochiai, il a même défilé lui-même pour sa marque, Facetasm. “J’aime Paris parce que c’est traditionnel, explique-t-il. J’aime bien l’architecture.” En revanche, ce qu’il n’aime pas, c’est le bruit, les gens et surtout Châtelet : “Y a trop de monde, trop de jeunes, je peux pas me reposer. Je préfère traîner dans des chambres avec mes potes ou dans des parcs vides.” L’air absent.
C’est quoi ce cirque ?

Depuis leur installation au square Parodi en juin 2015, Délia et Alexandre, matriarche et patriarche de la famille Romanès, ainsi que les quelque 40 personnes qui composent la troupe, ont été confrontés régulièrement à des actes de vandalisme et d’intimidation, autrement plus graves que les accusations dont ils font l’objet – comme si l’on était dans une farce ou un épisode de Alf, ils dévoreraient les chatons. Au milieu des caravanes, “repeintes en vert, car on [les]
accusait de ne pas [s’] intégrer dans le paysage quand elles étaient rouge et doré« , une petite table derrière les palissades. Alexandre Romanès, descendant de la famille Bouglione, ancien dresseur de fauves et poète multi-publié chez Gallimard, sirote un jus de pomme, et expose longuement les agressions dont son cirque a été victime. Les « loubards », comme il les appelle, « venaient ici en bande, cassaient les fenêtres, arrachaient les installations électriques. Ils ont volé beaucoup de choses. Ils ont pris les costumes, les instruments, même des vieilles photos ». D’un côté, les groupes de vandales qui venaient parfois « à plus de 150 » ; de l’autre, des associations qui attaquent la famille Romanès en justice en réclamant leur départ, sous divers motifs. Pourtant, selon Alexandre, « il y a toujours eu un cirque ici. Il y a 100 ans, un cirque de marionnettes s’est installé square Parodi et depuis, de nombreux cirques se sont succédé. C’est le mot tzigane qui dérange. » Face à ces accusations, la Mairie de Paris est « le plus grand soutien de la famille Romanès ». C’est « grâce à elle qu’ont pu se faire connaître au mieux les cultures tziganes et gitanes », ajoute Délia.
Les violences sont en baisse, les finances aussi
Dans ce magma digne d’un mauvais western entre alors en scène une horde de vengeurs masqués, des Zorro du XXIe siècle : les « contre-manifestants ». Ils émergent courant décembre et s’attribuent le rôle de défenseurs des Romanès. Alexandre ne connaît pas leurs identités, comme il ignore sciemment celles des crânes rasés. Il n’a jamais voulu savoir ni intervenir, même quand des dizaines d’hommes faisaient état de siège devant son cirque, de peur que les choses ne dérapent, que quelqu’un soit blessé, voire pire. « C’étaient des jeunes, ces contre-manifestants, et la première fois qu’ils sont arrivés, ils étaient nombreux, je me suis dit: ‘Tiens, encore un autre groupe.’ Ils m’ont alors dit qu’ils venaient « pour eux ». J’ai compris qu’ils étaient là pour nous défendre. Finalement, ça a fini par se tasser. »
Les violences ont cessé mais les dégâts financiers sont tels que Délia, surnommée « la Terrible », et qui pourtant insiste pour nous offrir du chocolat au citron, a dû
lancer en mars dernier un appel aux dons. Le montant des dommages, lui, est plus terrible que celle qui lance le cri d’alarme : 60 000 euros. Déjà 43 000 ont été récoltés, mais cela ne suffit pas. « Les attentats nous ont touchés, comme les autres salles de spectacle. Tout l’hiver, nous remplissions à peine un tiers de chapiteau. Impossible de faire vivre 40 personnes avec ça. »
Si son mari fait preuve de sang-froid, la Terrible tremble. « J’ai mis tous les papiers du tribunal au frigo. Je ne peux plus les voir. On leur dit, à tous ces gens : ‘Venez, venez voir de quoi vous avez peur !’ Pour moi, culture égale humanité. Vous avez peur de gens qui dansent et qui chantent ! » Elle est assise au soleil, et la conversation dévie vers l’actualité, qu’elle ne comprend pas toujours, comme Nuit Debout. Elle dit qu’elle y serait allée avec ses musiciens, place de la République, et elle aurait fait danser tout le monde, « c’est quand même mieux pour faire la révolution, non ? » Delia explique qu’elle a peur, parfois, qu’elle a mis des plaques de bois dans sa caravane pour se protéger. Que son cirque est en grand danger si l’argent ne rentre pas rapidement. Le soleil fait fondre la glace au chocolat qu’elle déguste pendant qu’elle explique que « le bonheur, c’est un état d’esprit : tu vois moi je suis dans la merde, et je mange une glace ».
Des soutiens privés et publics
La suite ? « On est des nomades. On est allés jusqu’à Shanghai, jusqu’en Russie. On va peut-être partir en Italie. On est un petit village à côté de la ville. » Quitter la France où, au milieu des attaques, ils ont reçu de nombreux soutiens de donateurs anonymes mais aussi de personnalités. Il y a Agnès Jaoui, qui
« n’arrivait même pas à croire à ces attaques d’un autre âge contre un cirque poétique, enchanteur et drôle ». Il y a Emmanuelle Bercot, qui a connu la famille Romanès lorsqu’elle était étudiante à la FEMIS, et a fait de cette rencontre un court-métrage : « Leurs personnalités à eux deux m’ont vraiment attirée. Quand ils étaient place de Clichy, ils étaient complètement intégrés, il n’y avait aucun problème avec le voisinage. Ils préparent leur numéro, s’occupent de leurs enfants et font de la musique… C’est plutôt un gain de vie et de joie dans le quartier ! » Et Jack Lang, qui s’insurge : « Ils incarnent une tradition, un art de vivre, une générosité, ce sont des gens bourrés de talent, qui apportent de la vie, qui apportent du mouvement. Je ne comprends pas qu’on les traite avec cette désinvolture et ce mépris. On ne peut pas rester les bras croisés et les abandonner à cette situation, on ne peut pas laisser des artistes comme ceux-là, qui incarnent un art de vivre, un art de jouer, dans un face-à-face avec des associations qui veulent leur peau. »
Aujourd’hui, Alexandre et Délia veulent monter un centre artistique tzigane, pour « montrer ce qu’il y a dans les camps, ce que l’on ne voit jamais ». Toujours le même obstacle : « Ce serait un centre itinérant, mais pour cela, il faut des moyens, et on ne les a pas. C’est très pénible, même au niveau administratif. Il suffit qu’il y ait une personne du Front national dans le bureau de la ville où l’on veut jouer et elle nous bloque.« Récemment, un homme a demandé à Alexandre quand il comptait reprendre la route et quitter le square Parodi, ce qu’il attendait avec impatience. L’ancien dresseur de fauves lui a simplement dit : « Je sais comment vous pensez. Vous pensez qu’il n’y a que vous qui avez le droit de vivre. » L’homme n’a pas su quoi répondre.
Absinthe, présente !

Automne dernier, dans cette jolie région vallonnée du Jura. Juste à la sortie de la gare TGV de Frasne, en pleine campagne, une scène de joyeux lurons en train de picoler, intitulée La Fée verte, a été reconstituée en papier mâché. Ici, tout est vert. Les croix de pharmacie comme les pancartes de la E23 qui rejoint Pontarlier. En ce week-end de début octobre, on vient d’ailleurs célébrer la couleur. Car si beaucoup pratiquent la région pour le trail, d’autres y courent un seul mythe. Ici, en effet, est née et morte l’absinthe ! Et chaque année, des Absinthiades attirent dans ce patelin de 18 000 habitants quelques centaines de fans du monde entier. La dernière édition était d’ailleurs particulièrement incontournable : on y célébrait le centenaire de la prohibition de l’alcool fantasmagorique.
Née dans le canton suisse du Val-de-Travers en 1805, la production d’absinthe passe rapidement la frontière française. Pernod installe à Pontarlier la première distillerie. “Ici, il y a eu jusqu’à 27 des usines ; à l’époque, on comptait un bar pour 60 habitants. On en vendait jusqu’au Vietnam, de l’absinthe !” se souvient un vieux Pontissalien. Au XIXe siècle, la fée verte rencontre effectivement un succès fulgurant, avec les dégâts qu’on lui connaît, magnifiquement relatés par Baudelaire et Rimbaud. Elle se répand au-delà des frontières, rend fous les grands esprits imbibés de versions frelatées et, surtout, nuit beaucoup au lobby viticole. En 1915, la production de l’absinthe est tout bonnement interdite. Le mythe de la fée est né. Autour de la légende, de nouveaux mots apparaissent –artémisophile, absintheur, absinthologue– et des tribus d’accros à la verte, gardiennes de la légende, se mettent à éclore dans le monde entier.
Moi, Nico, absinthologue, suisse et trans
Nicodiane, chanteuse et employée de mairie, a “pris le virus” dans les années 2000. “C’est une passion. Je l’aime ! J’étais un mec mal dans sa peau et l’absinthe a été un exutoire.” Figure du Val-de-Travers, elle est la Suisse la plus de traviole que l’on puisse rencontrer au rendez-vous annuel de Pontarlier : “J’ai la particularité d’être la seule trans absinthologue ! Je crois que je suis assez unique.” Nico, Diane, Nicolay… Les gens ne savent pas trop comment appeler ce membre incontournable du jury des Absinthiades, dont faisait aussi partie en 2015 Miss
Jura. Nicodiane est la mémoire de la verte au Val-de-Travers. Elle a connu “le Tub”, cet ambulancier qui trafiquait l’alcool, “avec des entrées chez Picasso et au Château (du prince Rainier, ndlr)” ; elle a envoyé par la poste aux États-Unis pas mal de litres produits sous le manteau, estampillés “aromathérapie ; et elle a chanté à Paris au Lapin Agile grâce à un cadeau de deux bouteilles de clandestines. Car malgré son interdiction en 1915, la production d’absinthe ne s’est en fait jamais arrêtée. Des hectolitres de versions clandé se sont évaporés de tous les alambics de la région. “Cent mille litres par an pour 12 000 habitants, y avait pas qu’ici que ça se consommait à l’apéro”, observe, perfide, Nico. Pas mieux côté français. “Ça se passait dans les cuisines, se souvient encore Philippe Chapon, 60 ans. T’apportais ton litre d’alcool et tu repartais avec ton litre de… Même le fils du juge venait dans la maison peinte en vert. Y en a qui se sont payé leur baraque avec ça. Mais aujourd’hui, avec le 0,5 (en grammes, la limite d’alcool par litre de sang autorisée au volant, ndlr), c’est plus pareil. Enfin, y en a encore sous le manteau”, assure le vice-président du Pays de l’Absinthe. Et de sortir d’ailleurs son propre tord-boyaux destiné aux seuls habitués capables d’avaler du 70°. “Il paraît qu’à partir de 50 verres, ça attaque le cerveau. Alors moi j’m’entraîne, j’m’arrête au 49e.”
Shit, Pont et Game of Thrones
À l’entrée de Pontarlier, le bar de la Rotonde est tagué en grand sur le mur de façade comme pour rester dans le coup. Le formica et le magnifique Bonzini demeurent mais d’absinthe, point. “On n’en vend pas du tout. C’est trop cher au verre”, regrette “la Michèle”. Effectivement, entre 4€ le verre et 1,60€ pour “le Pont”, l’anisé sans absinthe qui s’est substitué en 1921 à l’interdit, les locaux ont choisi. Même constat au bar de La Poste du centre-ville : l’absinthe c’est pour les touristes ! Même les gambas sont désormais flambées au Pontarlier. Le samedi soir, au Monte Cristo 3, la boîte de nuit de Goux-les-Usiers ouverte en pleine cambrousse en banlieue pontissalienne, dans une vieille ferme au-dessus d’une fromagerie, c’est ambiance Vodka Orloff et Suze tonic. Dehors, des jeunes trop jeunes ont été retoqués du MC3. “Tu veux pas faire un reportage sur le shit, plutôt ? Parce que ici, on en consomme plus que de l’absinthe”, se marrent les ados à capuche en avalant un kebab sauce algérienne. L’un des garçons avoue en avoir essayé deux, trois fois. Et la fille des Vosges qui a fait 30 kilomètres pour
venir danser n’a de rapport à l’absinthe que la fontaine qui trône depuis toujours dans le placard chez ses parents. Pontarlier a beau garder une pharmacie de l’Espérance, le temps où la distillation enrichissait la ville est très loin derrière.
Mais les artémisophiles, eux, y croient encore. Restés coincés dans le passé, ils ont quelque peu loupé le retour vers le futur de l’absinthe. Hauts de forme, chemises à jabot, queues de pie pour les hommes, leggings simili cuir pour les filles, deux couples rétrofuturistes surgissent de nulle part dans la chapelle des Annonciades. “Nous sommes quatre des huit Steam Punks de Lucerne, déclame avec un fort accent germanique le professor Wolf Wolfenstein. Nous vivons comme à l’époque victorienne, nous buvons du thé, de la bière et de l’absinthe, mais pas en cocktail car dans notre temps, il n’y avait que des pure drinks.” Le mythe de l’alcool qui rend fou, renforcé par la prohibition, a ainsi forgé autour de l’absinthe de sacrées personnalités. De l’Allemagne au Japon en passant par la Tchéquie ou l’Angleterre, l’abstinence a provoqué le désir. Aux États-Unis, une forte communauté d’absintheurs s’est montée autour de Becky Head dans les années 2000. Figure rousse comme extraite de Game of Thrones, la dame qui est tombée dans la Green Fairy en 95, se présente comme la “feu mère” du phalanstère ricain. Instigatrice de feeverte.net, elle a fédéré dans le nouveau monde bon nombre d’adeptes de l’alcool français dont beaucoup distillaient déjà dans leur jardin. Aujourd’hui retirée du milieu, Becky reste fascinée par l’univers d’histoire et de poésie qui entoure la verte. Son homme, grand squelette sympathique, avoue à voix basse distiller dans leur garage. Pour qui ? “Juste pour moi”, glisse-t-il en roulant des yeux.
Marc Thuillier, “artémisophile convaincu”, comme il se définit lui-même, réussit chaque année à attirer un bel échantillonnage de ces freaks en Franche-Comté. Pour le gourou français, cette fascination collective est engendrée par “l’interdiction, le rituel et l’histoire. Sans cela, on aurait tout oublié et l’absinthe ne serait ni plus ni moins que du pastis”.
Esprit 1805, es-tu là ?
Johnny, logo à l’aigle de la maison du “Pont” tatoué dans le cou, a le profil type de l’absintheur : quadra masculin, biker quand il n’est pas sapé gothique. Il fouine sur le net à la recherche de flacons rares, collectionne les bouteilles et achète, en s’associant à d’autres acuéreurs, les élixirs les plus chers. Les vieilles absinthes font partie des alcools les plus cotés au monde ; les “pré ban” d’avant 1915, restent elles intouchables. “Fantasmée, légendaire, l’absinthe c’est pas le cognac ou le guignolet des familles”, observe Karim Karroum, caviste d’alcools rares à Limoges. Il n’y a dans ce monde que des perchés liés à la légende mais qui ont une grande curiosité.” Sur de minuscules cahiers, Takashi Mizuno entrepose à la mine de crayon d’énigmatiques et microscopiques caractères. Depuis plusieurs jours, l’importateur nippon sillonne la vallée avec son anglais très approximatif. Derrière de minces lunettes et une grande cape, un look à la Harry Potter et des fioles plein le sac qu’il veut échanger avec tous, cet absintheur du Soleil Levant est à la recherche de la perle rare à rapporter à Osaka. Là-bas, dans la dizaine de bars spécialisés, l’absinthe, qu’il trouve “very nice”, se boit juste avec peu d’eau, à la façon des anciens à Pontarlier.
Toute cette absintherie semble d’autant plus étrange que l’absinthe existe à nouveau pour de vrai. En France, la distillation a été de nouveau autorisée en 1988 et une loi a, en 2011, définitivement mis fin à l’interdiction de 1915. Pernod Ricard, producteur historique, a replanté un champ d’absinthe au bout du bar de La Rotonde, et relancé une production presque à l’identique à Thuir. À Pontarlier, en Suisse et en Europe, d’autres producteurs ont suivi le “category captain”. Des Coquette, Entêtée, Interdite, Clandestine, glissant entre 45 et 68 degrés, sont sorties au grand jour. La nouvelle Pernod Absinthe, estampillée 1805, comme un clin d’œil, est elle sensiblement la même que celle que buvait Rimbaud. “Nous sommes repartis sur la recette d’origine à partir d’échantillons de bouteilles de 1913, explique fièrement Claire Thémé, directrice R&D chez Pernod, et après des distillations à répétition, on a obtenu le meilleur profil. On a l’esprit de
l’époque.” Pour moderniser l’histoire, le marketing Pernod met le paquet sur le monde du cocktail : fontaines à absinthe designées Pierre Gonalons, partenariat Kitsuné et bar référent à Ibiza, le decorum contemporain doit dépoussiérer la légende. “En slush (granité), en flip (absinthe, café, œuf, lait) ou seule, j’en vends des caisses”, s’amuse Charles Vexenat qui, dans son bar d’Ibiza, le 1805, a inventé le cocktail au concombre, booster révolutionnaire de la fée. Déjà rentré au panthéon des classiques contemporains, le Green Beast, citronné, frais et facile à boire, “classé Supreme champion au Cocktail Challenge 2015 de Londres, a permis de casser les idées reçues”, nargue Mathieu Sabbagh, directeur de la communication externe France et international chez Pernod. Effectivement, depuis quatre ans, aucune folie n’a été répertoriée et les bars ont embrayé. Certains se sont spécialisés, comme le Lulu White, qui tire une ligne entre Pigalle et la Nouvelle avec une dizaine d’absinthes “plus intéressantes et plus complexes que le pastis”. D’autres, rassurés de retrouver derrière le comptoir un ingrédient majeur, jouent avec les vieilles recettes du Savoy Cocktail Book de 1930. “On a plaisir à la faire redécouvrir, se ravit Maxime Hoerth, barman du Bristol. C’est comme si l’on avait repris la blanquette ou le cassoulet et qu’on les twistait à notre manière.” Avec l’ argument imparable de Mathieu Sabbagh contre la loi Evin, l’absinthe a de beaux jours devant elle : “Dans une consommation responsable, tu te mets un ou deux bons cocktails Pernod absinthe qui te donnent le kick et après, t’es nickel pour la soirée.” Le Sazerac revient et l’apéro à la française cartonne. Le rituel –fascinant goutte à goutte avant le fatal louchissement qui trouble l’eau–, le sentiment de braver un interdit que l’on croit toujours d’actualité, le mystère de la plante qui rend fou, l’histoire, tout ce folklore fascine toujours. À l’étranger, même carton. On remet les pendules à l’heure. Vaclav, Ondrej, Vit et Réza ont fait 1 200 kilomètres de Brno à Pontarlier. Douze heures de voyage pour se plonger dans le berceau de l’élixir que la Tchéquie est la seule à n’avoir jamais cessé de produire. Sa Kyle est d’ailleurs classée par les amateurs comme “une des bonnes”. Là bas, sans embargo, l’absinthe a coulé à flots. “On a fait plein de merdes comme l’absinthe à la beuh et on a inventé le burning fire bohémien», le rituel de l’absinthe du troisième millénaire qui consiste à flamber un sucre imbibé du spiritueux. Du coup, le pays s’est pris, il y a trois ans, une prohibition de quelques mois.
Avec ses homologues européens, Mathieu Sabbagh ne désespère pas de réussir à mettre tous les distillateurs d’accord sur une définition de l’absinthe, qui pourrait surtout booster, avec cet anisé haut de gamme, le secteur du pastis dont les chiffres d’évolution plongent dangereusement dans le rouge.
Les insoumis
 Quand la France est insoumise, elle le dit ET elle l’écrit.
Quand la France est insoumise, elle le dit ET elle l’écrit.“Je ne voterai plus jamais pour lui, ça c’est certain. Jamais.” Dans les rangs, le ton est donné : les déçus vis-à-vis de François Hollande sont nombreux. Il faut dire qu’en 2012, beaucoup d’entre eux avaient accordé leur voix au candidat socialiste dans l’espoir d’un renouveau politique. Mais aujourd’hui, le constat est amer.
“On est loin de ce qui nous avait été promis en 2012, se désole Jacques, un retraité de 62 ans. ‘Mon ennemi c’est la finance’, ça paraît tellement loin aujourd’hui !” Jean-Luc Mélenchon lui non plus n’est pas très tendre avec le président de la République, qu’il qualifie de “petit monsieur qui vous préside et qui vous a déjà tant menti”, devant une foule acquise à cette cause. Car parmi tous ces Français “insoumis”, la “trahison” n’a toujours pas été digérée. “J’avais voté contre Sarkozy, donc effectivement on peut dire que j’avais voté pour Hollande, confie Magali, une chômeuse parisienne de 49 ans. Aujourd’hui, c’est plus que du regret que je ressens… Je suis frustrée et je me sens trahie.”
Le changement, ce serait maintenant finalement ? Dimanche 5 juin, il était en tout cas dans toutes les têtes. Comme un impératif face à une situation qui ne peut plus durer. “Il y a urgence, pose Jacques. On se sent abandonnés. Je suis là pour défendre l’avenir, l’avenir de mes enfants, l’avenir de mes petits-enfants… Et me battre contre tous ces traitres du Parti socialiste.” Le discours anti-Hollande et anti-gouvernement tenu par Mélenchon a semble-t-il largement trouvé son public. Malgré tout, certains restent sceptiques : “Il ne faut pas oublier de rester dans le concret, prévient Étienne, étudiant en droit. Il ne faut pas se limiter à une critique de la politique du gouvernement, il faut proposer des alternatives.”
Une insoumission multiple
“On voit émerger des insoumis d’horizons très variés”, remarque Adeline, 59 ans, venue de Bruxelles exprès pour l’événement. En effet, ce qui semble caractériser cette France insoumise, c’est sa diversité. Rudy, un parisien de 31 ans, tente d’expliquer ce qui rassemble tous ces gens : “En gros c’est la France, dans toute sa diversité, avec ses conditions de travail, avec ses galères, ses points positifs aussi, et
avec sa volonté de vivre ensemble dignement.” D’un côté, on retrouve les soutiens historiques de Mélenchon, ceux qui sont là depuis le début. “Je l’ai toujours suivi, explique Jacques. Depuis qu’il a claqué la porte du Parti socialiste il y a une dizaine d’années, je suis derrière lui.” De l’autre, on retrouve ceux qui se sont laissés convaincre récemment ou ceux qui ne sont pas encore complètement sûrs d’eux pour 2017. “Mon vote n’est pas encore arrêté, avoue Magali. Ma seule certitude, c’est que je ne voterai pas Hollande.”
Mais concrètement, contre quoi se bat-on quand on est un Français insoumis ? Là, les réponses sont moins évidentes. “Contre le Front national” pour les uns, “contre le système” pour d’autres, ou encore “contre les inégalités”… On ne sait plus vraiment. Rudy tente pourtant d’apporter une réponse claire : “On est insoumis par rapport aux mauvais salaires, par rapport aux conditions de travail qui sont de plus en plus dures, par rapport aux inégalités qui sont de plus en plus criantes, par rapport aux salopards d’en haut qui se mettent des millions dans les poches tandis que pour nous tous c’est assez difficile. Donc on a envie de dire ‘non, ça suffit comme ça.’ Mélenchon, c’est notre porte-drapeau. »
“Cette fois, c’est la bonne”
Pour Adeline, pas de doute : “Oui, cette fois, c’est la bonne. Sa candidature vient à point nommé, vu tout ce qui se passe dans le pays, les tensions qui montent…” En effet, la campagne semble plus facile à appréhender que celle de 2012 pour Mélenchon, lui qui est crédité de 14 % des intentions de vote (TNS Sofres), soit plus que les 11,11 % obtenus à l’élection de 2012. Pourtant, la voie n’est pas totalement dégagée pour l’ancien socialiste : une partie de la gauche, et notamment les communistes, ne comprend pas son lancement en solitaire dans la course à la présidentielle. Pierre Laurent, réélu secrétaire national du Parti communiste le jour-même, a condamné la décision de Mélenchon de partir seul à l’aventure. Il y avait pourtant dans la foule place Stalingrad, ce jour-là, des membres du PCF venus soutenir le candidat.
Pourtant, à l’heure actuelle, Jean-Luc Mélenchon n’a récolté qu’une cent-cinquantaine de signatures d’élus sur les 500 nécessaires pour se présenter à l’élection présidentielle. La route est encore longue.
Uplust, le réseau social qui met tout le monde à nu

Il est à l’image des jeunes entrepreneurs dont la France raffole. Quentin Lechemia, 25 ans, lyonnais, diplômé d’une école de commerce, a déjà plusieurs start-up à son actif. Avec Uplust, il a poussé ses ambitions un peu plus loin : se faire une place dans le très fermé monde du X.
L’aventure commence en 2013. “Je me suis dit: ‘C’est quand même trop con qu’une fille qui a envie de montrer ses seins sur Instagram ne puisse pas le faire.’ Et je me suis tout simplement mis en tête de créer un Instagram pour adultes, sans censure.” En seulement quatre mois, lui et son équipe codent l’intégralité du site.
La machine est lancée. Quinze mille fans se préabonnent, avant même l’ouverture de la plateforme, dont le nom, à l’époque, ne laisse aucune place au doute : Pornostagram. “C’était tellement facile de sortir un site comme ça, avec un nom comme ça. On n’avait même pas besoin d’expliquer le concept.” Mais un an après, Instagram négocie avec Quentin un changement de nom. “Ça s’est fait sans douleur.” Au contraire, Quentin se réjouit. C’est l’occasion de retirer l’étiquette pornographique. Après un sondage mené auprès des internautes, c’est le nom Uplust qui l’emporte à 73,8 % contre Hurrycam. Pornostagram devient donc Uplust. Up pour upload, lust pour désir sexuel. Un changement de nom qui a d’ailleurs particulièrement bien marché aux États-Unis. “Porn, c’est très latin comme racine, explique Quentin Lechemia. Les Américains, ils tapent pas “porn”. Uplust, c’est plus catchy, le site a pris une nouvelle dimension.” Pas étonnant que le patron s’intéresse particulièrement aux mœurs outre-Atlantique : les États-Unis représentent le premier marché pour Uplust. Suivis de près par le Mexique, puis le Brésil. La France se classe tranquillement 4e, Marseille tout en haut du top des villes de l’Hexagone.
Uplust en 2016, c’est plus de 400 000 membres actifs dans le monde entier, trois millions de photos affichées par jour, 25 % de filles, 95 % d’amateurs. “Sur Uplust, c’est vraiment monsieur et madame Tout-le-monde”, se réjouit Quentin. Monsieur et madame tout nus, surtout.
Hashtag fessier
“Le jour, je m’occupe d’enfants au travail ; le soir, je m’occupe d’adultes sur Uplust.” Il est 18h. Margaux, 23 ans, inscrite depuis 2013, et déjà plus de 7 000 followers, sort du travail. Trente minutes plus tard, elle est connectée. Comme on checke ses mails, Margaux, elle, prend connaissance de ses notifications. Puis, son copain la photographie. Un cliché qui finira dans quelques heures sur le réseau. En espérant qu’il plaise.
Si le réseau social joue sur les codes d’Instagram, il surfe aussi sur les phénomènes de société en parodiant Candy Crush avec sa version sexy, Booty Crush, ou encore en proposant Game of Boobs, un jeu qui consiste à deviner à quelle actrice de Game of Thrones appartient la paire de seins qui s’affiche à l’écran. Les utilisatrices peuvent aussi faire des #dediboobs à d’autres anonymes, et/ou tenter de remporter des challenges hebdomadaires dont les catégories s’affichent sous forme de hashtags explicites : #whippedcream, #bed, #ass…
C’est simple, Uplust fonctionne comme un réseau social classique où chacun cherche à faire sa place et à se divertir en mettant ses photos en ligne, sauf que la communauté est anonyme. “La plupart des personnes s’inscrivent avec une adresse mail créée juste pour Uplust”, explique Quentin. Margaux confirme : “J’ai tout séparé. Il y a Margaux sur Internet et il y a quelqu’un d’autre dans la ‘vraie vie’. J’aime pas dire la vraie vie… Dans la vie réelle, la vie hors ligne.” Narboc, 27 ans, photographe professionnel, a pris moins de précautions “Narboc, c’est un pseudo, mais inspiré de mon nom.” Comme Margaux, il ne dévoile que très rarement son visage. Malgré cela, les utilisateurs choisissent bien souvent d’en parler à leur entourage. Au cas où… “Mon chéri, il prend mes photos donc il est plus qu’au courant. Ma mère, elle, a eu un peu plus de mal à l’accepter, mais elle respecte mon choix”, explique Margaux. Pour Narboc, c’est pareil : “Mes potes s’en amusent. C’est encore revenu sur la table ce week-end. Ils vont chercher des photos de moi, tout en sachant très bien ce qu’ils vont trouver. Et j’ai l’impression que certains d’entre eux sont tentés de s’inscrire aussi.”
“C’est très exhib’, très amateur”
Uplust, c’est en fait le trait d’union entre l’évolution des mœurs et les nouveaux moyens technologiques. “C’est très paradoxal mais dans la sphère publique, il n’y a jamais eu autant de conservatisme, constate Grégory Dorcel, fils de Marc Dorcel et actuel directeur général de… Dorcel. Dans les années 80, les entrées en salle de films X représentaient 30 % du chiffre d’affaires des cinémas en France. Vous aviez cinq ou six magazines de sexe qui paraissaient avec toutes les stars du cinéma sans que personne ne crie au scandale. Vous aviez les chansons de Gainsbourg. Aujourd’hui, le sexe a disparu de la sphère publique.” Pour mieux s’exprimer de
façon décomplexée dans la sphère privée? Pour Grégory Dorcel, la réponse est oui. “C’est de moins en moins tabou de se faire plaisir comme on l’entend, de jouir, de profiter. Les femmes ont repris leur sexualité en main. Avant, c’était l’apanage des hommes. Maintenant, elle se disent : ‘Et pourquoi pas ?’” “On peut tomber sur une nana libertine qui met son plan cul du samedi soir à trois, quatre, six ou dix. Tout le monde est libre”, confirme Margaux.
Dorcel, géant du X pour qui tout a commencé dans les années 70 avec le roman érotique, a tout de suite compris l’énorme potentiel de la girl next door. C’est en 2015 que Quentin croise Grégory, sur un plateau d’Europe 1. “Je lui ai envoyé un mail qui disait : ‘Il faut qu’on se rencontre. Il faut investir dans ce qui est pour moi le futur, la démocratisation du nu’”, raconte Quentin. “Dans le domaine du X, il y a le saint Graal, c’est d’avoir du contenu amateur. Du contenu posté sans but lucratif par des non-professionnels, par monsieur et madame Tout-le-monde, pour bien connaître toutes les ficelles de ce métier-là, ça n’a jamais existé. On a trouvé ça fantastique”, explique Grégory. Bref, son mail à lui dit oui. Et en septembre dernier, Dorcel investit dans le capital d’Uplust. Mais la multinationale veut quand même garder ses distances “pour une raison qui est simple : ils font ce [qu’elle] n’a jamais su faire”.
Uplust, c’est donc aussi un monde sans censure ni barrières. Dans une société où “tout ce qui est beau est bon”, le réseau social d’un autre genre change les codes. “Aujourd’hui, il faut être mince, blonde, avec de gros seins, pas de gras au ventre… Quand j’ai commencé à poster des photos sur ce site, plein de mecs me disaient : ‘T’es trop belle, t’es trop bonne.’ Je pensais qu’il n’y aurait que des gros pervers, mais c’est pas le cas”, explique Margaux. Et la flatterie des ego ne s’arrêtent pas là. “Sur les sites comme YouPorn par exemple, si t’as deux commentaires, t’es content. Sur Uplust tu peux taper les 1 000 likes, et c’est ça qui attire de plus en plus de monde”, ajoute Quentin.
Et c’est pas fini
Narboc, lui est un peu déçu par cette évolution. S’il s’est inscrit sur Uplust, c’est pour pouvoir poster des photos érotiques. Très rapidement, il a pris goût à tout ça : “Je cherchais du beau, de l’intéressant, du design…” Ce qu’il a trouvé. Enfin, au début. Car depuis quelques mois, il se connecte moins. “Ça manque de plus en plus de style, c’est très exhib’, très amateur. Pour moi, la girl next door, elle a un peu plus de classe, elle a quelque chose. Elle poste des photos un peu plus recherchées, même si c’est amateur, ça doit rester joli et sexy.” La girl next door ne serait donc pas toujours à la hauteur des fantasmes qu’elle génère.
N’en déplaise à ce photographe utopiste, Uplust a décidé de passer à la vitesse supérieure. Il y a six mois, une version premium a été mise en ligne. Le but : monétiser certaines activités en créant une monnaie virtuelle, le lust. Les utilisateurs peuvent flouter leurs photos et vidéos, et les “déflouter” moyennant un certain montant en lusts, partagé ensuite 50/50 entre la plateforme et l’utilisateur. Un système qui, d’après Quentin, fonctionne bien pour le moment.
Le vrai du faux

Lampe torche à la main, il furète dans chaque pièce. Le représentant du ministère indien de la Culture attrape délicatement une clé et tente d’ouvrir un placard, silencieux, à l’affût du moindre bruit. Il cherche des indices. Son seul objectif : trouver la présence malveillante qui occupe une de ces pièces. D’un coup, il se retourne, balayant la pièce avec son faisceau de lumière. Fausse alerte, sûrement un banal courant d’air. Sa veste de costume bleu marine toujours impeccable et les manettes bien en main, le haut fonctionnaire continue son exploration de la maison de Paranormal Activity. À quelques mètres, sa femme garde les yeux rivés sur l’écran. Elle peut suivre sa performance en direct. “Je n’aime pas les films d’horreur. Je les regarde toujours avec la main devant les yeux !” mime-t-elle en riant. Pour son mari, impossible d’adopter cette technique. Son casque de réalité virtuelle l’en empêche. Mais après dix minutes, c’en est trop. “Sortez-moi de ce truc”, dit-il à un de ses collègues. Raja –le vice-président de l’entreprise de technologie à l’origine du jeu, présente au pavillon Next du festival de Cannes– esquisse un sourire : “Avec cette expérience, j’ai choqué beaucoup de monde. Des enfants comme des vieux !”
“Quelqu’un pourrait me pointer un flingue sur la tête”
Au bout de la jetée, quelques jet-setteurs descendent de leur yacht. Mais ici, c’est une autre réalité. La réalité virtuelle. “VR” dans le jargon. Dans une salle de projection à ciel ouvert, la trentaine de spectateurs ne tient pas en place. Certains lèvent les yeux au ciel, d’autres tournent frénétiquement sur leur chaise pivotante. Munis de leur casque VR, quelques-uns peinent à retenir leurs émotions. Une spectatrice s’inquiète : “Je ne vois plus mes mains.” Michel Reilhac jette un coup d’œil amusé à l’assemblée. Il est catégorique : “La réalité virtuelle,
ça ne va pas seulement être une nouvelle plateforme. Ça va être l’équivalent du portable.” L’ancien président d’Arte cinéma France a tout lâché pour la VR. Fini le job prestigieux, maintenant, il fait le tour des festivals avec un poème tantrique, son film qui “explore la notion d’intimité”. Comprendre trois hommes et quatre femmes qui se caressent sur fond blanc. Et que l’on peut voir sous tous les angles, en réalité virtuelle. Parce que c’est là “que l’on a le pouvoir de tout inventer”, selon lui. Pourtant, tout le monde ne le suit pas dans son rêve d’explorateur technologique. Quand il a quitté Arte en 2012, les réactions étaient sans appel. “Pourquoi tu quittes l’aristocratie du cinéma pour aller dans la plèbe ?” revenait souvent. “Certaines de ces mêmes personnes viennent me voir maintenant et me disent que je suis visionnaire”, assure-t-il.
Amanda Prager, tongs aux pieds, sa casquette University of Pennsylvania posée bien droite sur la tête, se faufile au milieu des businessmen de la Croisette. Et engage la conversation avec réalisateurs et producteurs potentiels. Pour une raison simple : “[elle veut] être une pionnière”. Assise sur des marches tapissées de rouge, l’étudiante américaine détaille ce qu’elle anticipe comme la nouvelle forme artistique émergente. Et elle lui voit un grand avenir. “Des gens ne croient pas que l’Holocauste ait eu lieu. Mais si on leur montre une vidéo en réalité virtuelle avec des survivants qui se plongent dans des archives, ça peut avoir un impact énorme !” Elle croque dans une fraise qu’elle sort de son sac, et prophétise. “Avec la réalité virtuelle, on peut aussi facilement manipuler des gens.” Elle philosophe sur la perte de conscience. La possibilité de naviguer dans cet “autre monde”. “Quand je porte le casque, quelqu’un pourrait me pointer un flingue sur la tête, je ne m’en rendrais même pas compte.” Mais elle préfère prendre le risque. Son but est clair: “J’espère que je serai la première à faire un film en VR qui aura un réel impact.”
LeBron James et les chevaux mongols
Miami, 2015. LeBron James, star de la NBA, se balade en voiture avec des potes. Il raconte un peu les entraînements de pré-saison, boit une gorgée d’eau et enchaîne sur une petite blague destinée à son fils, assis juste derrière lui. Le paysage de la Floride défile. Voilà ce que c’est de vivre avec LeBron James. En réalité virtuelle. C’est un studio québécois, Felix et Paul, qui a mis sur pied ce documentaire. Une caméra 360 degrés a suivi toute la préparation de pré-saison
du joueur de basket. “LeBron James voulait faire un projet en réalité virtuelle, donc il a contacté Oculus (marque de casque de réalité virtuelle, ndlr). Et ensuite, Oculus nous a chargés de mener à bien le projet”, raconte Stéphane Rituit, le cofondateur du studio. À Montréal, ça fait trois ans que ces réalisateurs se sont lancés dans cette aventure risquée. “On est encore en phase d’évangélisation”, reconnaît-il. Et au pavillon Next, le prosélytisme de la VR suit son cours. Discuter avec des producteurs, des réalisateurs intéressés par des projets, voilà l’objectif. Parce que pour l’instant, “il n’y a que le porno qui fait de la tune avec la réalité virtuelle”, à en croire un producteur de Digital Immersion. Et la raison est simple pour le studio Felix et Paul. “L’année dernière, on disait que cette année tout le monde aurait un casque de réalité virtuelle. Mais c’est faux. Ça sera sûrement pas avant fin 2017, même 2018”, avoue Ryan, un producteur. Tous confient que le marché de la réalité virtuelle n’existe pas encore vraiment. Si les revenus ne s’accumulent pas, les passages dans les festivals si. Et ce, pour des projets de plus en plus élaborés. Et souvent, les studios tentent le tout pour le tout. “En Mongolie, on devait filmer une horde de chevaux sauvages qui arrivent vers nous. Sauf qu’on avait peur que la caméra se fasse écraser. Donc je suis resté seul au niveau de la caméra, quand les chevaux galopaient vers moi. Le sol vibrait, c’était extraordinaire”, revit Stéphane Rituit, petit sourire aux lèvres.
Amanda a terminé ses fraises, elle remonte les marches. Elle garde son expérience VR bien en tête : “Pendant un moment, à chaque fois, je ne sais plus ce qui est réel et ce qui ne l’est plus quand j’y passe trop de temps.” D’autant plus qu’elle en est sortie avec la nausée. “Je regardais une scène dans une voiture, mon cerveau pensait que je bougeais, mais ce n’était pas le cas. Et je ne me sentais pas bien ensuite.” La réalité virtuelle, la prophétie qui fait tourner toutes les têtes ?
“Quand je vais dans les festivals, c’est une grande déception de voir que mon pays est souvent réduit à un marché”

Quelle place la jeunesse chinoise a-t-elle dans votre travail ?
Quelle que soit la période historique, la jeunesse est toujours obligée de résoudre les problèmes laissés par les générations précédentes et apprendre à faire avec. Mon sentiment à son égard est très complexe, un mélange réel d’inquiétude et de joie. L’inquiétude, c’est parce que le sentiment nationaliste, l’exclusion de l’autre, une sorte de xénophobie teintée d’orgueil démesuré, prend une ampleur considérable. La jeunesse se renferme plutôt qu’elle ne s’ouvre sur l’extérieur. J’observe aussi la baisse de la qualité de la langue chinoise pratiquée, et avec elle la disparition de tout un mode de pensée. Qu’est-ce qui va être véhiculé à la place ? On ne sait pas. La joie, c’est que les jeunes dans mon pays ont une plus grande conscience d’être des individus à part entière que les générations précédentes. Et comme la jeunesse est l’avenir du monde…
À l’heure de l’avénement de l’image, pourquoi la langue est-elle si importante?
J’ai toujours, dans mes films, parlé de cet obstacle de la langue entre les gens en Chine: dans Still Life, le personnage qui arrive du Sitchuan discute avec le patron de l’hôtel et on sent qu’il y a quelque chose qui ne passe pas. Il ne faut pas oublier que longtemps, on était obligé d’uniformiser avec le mandarin dans le cinéma chinois alors que c’était complètement contradictoire avec la réalité du pays. Ce
qui caractérise la langue comme mode de pensée, c’est qu’elle est inscrite dans une certaine linéarité, sans interruption. Par la langue, on peut accéder à une certaine unité alors que les images sont fragmentées, il faut un agencement pour leur donner sens. La langue ne cesse de véhiculer un nombre d’informations bien plus grand que celui de l’image, c’est sans équivalent. Chaque dialecte possède un vocabulaire qui n’a pas d’équivalent dans un autre dialecte. Elle permet aussi un rapport au monde plus subjectif alors que l’image est plus dans le monde de l’objectivité, à mon sens, étonnamment. Dans Au-delà des montagnes, la mère s’attend à ce que son fils s’adresse à elle dans sa lange maternelle. Or, lui ne connait déjà plus cette langue et a d’autres automatismes.
Quel rapport la jeunesse chinoise entretient-elle avec l’argent, selon vous ?
Depuis la fin des années 70, notre gouvernement et la population font tout tourner autour de l’argent. Cette avidité pour l’argent provient du fait que l’on nous a obligés à rester dans une situation de pauvreté pendant si longtemps que le désir d’enrichissement est naturel. La pauvreté était encensée mais a conduit à un sentiment d’insécurité qui ne semblait pouvoir être corrigé que par l’enrichissement. Le collectivisme a réfréné et interdit le désir: tout bonheur, tout divertissement, toute accumulation de richesse était vu comme négatif. Les plaisirs sentimentaux ou sexuels ont été réprimés mais pas ceux liés à la nourriture ou aux agapes: tout le monde s’y est vautré, et les individus se sont perdus. Dans mon film, Tao fait un choix en fonction de l’argent: elle laisse la garde de l’enfant au père parce qu’il est plus riche, qu’il peut lui assurer une meilleure vie. Restent les sentiments. Là, les dégâts sont réels. Et l’argent ne peut rien y faire.
Vous qui croyez en l’amour, tomber amoureux arrive-t-il encore souvent en Chine ?
Disons que dans la Chine actuelle, tous les Chinois revendiquent l’amour et l’argent. Des histoires d’amour naissent tous les jours mais aux issues de plus en plus incertaines, hein. Elles ont du mal à passer le cap d’une réalité matérielle confrontée à la réalité. Le haut de la société envoie des slogans auxquels
l’individu croit, et qu’il finit par reproduire. La réalité actuelle, c’est que les individus manquent d’expérience personnelle, il y a des perceptions, celle de la ville sur la campagne par exemple, qu’ils n’ont jamais eu l’occasion d’avoir en vrai. Autre exemple: de nombreuses résidences sont porteuses de romantisme, elles ont le nom de lieux français, idem pour le vin et le chocolat. Ça crée une idée préconçue: est-ce vraiment le romantisme qui caractérise la France? Le problème du slogan, c’est la simplification à outrance et l’illusion que ça crée chez les gens. Même nous, les cinéastes, désormais, quand on veut démarcher des investisseurs, on est obligés de trouver un slogan.
Quelle est la chose que vous aimez le plus dans votre pays aujourd’hui ?
La nourriture.
Quelle est la chose de la Chine d’aujourd’hui que les étrangers ne comprennent absolument pas ?
La réalité de la Chine. Tous les problèmes liés à l’histoire, à cette nation, et aussi les réactions de toute cette population, c’est très difficile à percevoir pour les étrangers, ou alors ça demande extrêmement de temps. Quand je vais dans les festivals, c’est une grande déception de voir que mon pays est souvent réduit à un marché.
Un mouvement populaire autre que consumériste est-il possible en Chine ?
C’est extrêmement difficile, le moindre regroupement de personnes est physiquement difficile, ce qui explique que tout passe par le net. Là, les moyens d’expressions sont peu évidents, Internet est surveillé, controlé, censuré. Mais bon, il n’y a qu’en soi-même que l’on sait parfaitement comment se positionner par rapport à la réalité des choses. Être incompris n’est pas grave si l’on sait comment réagir en étant fidèle à qui on est. Ma quête, si elle existe, c’est la continuité, c’est dans cela que je me reconnais. Il n’y a que nous qui savons. Il faut se faire confiance.
Mads Mikkelsen : “Le débat sur les migrants, c’est plus subtil que : ‘Ouvrez les portes !’”

Vous avez une présence folle, il paraît que vous êtes sympa, et pourtant vous parlez peu…
Je pense surtout que c’est très important qu’on n’en sache que très peu sur un acteur, comme ça il peut être plus persuasif à l’écran. Si j’étais un mec qui faisait du vélo, vous pourriez savoir tout ce que vous voulez sur moi parce que ça ne changerait pas la manière dont je pédale. En fait, je suis de ceux qui pensent qu’un film peut montrer beaucoup plus que la parole. Tu peux toujours parler dans la vraie vie, hein.
Allons-y: le pays où vous continuez à habiter, le Danemark, semble avoir une position radicale sur l’accueil des migrants…
Quand vous demandez à un artiste, à un musicien, il va toujours vous donner la même réponse: ‘Ouvrez les portes, j’ai honte de mon pays.’ Je pense que nous avons entendu cette réponse un milliard de fois. Honnêtement, le débat est sûrement beaucoup plus subtil que ça. Pour tout vous dire, je pense que l’Europe entière est comme le Danemark. On doit faire face à une situation nouvelle et très importante dont il faut discuter de manière très différente et subtile. La première question est bien évidemment: comment aider les gens qui sont en train de fuir ? Mais il faut également se demander ce que veut devenir l’Europe après ça. C’est une question très importante. On veut tous être des gens bien mais on veut aussi le faire de la bonne manière, une manière dont on a l’impression qu’elle pourra faire partie de notre futur. Ce que je dis est assez vague, mais c’est une question qu’on ne peut éviter et à laquelle il faut faire face parce que l’Europe entière doit prendre en compte ce problème. Je pense qu’à partir de maintenant, les gens vont en discuter pendant plusieurs années. Mais il ne faut surtout pas croire que c’est une question qui demande une réponse claire et tranchée, c’est toujours cette même zone plus complexe que j’appelle grise qui pourra nous apporter la réponse.
Mais la position du Danemark vis-à-vis de l’Europe est ambiguë…
Encore une fois, je dirais que ce n’est pas seulement le Danemark, c’est toute l’Europe. Et ce sujet est à discuter de manière nuancée et pas seulement en surface en disant des choses vagues comme : ‘La Suède est amicale, le Danemark
est droit, l’Allemagne est ouverte d’esprit, la France etc.’ On ne peut pas dire les choses comme ça. Je pense qu’il y a beaucoup de gens sceptiques par rapport à l’Union européenne dans toute l’Europe, même en France… Ça peut être à hauteur de 20, 40 ou 60 % dans les sondages, mais on devrait tous parler de ce que ce scepticisme reflète. La plupart des gens en Europe aiment l’Union européenne mais ils sentent aussi qu’elle devient de plus en plus puissante dans une seule et même direction : celle consistant à ce que les plus petits pays n’aient plus leur mot à dire sur rien. C’est cet équilibre que les petits pays, comme le Danemark, remettent en question. Mais je pense que cet équilibre est également remis en cause en France et en Allemagne. C’est juste que les médias n’en parlent pas ou plus. Le Danemark, c’est ma base, et ça le sera probablement toujours.
Vous êtes politisé ?
Quand j’étais enfant, c’est le parti de gauche qui était très eurosceptique. Maintenant, c’est la droite. C’est drôle comme l’Union européenne a changé pour devenir quelque chose de plus attrayant pour la gauche.
Globalement, je ne pense pas qu’il faille se sentir obligé d’être politisé. La plupart des gens ont des avis politiques mais ne sont pas tenus de prendre position ouvertement. Ce n’est pas notre rôle, nous, les comédiens : si des gens sentent la nécessité de s’exprimer, je vous en prie, ne vous gênez pas. Mais sinon, de la même manière, ne faites rien. Je ne pense pas que, parce que vous êtes une personnalité publique, vous devez également avoir une opinion publique.
Et vous, vous avez envie de donner votre opinion ?
Parfois, j’en ai envie, mais en même temps, il y a plein de gens qui ont déjà une déclaration politique similaire, donc à quoi ça sert que je ne fasse que répéter ? Si tu veux débattre de quelque chose, avoir plus de personnes qui pensent de la même manière, ça ne rend pas les arguments plus forts. Ça doit être débattu de manière juste. Parfois, j’aimerais beaucoup être un politicien, ou peut-être même un dictateur. Ça, ce serait génial. Mais pour l’instant, je n’ai pas particulièrement envie d’être perçu comme un acteur politiquement engagé. Peut-être un jour, mais je ne pense pas qu’un acteur doive s’engager. Pour l’instant, je m’intéresse à la politique en tant que citoyen, en tant qu’homme qui a le droit de voter et c’est comme ça que j’y réfléchis.
Retrouvez Men & Chicken de Anders Thomas Jensen, avec Mads Mikkelsen, au cinéma le 25 mai 2016.
Andres Serrano : “J’aime ma photo de Donald Trump, il est beau dessus”

Pourquoi cette fascination pour les sujets polémiques ?
La question ce n’est pas “pourquoi ?”, mais “pourquoi pas ?”. Pourquoi ne pas travailler avec le Ku Klux Klan ? Je ne suis pas blanc, je suis hispanique. Du coup, ça a du sens, c’est un challenge. Si j’étais blanc, je ne pense pas que je les aurais photographiés, ça n’aurait pas été un challenge. J’aime les défis, j’aime aller où je ne suis pas censé aller. J’ai aussi voulu faire une exposition appelée « Merde » et photographier des étrons en gros plan –même si la merde a déjà été utilisée : Manzoni en a mis dans une boîte de conserve, sans qu’on ne sache vraiment si elle est dedans… À la fois parce que la merde, c’est tabou, et parce que l’utilisation du terme “merde” aux États-Unis, dans la langue anglaise, est très courante : good shit, bad shit, bullshit, stupid shit, funny shit, dumb shit, holy shit... Et tous ces excréments étaient dans mes photos : j’ai eu la merde sacrée d’un prêtre, la merde freudienne de mon psychanalyste.
Quand avez-vous commencé vos séries de photos ?
Le travail que je fais, je le fais en tant qu’artiste et pas en tant que photographe. Si j’avais pensé mon travail en tant que travail photographique, je n’aurais rien fait. Quand je suis allé à l’école d’art, j’avais 17 ans. J’ai étudié la peinture et la sculpture à la Brooklyn Museum Art School mais je n’ai jamais étudié la photo. Là-bas, j’ai découvert Marcel Duchamp. Ce que Duchamp m’a appris, ce qu’il apprend à tout le monde d’ailleurs, c’est que tout, et la photo également, peut être un art. Je me définis comme un artiste qui a choisi la photo pour pratiquer son art. Quand je faisais la série Body Fluids (en 1987, ndlr), je représentais les fluides d’une manière très abstraite. Pour les monochromes, j’ai utilisé du sang, de la pisse, du sperme et du lait. Je faisais des images comme “milk-blood” qui est une référence à Mondrian. C’est une image blanc et rouge. Parfois, j’ai l’impression d’avoir fait, ces dernières années, un travail antiphotographique.

Pour cette série justement, Body Fluids, où trouviez-vous tous les liquides dont vous aviez besoin ?
Le sang venait de chez le boucher, il le vend et j’en utilise beaucoup. Ça s’appelle “sang de bœuf mangeable” donc ce n’est pas du sang humain. Le sperme était le mien, l’urine était la mienne. La première fois que j’ai fait une photo de pisse, j’ai demandé à ma première femme de me donner de son urine mais je suis vite arrivé à la conclusion que ma pisse était plus jaune, donc j’ai seulement utilisé la mienne.
Comment en vient-on à trouver de tels sujets de travail?
Les idées sont une chose, mais en tant qu’artiste, vous avez une représentation visuelle de ces idées. Mon but est de toujours rendre beau ce que je photographie, de toujours créer des images intéressantes. Des images qui, quand tu passes devant, dans une galerie ou un musée, ne te font pas seulement une impression positive, mais que cette impression reste avec toi, que tu t’en souviens.
Choisissez-vous les sujets en priorité parce qu’ils vous mettent mal à l’aise ?
Non ! De manière générale, rien ne me met mal à l’aise. Quand je suis allé à la
morgue pour photographier les morts, je me suis rappelé que le responsable m’avait demandé : “Est ce que vous avez déjà vu des gens morts avant ?” Je lui ai répondu que non, pas vraiment. Il a dit : “Vous savez, au fil des ans, deux personnes différentes sont venues ici et ont voulu photographier la morgue. Même si je leur ai dit qu’elles pouvaient revenir, après le premier jour qu’elles ont passé ici, elles ne sont jamais revenues.” Je suis entré, j’ai vu des choses qui m’ont mis mal à l’aise, particulièrement les odeurs. Mais ça n’a pas affecté ma capacité à travailler là. Quand j’ai photographié le Ku Klux Klan et qu’ils parlaient de “nègres”, de “feujs” et de “queers”, il a fallu mettre un mur entre eux et moi. Ça me permet de travailler dans n’importe quel contexte. Je n’ai jamais laissé mes sujets m’affecter. Même quand j’ai travaillé avec le Klan, avec les morts, avec les sans-abris…
Ça doit quand même être un peu bizarre…
L’expérience la plus incroyable que j’ai vécue avec le Klan, ça a été ma rencontre avec le Mage impérial. Le chef. Il m’a demandé de le rencontrer dans une zone complètement désolée en pleine nuit. Je me suis retrouvé là avec mon assistant. Dans cette nuit vraiment très mystérieuse, les deux gars du Ku Klux Klan sont sortis et le Mage impérial, qui s’appelle David Hollinn, s’est retourné vers son ami et lui a dit : “Ça, c’est le très tristement célèbre Andres Serrano.” J’étais vraiment impressionné que le chef du Klan me qualifie de “tristement célèbre”. J’étais aussi très flatté.

Les sujets que vous abordez ne sont pas neutres. Est-ce que vous vous voyez comme un artiste engagé ?
Non. Je suis apolitique. Enfin, j’ai un avis politique, une conscience, mais généralement, je la garde pour moi. Parce que quand on catégorise ton travail comme art politique, tu commences à avoir un agenda. Les gens te jugent sur le fait que tu essayes de faire de la propagande d’une manière ou d’une autre. Je ne suis pas un travailleur social, je vous montre juste ce que je vois mais je ne vous demande pas d’être une bonne personne. C’est votre problème, pas le mien.
Vous la voyez comment la liberté d’expression actuellement ?
La liberté d’expression à l’âge du digital est vraiment curieuse. D’un côté, la société devient plus conservatrice, et tu as l’impression que cette liberté d’expression est menacée. Et d’un autre côté, n’importe qui avec un iPhone dans la main peut écrire ce qu’il veut. Tu peux ouvrir un blog, tu peux écrire des trucs atroces. Tu vois ça tout le temps quand quelqu’un décide d’écrire quelque chose de sympa sur une célébrité, c’est toujours suivi d’une vingtaine de critiques sur la même personne, qui viennent même d’autres célébrités.
Est-ce que, parfois, vous vous sentez brimé ?
Ces 25 dernières années, j’ai exposé dans quatorze musées différents en Europe. Et d’un autre côté, j’ai organisé un seul événement aux États-Unis! En Europe, on dirait que les musées sont bien plus ouverts sur mon travail. Ils m’acceptent en tant qu’artiste. Aux États-Unis, je suis connu, en gros, comme “l’artiste controversé Andres Serrano, fan du Piss Christ”. Ils ne connaissent que ça ! Et peut-être que les musées ont peur. S’il y a une quelconque forme de censure qui concerne mon boulot, elle existe dans le fait de ne pas être invité. Personne ne me censure, on ne m’invite juste pas.
Enfin, vous avez présenté vos œuvres en Europe la plupart du temps, et c’est en Europe qu’on les a vandalisées…
Oui, mais pas seulement. Mon Piss Christ a été vandalisé à Avignon, il y a quelques années, et quelques images sexuellement explicites que j’avais réalisées ont été abîmées en Suède. Mais avant ça, le Piss Christ avait été attaqué à Melbourne, dans la galerie nationale Victoria. Les assauts sur mon travail peuvent avoir lieu n’importe où.
Vous parlez de l’œuvre vandalisée Piss Christ, qui représente un crucifix plongé dans de l’urine. Vous avez également fait toute une série sur la religion intitulée The Church en 1991. En quoi la religion influe-t-elle sur votre travail ?
Ma relation avec la religion et le Christ est personnelle. Je n’ai pas besoin de parler de Dieu ou du fait d’être chrétien parce que je sens que ce n’est pas
nécessaire. Dans la vie de tous les jours, je ne mentionne jamais ni la Bible ni le Christ. Je trouve même ça étrange que les gens pensent qu’être un bon chrétien signifie lire la Bible nuit et jour. Il y a plein de manières d’être croyant ou chrétien, et j’ai ma façon personnelle. Chacun a besoin de trouver sa voie.
En tant que créateur du Piss Christ, je ne vois pas de contradiction dans le fait de travailler avec l’Église. Cette dualité est présente dans mon travail ; peut-être que les autres ne peuvent pas le comprendre mais pourtant, ça a du sens. Et j’espère qu’un jour, je rencontrerai le pape François, et qu’il reconnaîtra ce que j’ai fait, parce que je me vois comme un artiste religieux, lié à la tradition artistique religieuse.

Donc la religion vous guide dans votre travail ?
Oui, et je pense toujours dans un premier temps que ce que je fais, je le fais parce que Dieu l’autorise. Et aussi parce que le destin me le permet. Tu penses que tu fais des choix –et tu en fais– mais à un moment, tu réalises d’une certaine manière que c’était ton destin. Par exemple, pour la série Morgue, j’ai essayé d’appeler une morgue à Los Angeles et c’était difficile. Il y avait toute une procédure bureaucratique très complexe. Et je ne suis pas très bon avec les trucs administratifs, donc j’ai mis cette idée de côté. Dix ans plus tard, j’ai été en lien avec une femme qui m’a dit : “Je sais que tu voulais photographier des gens morts et je connais quelqu’un qui travaille dans le domaine de la morgue, tu veux que je demande si tu peux y aller ?” J’ai dit, oui. Trois semaines après : “J’ai parlé à ma mère et elle a déjeuné avec le mec qui s’occupe de la morgue. Si tu veux y aller, tu peux.” Parfois, les opportunités se présentent d’elles-mêmes.
Pour la première fois, à Bruxelles, vous exposez un portrait de Donald Trump. Pourquoi le montrer précisément maintenant, en pleine campagne présidentielle américaine ?
J’ai décidé d’afficher un portrait de Donald Trump que j’ai réalisé en 2004, dans ma série America. J’avais commencé cette série parce que j’avais senti que nous étions attaqués avec le 11-Septembre. Donc j’ai photographié 160 personnes, en commençant dix jours après les attentats de 2001, pour montrer ce qu’était l’Amérique, ce qu’elle représente. Je me suis dit que j’allais garder cette image pour une occasion spéciale. C’est la plus grande expo de ma vie, et en même temps, Donald Trump se présente pour être président des États-Unis. Donc c’était le bon moment.
Y a-t-il un message derrière l’exposition de cette photo ?
Je ne dirais jamais quoi que ce soit de négatif sur quelqu’un qui a posé pour moi. Et Donald Trump a posé pour moi. C’est un miroir, cette image. Tu vois Donald Trump en photo, et selon ce que tu penses du bonhomme, tu auras une réaction. Tu l’adores peut-être et tu adores la photo, ou alors tu le détestes et tu détestes la photo. Perso, j’aime la photo parce qu’il est beau dessus ! Et c’est mon boulot en tant qu’artiste de faire en sorte que les gens aient l’air beau. Peu importe qui ils sont.
Pour votre série America, vous avez photographié Donald Trump, mais aussi Snoop Dogg. Vous photographieriez qui aujourd’hui, dans l’idéal ?
J’ai toujours regretté de ne pas avoir fait de cliché de Bill Clinton. J’ai tenté, et il m’a écrit une petite note pour me dire : “Désolé, je ne pouvais pas le faire, blablabla.” Obama, ça aurait été sympa. Mais je suis content avec seulement Donald Trump. Parce qu’il a du bagage. J’aurais pris la photo d’Obama, ça n’aurait pas été grand-chose, tout le monde s’en foutrait. Trump est bien plus conflictuel. J’aime ça.
Voir : l’exposition “Andres Serrano. Uncensored Photographs” aux musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, à Bruxelles, jusqu’au 21 août
Le troisième homme
 Ronald G. Wayne, un type fatigué
Ronald G. Wayne, un type fatiguéRonald G. Wayne vit depuis des décennies dans un certain dénuement, dans le désert du Nevada. Son erreur ? Avoir vendu pour une somme symbolique (800 dollars) toutes ses actions d’Apple (10%) deux semaines après le lancement de la compagnie avec Jobs et Wozniak. Ces 10% valent aujourd’hui plus de 50 milliards de dollars. Et histoire d’enfoncer le clou, il cèdera trente ans après pour quelques centaines de billets le contrat original scellant la création d’Apple à un collectionneur. Qui revendra le document 1 300 000 dollars. Ronald G. Wayne, ou l’inverse du rêve américain.
Épisode 1 : Dans l’ombre de deux géants
De 20 ans l’aîné de Steve Jobs et Steve Wozniak, Ronald Wayne est embarqué dans l’aventure Apple en tant que « juge de paix » entre les deux fortes têtes tout juste majeures. Mais Wayne n’est pas sûr de vouloir passer le restant de sa vie dans l’ombre de deux géants…
Épisode 2 : Mon seul regret
Si Ronald Wayne n’a jamais regretté d’avoir quitté Apple, assumant son destin et ses choix, une mauvaise décision lui reste pourtant en travers de la gorge : celle de revendre à un collectionneur le contrat original d’Apple, avec sa signature et celles des deux Steve…
Rob Ford, la vie avant la mort

Un spécialiste
En 2006, Rob Ford n’est pas encore maire, seulement conseiller municipal, qu’il dérape déjà. Au cours d’une réunion officielle à la mairie de Toronto entre différents conseillers, le débat est agité. La Ville s’apprête à voter 1,5 million de dollars d’aide pour la prévention contre le sida. Ford, lui, estime que ce n’est pas aux contribuables de payer : « À part si t’es un camé, ou si t’es gay, tu ne peux pas avoir le sida... » David Miller, le maire en place à l’époque, lui fait remarquer que c’est pourtant la population féminine, d’après les statistiques, qui est la plus touchée. Mais le natif de Toronto a réponse à tout : “Elles couchent probablement avec des bisexuels.” Des bisexuels toxicomanes, sans doute.
Un gendre idéal
Les femmes n’ont décidément aucun secret pour Rob. “Elles aiment l’argent. Donne-leur des milliers de dollars, elles seront heureuses”, sait-il. Et en seize ans de mariage, Renata Ford, épouse de, en a vu de toutes les couleurs. Le soir de Noël 2011, Robbie la menace d’enlever leurs deux enfants et de s’enfuir à Miami. Pas de gros chèque pour Renata, mais une belle intervention du 911. En 2012, rebelote. La police doit intervenir de nouveau en pleine scène de ménage, les deux parties s’accusant mutuellement d’avoir trop bu…
Un playboy
« I’m Rob Ford. It’s gonna be pretty hard to change. »* Rob sait ce qu’il vaut. Il est fier de lui et n’a peur de personne. Pourtant, le 1er avril 2011, la couverture du magazine Now le montre presque nu ; et alors qu’il prétend prendre à la rigolade cette caricature, tous les exemplaires de l’hebdomadaire disparaissent miraculeusement des kiosques de l’hôtel de ville. Rob n’aurait pas assumé ?
*Je suis Rob Ford, ça va être compliqué de changé ça.
Un géant vert
C’est pas tous les jours qu’on s’amuse à la mairie de Toronto ! Mais quand Rob devient wild, ça déménage. Ce soir de Saint-Patrick 2012, alors que « YOLO » n’est pas encore à la mode, Rob donne tout : vin, bière, vodka, shots dans le bureau du maire, striptease, coups de balayette dans les jambes du staff, lancer de cartes de visite sur un chauffeur de taxi et crise de larmes. Et encore, ce n’est que l’apéro. Rob et sa fine équipe finissent ensuite la soirée dans un bar des alentours. Mal. La conclusion de l’intéressé : “Je dois juste ralentir un peu ma consommation d’alcool.”
Un grand sportif
Si Rob Ford avait un rêve, c’était de devenir footballeur américain professionnel. Son physique ne le lui permettait pas, mais il est finalement parvenu à être coach d’une équipe de lycée à Toronto : the Don Bosco Eagles. Pourtant, en 2013, après dix ans à sa tête, il est viré. Les motifs de ce renvoi sont sans surprise : menaces, insultes, ivresse. Son coaching a, en revanche, marqué les esprits par son originalité. La rumeur court qu’il forçait ses joueurs à se rouler dans des fèces d’oie pendant les entraînements. L’important dans l’histoire, c’est qu’il en garde un bon souvenir. Ivre, il a déclaré à propos de son équipe : “They are just fucking minorities.” (“Ce sont juste des putain de minorités.”)
Un épicurien
2013. Depuis quelque temps déjà, beaucoup de bruits circulent sur les consommations illicites de Rob. Souvent sans preuve. Cette fois-ci, des journalistes du Toronto Star affirment avoir visionné une vidéo de Rob fumant du crack à la pipe et traitant le chef du parti libéral canadien de « pédé ». Rob réagit tout de suite : “Je ne consomme ni cocaïne ni crack. Quant à la vidéo, je ne peux pas commenter quelque chose que je n’ai jamais vu ou qui n’existe tout simplement pas.” Quelques mois et autres vidéos plus tard, il finira par avouer : “Oui, j’ai fumé du crack. Sûrement, pendant l’un de mes épisodes d’ivresse, et sûrement il y a plus d’un an.” Cf. la conclusion du quatrième paragraphe, « Un géant vert ».
Un mec serein
Alors que la vidéo officielle de Rob fumant du crack se fait attendre, en voilà une autre qu’il n’avait sûrement pas vue venir. En novembre 2013, le site Star le montre en effet en train de hurler sauvagement des menaces de mort. Et quand Rob fait les choses, il ne les fait pas à moitié ! “Je vais lui arracher sa putain de gorge”, l’entend-on promettre. Mieux encore : “Je vais tuer ce putain de mec. Je vous le dis, c’est un meurtre au premier degré. Je meurs ou il meurt, mon frère.” Rob est confus. Ses souvenirs sont flous. La faute à la boisson encore, évidemment. Fidèle à lui-même, il déclare : “Je veux voir la vidéo. Je m’en souviens à peine. J’étais vraiment, vraiment en état d’ébriété.”
Un homme contre le grignotage au bureau
2013 toujours. Cette fois-ci, Ford est accusé de harcèlement sexuel par son staff. Il aurait déclaré à l’une de ses collègues : “I want to eat your pussy.”* C’en est trop pour Robbie. On peut l’accuser de tout, mais pas touche à la réputation de bonne maîtresse de maison de sa femme ! Alors, il le fait savoir aux médias : « Je ne ferais jamais ça, je suis heureux en ménage, et j’ai plus que suffisamment assez à manger à la maison! »
*Je veux manger ta chatte.
Un altruiste
“Je ne veux pas me vanter, mais quand je suis dans la rue, les gens me traitent comme une rock star.” Lucide, Rob sait donc se vendre. En novembre 2014, alors qu’il s’apprête à retourner à l’hôpital pour un quatrième traitement de chimiothérapie, il met en vente des figurines à son effigie : les Bobblehead. Toutes les recettes seront reversées aux deux hôpitaux qui traitent son cancer. Des petits souvenirs de lui-même qui coûtent 30 dollars et partent comme des petits pains.
Un homme qui ne renonce jamais
Il était pourtant décidé. Ni les critiques, ni les scandales, ni personne n’aurait pu l’empêcher de se représenter aux élections de 2014. “C’est pas pour me vanter, mais je suis le meilleur maire que la ville ait jamais eu.” Malheureusement, Rob est peut-être le meilleur maire, il n’est pas plus fort qu’une tumeur à l’abdomen. Il doit renoncer. Mais pas question de laisser sa place à n’importe qui. Chez les Ford, on fait tout en famille. C’est donc son frère Doug qui se présentera. Et même si Doug perd les élections cette fois-ci, il l’a promis, il retentera sa chance en 2018. Rob du fond de son lit d’hôpital l’a expliqué : “On ne fait que s’échauffer.”
Un homme aimé, surtout
Malgré les tourments, les failles et les scandales, Rob a toujours pu compter sur le soutien d’une communauté de fans presque indestructible. Début mars 2016, la famille Ford a décidé d’ouvrir un site web afin que tous les résidents de Toronto puissent exprimer leur soutien à l’ancien maire dont l’état de santé continuait de se détériorer. En seulement quelques heures, presque 1 000 messages avaient déjà été postés. On en compte désormais 8 000. Rob Ford, tout simplement un homme de cœur ? En tout cas, même l’ancien Premier ministre du Canada Stephen Harper s’est exprimé : “Rob a été un battant toute sa vie et un fonctionnaire dévoué. Nous n’oublierons pas son courage, son amour pour Toronto et sa famille.”
Flow motion

Pour accéder à l’hôtel de Lassay, dans le VIIe arrondissement de Paris, où se déroule la 23e finale du très chic débat de la French Debating Association, il faut passer à travers toute une série d’étapes. Après avoir dû montrer son passeport, prouver qu’on était bien invité, être fouillé et parcourir la centaine de mètres qui séparent les grilles de l’Assemblée nationale, on arrive enfin dans le Saint des saints. À la vue des dorures, du marbre et du chambellan en costume trois pièces, nœud papillon blanc immaculé et chaîne en argent au veston, il est assez possible de se sentir mal et d’avoir envie d’aller se cacher dans les toilettes. Mais ce serait dommage d’en arriver là après avoir traversé toutes ces péripéties.
Dans la salle de réception d’une taille qui n’a rien à envier à la galerie des Glaces, se pressent environ 550 personnes. Entre les groupes qui n’ont pas été qualifiés pour la finale, les parents, les amis, les professeurs et le beau monde –il y a dans le jury les ambassadeurs d’Irlande et du Mexique, un conseiller aux affaires culturelles de l’ambassade des États-Unis, un secrétaire général de la Questure de
l’Assemblée nationale, etc.–, la salle de réception se remplit complètement au son des discussions franco-anglaises. Car tout ce joli monde est fluent en anglais. Le débat tant attendu se fait d’ailleurs exclusivement dans la langue de Shakespeare, comme toutes les joutes organisées par la French Debating Association dont monsieur Declan Mc Cavana, veston rouge et fort accent irlandais, professeur d’anglais à Polytechnique, décoré chevalier de l’ordre de l’Empire britannique par le prince William himself, et nouvellement décoré de l’ordre du chevalier de la Pléiade, est le président. Cet homme farfelu, orateur de génie (quatre fois vainqueur des joutes internationales) et auto-proclamé grande gueule, porte sur ses épaules ce style oratoire qu’il a rapporté des pays anglo-saxons pour permettre à ses étudiants de parler anglais de manière plus décomplexée : “Les étudiants ont besoin d’aller au-delà de la honte de parler une langue étrangère, de se sentir à l’aise. La prise de parole en public libère d’une certaine manière les esprits.”

Shame ou here
Ce soir, s’affrontent l’École normale supérieure et la petite nouvelle du tournoi : l’université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense. Le principe du face-à-face : deux équipes s’opposent au sujet d’une motion à l’Assemblée, Assemblée qui est représentée par le public. L’École normale supérieure défend ici la proposition et représente le gouvernement. L’université de Nanterre demande son rejet et, de ce fait, représente l’opposition. Le sujet de discorde : “Cette maison (le gouvernement) soutient que les mots sont tout ce que nous avons.” En l’honneur de l’écrivain irlandais Samuel Beckett qui a écrit : “Chaque mot est comme une tache inutile sur le silence et le néant.” Optimisme et bonne ambiance pour un sujet finalement pas trop polémique en comparaison de certains des années précédentes. Par exemple : “Cette maison soutient que la démocratie est une hypocrisie” ou encore “Cette maison défend que les femmes au foyer sont désespérées”. Des motions moins faciles à défendre…

L’année dernière, ce sont l’université Panthéon-Assas et l’école Polytechnique qui se sont retrouvées au dernier tour, autour du sujet “Keep Calm and Carry On”, littéralement “restez calmes et continuez”. Victoire accordée à Assas.
L’assistance a un rôle plutôt étrange dans un tel cadre : elle doit prendre part au débat. Et lorsqu’une personne dans la foule est en désaccord avec les propos tenus, ou déçue par les réponses de l’un ou de l’autre des partis elle est fortement encouragée à l’exprimer en criant : “SHAME” (“honte”). Celle qui, au contraire, soutient ce qui a été dit est invitée à le signifier par un : “here, here”, c’est-à-dire “ici, ici”.
À l’Assemblée nationale, on se marre bien
Le débat commence, faisant de la très chic Assemblée nationale un énorme gueuloir. L’aspect guindé du cadre et des écoles s’efface très vite pour laisser place à un débat houleux, mais plus rhétorique que sérieux où tout le monde exprime son mécontentement, ou son soutien, vraiment très fort.
Une argumentation basée sur Les mille et une nuits “et la nécessité des mots pour sauver sa vie” pour l’ENS ; un parallèle avec un critique artistique qui veut “sentir plus qu’écouter les mots pour transmettre quelque chose” pour Nanterre. Le but ici n’est pas de construire une argumentation implacable et pertinente mais d’avoir une répartie incroyable et de se mettre l’auditoire dans la poche. Et ça fonctionne. Bill François, un des cinq orateurs de l’École normale supérieure –qui défend donc la motion “les mots sont tout ce que nous avons”–, joue de comparaisons extrêmement drôles dans un accent terriblement français : “La ponctuation est aux pâtes italiennes ce qu’est la soupe qui les accompagne.” Puis, en réponse à cette question de l’opposition « Seriez-vous aussi convaincant si vous n’aviez pas le ton et la gestuelle qui va avec ?” : “Autant que les pâtes alphabet sont bonnes sans leur soupe.” Le jeune homme sera d’ailleurs récompensé par le prix du meilleur orateur de la soirée.
Cette volonté de gagner en faisant preuve de souplesse oratoire et non de précision argumentaire est également due aux critères de notation présentés par Monsieur Mc Cavana : “Les quatre critères sont : premièrement, l’argumentation ; deuxièmement, la présentation, c’est-à-dire tout ce qui est contact avec le public, capacité de discours ; troisièmement, la stratégie ; quatrièmement –et ça c’est très important–, le ‘je ne sais quoi’, en anglais la star quality. C’est le ‘Purée !’ quand t’entends quelqu’un parler.” Les joutes sont impressionnantes –il faut un cran certain pour parler devant des centaines de personnes dans un tel lieu. Sur la forme, en tout cas, car le fond est parfois laissé de côté. Surtout ne pas se poser de questions sur l’évolution de la politique actuelle si, à l’image de ce spectacle, seule la forme, aussi intelligente et drôle soit-elle, est mise en avant.
La troisième mi-temps
Après une heure et demie de débat, et 30 minutes de délibérations, il est 22h. Le prix est remis par Son Excellence Geraldine Byrne Nason, ambassadrice d’Irlande en France à l’équipe de Nanterre. Grande première pour cette université, dont le groupe est composé de quatre filles sur cinq orateurs. Declan Mc Cavana est ravi : “Quatre femmes dont en plus trois femmes noires. C’est la France d’aujourd’hui ! Et pour moi, ce soir, c’était l’apothéose de ce que je cherche à faire depuis 23 ans. Ce soir, c’était magnifique. Je ne pouvais pas espérer mieux.”

Félicitations, émotions, puis appel du ventre. Entre coupes de champagne modérément remplies et petits fours de toutes les couleurs sous le plafond doré aux chandeliers écrasants, le cocktail est l’occasion pour la mondanité de reprendre le dessus. Les invités prestigieux vont complimenter les orateurs et les #SelfiesAssembléeNationale s’en donnent à cœur joie. Les élèves, coupe modérément vidée à la main, remplissent leur carnet d’adresses. Ce qui pourra leur servir quand ils deviendront à leur tour avocats, politiciens ou directeurs de grandes écoles. Mais en attendant, un petit groupe se dirige vers le seul pub irlandais du VIIIe arrondissement de Paris, où l’ambiance devient franchement plus décontractée. Ces orateurs, impressionnants durant la finale, redeviennent des étudiants de deuxième ou troisième année de licence, volontiers enclins à discuter autour d’une bonne bière.
MH370 : un nouveau débris au Mozambique ?
 Blaine Gibson et sa découverte.
Blaine Gibson et sa découverte.C’est le dernier épisode en date d’une affaire riche en rebondissements : un débris retrouvé au large du Mozambique pourrait provenir du MH370, l’avion de la Malaysia Airlines disparu il y a maintenant près de deux ans, le 8 mars 2014. La nouvelle, révélée par la chaîne américaine NBC, serait la seconde pièce de l’appareil à faire surface après le flaperon retrouvé l’été dernier sur les côtes de La Réunion et authentifié depuis comme provenant effectivement du Boeing 777 de la Malaysia Airlines.

Un homme est à l’origine de cette découverte : Blaine Gibson. Présenté comme un “blogueur” par la presse américaine, Blaine Gibson est un personnage un peu fantasque, un romantique au look californien 70’s qui aime porter des chemises hawaïennes. Il est aussi une des figures emblématiques de la communauté du MH370 qui traque les traces de l’avion et commente l’affaire sur les nombreuses pages Facebook et blogs qui y sont consacrés. Il sillonne le monde depuis deux ans à la recherche d’indices. “J’étais en voyage au Mozambique, raconte-t-il aujourd’hui pour la première fois, depuis Maputo. J’en ai profité pour me dire : pourquoi ne pas louer un bateau et prendre un jour pour inspecter les côtes?”
Quelques heures après son départ en compagnie de trois Mozambicains, le propriétaire du bateau, “Junior”, interpelle Blaine. “Il a pointé quelque chose du doigt. C’était un bout de plastique, assez léger. Dessus, il est inscrit ‘NO STEP’”. La pièce, triangulaire, mesure 94 centimètres de large et 60 centimètres de haut. Elle semble, indique Blaine Gibson, provenir “de l’aile d’un avion”.
L’Américain remorque alors la pièce jusqu’à la ville la plus proche, où il se concerte avec le directeur de l’aéroport local pour avoir l’autorisation de transporter l’objet jusqu’à la capitale Maputo. Gibson appelle également l’Australian Transport Safety Bureau (ATSB, l’organisme officiel qui enquête sur les accidents aériens) et fait parvenir des photos de sa découverte. Une fois à Maputo, l’Américain a rencontré le consul honoraire d’Australie et le directeur de l’aviation mozambicaine, à qui il a remis la pièce. “Celle-ci a été envoyée en Australie, dit-il, où elle va être analysée par les autorités australiennes, la Malaisie et par Boeing.” “Sur la base des premières informations, il est fort possible que le débris retrouvé au Mozambique provienne d’un B777”, a indiqué le ministre malaisien des Transports, Liow Tiong Lai. Blaine Gibson préfère, lui, ne pas s’avancer, “par respect pour les familles et pour ne pas déclencher espoir ou désespoir”.

“On trouvera l’avion un jour”
Le jour de la disparition du Malaysia Airlines 370, cet ancien avocat de l’État de Washington venait de vendre sa maison de famille en Californie et faisait ses cartons devant CNN, qui couvrait les recherches 24h/24. Il a fait ses valises et ne les a plus jamais posées. Depuis ce 8 mars 2014, Blaine Gibson parcourt le monde avec sa crinière blonde et son t-shirt “Search On”. Il est allé en Thaïlande, a parlé à des pêcheurs en Malaisie, aux villageois birmans qui auraient vu un avion se
crasher, aux responsables australiens de la recherche en mer, à des pilotes, à des contrôleurs aériens. Il publie les comptes rendus détaillés de ses aventures sur Facebook, s’attire les foudres de certains, l’admiration des autres. “J’aime voyager, dit-il, glissant ici et là quelques mots de français hérités d’un vieux séjour universitaire à Bordeaux. Et je préfère rencontrer les témoins en personne que rester à fouiller devant mon ordinateur. Autrefois, j’ai fait de l’archéologie en Amérique centrale, pour découvrir ce qui était arrivé aux Mayas. Je me suis intéressé à l’Arche d’Alliance. J’adore les mystères, et celui-ci est l’un des plus grands mystères de notre histoire.” De ses enquêtes, il ne tire aucune théorie, mais pense que les habitants des Maldives ont bien vu le Malaysia Airlines le matin du 8 mars. Il souffle aussi que les données Inmarsat pourraient avoir été trafiquées par une équipe voulant détourner l’avion incognito. “Je n’affirme rien, je ne crois à aucune théorie du complot. Je pense qu’on trouvera l’avion un jour, il le faut. En attendant je dis: trouvons des preuves!”
 Lire : la grosse enquête de Society sur la disparition du vol MH370 dans le Society #22
Lire : la grosse enquête de Society sur la disparition du vol MH370 dans le Society #22
“Kanye West était un ultracréatif”
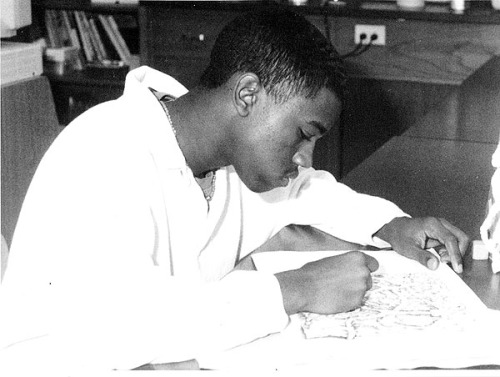 Quand Kanye West était premier de la classe.
Quand Kanye West était premier de la classe.Qui était le Kanye West que vous avez connu ?
Kanye a été mon élève pendant quatre ans. Je me rappelle l’avoir rencontré quand il était encore freshman (l’équivalent d’un élève de troisième, ndlr). Il était impatient de me montrer ses dessins et les cartoons qu’il s’amusait à faire. Je me souviens notamment de ce que j’appellerais un autoportrait non traditionnel, très symbolique, avec des références à son amour et son intérêt pour la musique. Et en sophomore, il a créé un remarquable tableau au crayon à papier représentant les luttes continuelles de l’homme noir au sein de la société américaine. Kanye a toujours ses dessins avec lui me semble-t-il.
Kanye West a souvent répété qu’il était un artiste depuis ses 5 ans. Vous vous en êtes rendu compte à l’époque ?
C’était un artiste visuel extrêmement talentueux pour quelqu’un de son âge. Il excellait à la fois dans la technique artistique pure, que ce soit pour le dessin, la peinture ou le design, et dans les questions conceptuelles. C’était un ultracréatif.
Ce n’est sans doute pas le seul élève talentueux que vous ayez connu pendant votre carrière. Est-ce que quelque chose le différenciait des autres ?
Bien sûr, j’ai connu énormément de gamins doués, et Kanye était l’un d’entre eux. Mais il avait quelque chose en plus, cette confiance en soi, ce dévouement : il passait l’essentiel de son temps libre pendant et après l’école à travailler sur sa musique, à devenir un artiste.
Quel type d’éducation transmettiez-vous à vos élèves ?
Je pense qu’une des choses les plus importantes qu’un professeur d’art peut transmettre à ses élèves est de les aider à comprendre comment l’art rentre dans leur existence ; pourquoi l’art est une composante si importante de la société et de leurs vies ; de quelle manière l’art transforme le quotidien ; quel pouvoir ou contrôle l’artiste peut avoir sur le changement des opinions, des manières de penser ou même de la société. Avec Kanye, nous parlions beaucoup, essentiellement d’art et de musique. Je lui donnais des conseils, qu’il le demande ou non ! Nous nous entendions très bien, et j’ai toujours aimé l’avoir en classe autour de moi.
Kanye West était très proche de sa mère. Vous vous souvenez de “Miss West” ?
J’ai rencontré Mme West à plusieurs reprises, notamment lors des rencontres parents/professeurs. C’était une femme très gentille, extrêmement éduquée, et très concernée par le futur de son fils. Je pense qu’elle lui a donné les outils et les possibilités pour qu’il développe sa musique, elle comprenait son besoin d’essayer de réussir dans l’industrie musicale. Elle était son socle, son roc, son support moral pendant ses débuts et ses premiers succès, jusqu’à son décès…
Sa mort en novembre 2007 semble avoir plongé Kanye West dans une sévère dépression. Vous vous en souvenez comme d’un enfant heureux ?
Il semblait l’être, tout du moins en salle d’art plastique ou de musique. La quête de la perfection qu’il recherche aujourd’hui n’était pas un obstacle à l’époque, il était juste trop bon dans ce qu’il faisait.
Vous l’avez revu ?
Je suis resté en contact avec Kanye plusieurs années après le lycée. Il était alors inscrit en école d’art pendant un an, puis est entré à l’université, avant de tout lâcher pour poursuivre sa carrière musicale. La dernière fois que je l’ai vu, c’était avant un concert à Chicago, je lui ai demandé s’il avait toujours du temps à consacrer à l’art en général, au-delà de sa musique. Il m’a dit que oui, il m’a dit que l’art était tout pour lui. J’ai été très heureuse d’entendre cela.
Last Train : Mind the Gap
 Photo : Christophe Crénel
Photo : Christophe Crénel
“Je te jure, quand il a descendu les marches pour Tennessee, j’ai chialé. J’ai chialé comme une madeleine.” Au-delà de la vapeur des cafés et de la fumée des cigarettes symptomatiques des lendemains de soirée, la salle de l’AccorHotels Arena s’élève non loin derrière la véranda. La veille au soir, les quatre membres de Last Train s’y produisaient devant une bonne douzaine de milliers de personnes, ouvrant la soirée pour Johnny Hallyday et devenant au passage les plus jeunes musiciens français de l’histoire de la salle. Pas transformés pour autant, Jean-Noël, Julien, Antoine et Tim chantonnent Marie et se demandent si Johnny abandonne vraiment une paire de Ray-Ban par soir. “Je lui ai dit bonjour”, précise Jean-Noël, 21 ans. On a eu genre une conversation d’une minute. Il a dit: ‘Bienvenue chez nous.’ Mais mec, c’est Bercy, c’est pas chez toi!” Le verdict est unanime: “C’était assez dingue.” “En fait, ça fait deux mois qu’on sait qu’on va faire la première partie de Johnny. Depuis deux mois, on se dit à chaque concert ‘allez, c’est Bercy ce soir!’ alors qu’on joue dans des bleds pourris, on est là genre: ‘Alors, il est où Johnny?’ Sauf qu’hier, il était là.”
“Julien, il savait pas jouer de la guitare. Peut-être qu’il sait toujours pas”
Il y a dix ans, dans un village “pas super sexy” en Alsace, les garçons ont 11 ans, vont à l’école avec des cartables de sixième, s’intéressent parfois au foot, ont une enfance “commune”. Autour, c’est la campagne, les champs. Parfois, ils vont acheter des t-shirts au H&M de Mulhouse. Plus tard, ils pousseront jusqu’à Strasbourg pour des concerts à La Laiterie. Surtout, entre les premiers cours d’anglais et la vie de famille dans la campagne du Nord, on cherche à s’occuper. Jean-Noël joue de la guitare dans sa chambre, Antoine de la batterie dans la sienne. Le premier se souvient: “J’ai dû dire ‘bon ben je viens chez toi’, ensuite on a invité Julien à venir jouer avec nous. Sauf que Julien, il savait pas jouer de la guitare. Peut-être qu’il sait toujours pas… Et puis c’est devenu ‘viens, on monte un groupe de rock’. Mais avec une plus petite voix, parce qu’on n’avait pas encore mué.” Il existe des photos, quelque part dans une boîte à chaussures, des Last
Train à 11 ans, s’efforçant de maîtriser des instruments plus grands qu’eux –peut-être réapparaîtront-elles un jour, quand il faudra répéter à l’infini l’histoire de la création du groupe. Pour l’instant, on enchaîne les cigarettes en regardant les gens passer sur le trottoir, et en essayant de se souvenir du premier concert. “C’était chez Fanny!” Et puis, non. Est-ce que c’était le Téléthon? Ou dans un quelconque bar local? La mémoire leur revient: c’était le 19 juin 2009. Ils avaient 13 ans. “Dans le local d’une association qui faisait de l’éveil à la nature pour les enfants, dans un petit village perdu en Alsace. Ils avaient fait les choses en grand: il y avait une sono, une scène et même une banderole avec le nom du groupe. Une banderole, putain. Presque mieux que Bercy.” Les garçons grandissent et se perfectionnent, sans trop y penser. Ce qui leur plaît, ce sont les concerts. Les concerts n’importe où, devant n’importe qui, n’importe comment. Au collège, puis au lycée, dans les bars du coin. Mais vite, le coin ne suffit plus. À 17 ans, ils organisent leur première tournée –six dates sur le territoire– et passent par Strasbourg, Paris, Bordeaux, Lyon. Il y a des soirs où, pour un cachet symbolique de 100 euros, tout se passe bien ; et d’autres, moins. “On a fait trois dates d’affilée à Paris, les deux premières bien, et la troisième… C’était à Belleville, il y avait personne. Peut-être cinq personnes dont trois potes. C’était glauque.” Tant pis, les garçons rentrent chez eux avec une conviction: il va falloir repartir au plus vite. Il y a le bac, il y a les études pendant deux ans, un effort non négligeable pour une jeunesse qui veut voir au-delà de Strasbourg. Pendant six mois, “jour et nuit”, Jean-Noël et Julien ne travaillent plus qu’à l’organisation de la tournée suivante, plus ambitieuse, plus longue. Aujourd’hui, le souvenir répond au doux nom de “tournée-suicide”: “On s’est endettés de 5 000 euros pour acheter un van. On a produit notre premier clip, on a produit deux morceaux. Et on est partis pour 22 concerts en 25 jours, en France et en Europe. On n’était pas payés, on dormait souvent chez l’habitant, c’était n’importe quoi, presque suicidaire. Là, on sortait de nulle part. Quand on en parle aujourd’hui avec des groupes qui commencent, ils nous demandent comment on a fait pour avoir autant de dates, mais il faut se donner la peine, on jouait pour que dalle, si on n’avait pas pris de risques, on serait toujours en train de faire griller des burgers au Quick.”
Refus fiers et système D
Prendre des risques, tout faire tout seuls: un processus qui devient peu à peu une habitude tenace. Une façon de faire de la musique popularisée aux États-Unis dans les rues sombres de Brooklyn, avant que le DIY ne devienne surtout synonyme de bijoux en papier kraft sur Pinterest. Mais les mecs de Last Train ne regardent pas vers les États-Unis, ils ne regardent pas grand-chose, d’ailleurs, à l’exception de la prochaine étape. Auréolé de sa victoire au tremplin des Inouïs au Printemps de Bourges, le groupe voit son nom se murmurer dans les couloirs des labels parisiens. Le téléphone sonne. “On faisait le booking tout seuls, remet Tim, mais on prévenait quand même les tourneurs pour dire: ‘Hey coucou, regardez ce qu’on fait.’ Quand ils ont commencé à nous rappeler, on répondait: ‘Non merci, mais venez quand même à notre concert.’ Il y avait un peu de fierté dans nos refus, mais on voulait prouver qu’on pouvait se débrouiller seuls.” De cette volonté de garder le projet en main, naîtra Cold Fame Records, le label créé
par Jean-Noël et Julien qui, histoire de contourner encore la facilité, décident de produire trois autres groupes de la région. À Lyon, leur petit bureau vit sa vie pendant que Last Train s’apprête à passer l’année 2016 sur la route. “On n’a pas de thunes, mais on paye nos bureaux, on paye deux employés, on produit et réalise nos clips”, annonce Jean-Noël, avant de jeter un regard par la fenêtre. “Bien sûr qu’on peut se planter, soupire-t-il avec un sourire en coin qui ne laisse présager aucune intention de laisser cette possibilité au hasard. “Mais si on tente pas, si on reste dans le confort, on prend pas de risque et c’est le risque qui paye.”
Et effectivement, le risque commence à payer. S’enchaînent Bars en Trans, Garorock, Rock en Seine, la Flèche d’Or, les articles dans la presse et un florilège d’apparitions dans des “tops 5 des groupes à surveiller”. Dans les conversations d’après minuit, on fait des raccourcis allant des “nouveaux Brian Jonestown Massacre/Black Keys/Arctic Monkeys/Black Rebel Motorcycle Club” à “l’esprit Wu Lyf”. Bien avant minuit, Francis Zegut repousse les limites de ses plages horaires et offre à Last Train une émission de deux heures sur RTL2 le 10 novembre dernier. Aujourd’hui, il est encore “plutôt fier d’avoir croisé leur chemin” et s’émerveille de leur “intensité incroyable”: “des racines, de l’électricité, autour de guitares rageuses à une époque où cet instrument est banni des médias, c’est ça le rock et Last Train en est l’exemple incarné”, assure-t-il. Les superlatifs se mêlent, la tournée s’allonge, et dans une industrie qui pousse chaque artiste à pondre un LP au premier alexandrin dans Les Inrocks, Last Train a dix ans d’expérience et pas d’album à l’horizon. “On a sorti deux EP et encore, on vous a bien niqué sur le deuxième, il y a trois chansons déjà sorties”, rectifie Jean-Noël. “C’est tout bête, on est un groupe qui vit par le live. Pour l’instant, on considère que c’est plus excitant de nous voir et de nous entendre en vrai que d’écouter notre EP chez soi. Ça sert à rien de sortir un album si personne n’est là pour l’écouter.” “Et puis on n’a pas envie de le foirer”, ajoute Julien.
15h. La scène 360 les attend pour de nouvelles balances. Et demain, ce sera le départ pour l’Angleterre. “On n’a pas voulu faire de ces deux soirs à Bercy un événement en soi, remet Julien. On a notre histoire, on y tient, on veut pas être ‘le groupe qui a fait la première partie de Johnny’. Pour nous, ce n’est pas un but, c’est une étape vers la suite. On continue.” Faut-il encore retourner sur scène ce soir, devant 15 000 personnes venues entendre Que je t’aime. “On a 30 minutes, faut y aller à fond et ne jamais s’arrêter parce que si tu t’arrêtes… les mecs se souviennent qu’ils sont pas là pour toi”, rappelle Tim. Mais ce soir, c’est sûr, ils seront en place, plus à l’aise que la veille. Bercy, un peu du déjà-vu.
Aller : le 10 mars à la Maroquinerie, Paris
Le boucher à oreille

Dans ce petit troquet du XIIIe arrondissement de Paris, alors que les habitués en sont à leur troisième “petit pastis pour digérer”, Mme Mandelbaum-Reiner, née de parents polonais il y a 80 ans, évoque ce qu’elle connaît le mieux : le louchébem. C’est simple, elle est la spécialiste française –et donc mondiale– de cette langue dont la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (CFBCT) date l’apparition au XIXe siècle. “J’ai grandi dans la rue, à Paris, rembobine-t-elle. C’est l’école obligatoire et laïque qui m’a appris à parler le français ‘normal’, car toute mon enfance, je parlais le ‘français des pauvres’, un argot mâtiné de yiddish et de polonais. En bas de chez moi, dans le XXe arrondissement, le patron boucher et son commis parlaient couramment le louchébem. Alors quand à la fac, un professeur de linguistique a expliqué que cet argot avait disparu, moi, j’ai dit du fond de la classe : ‘C’est la plus grosse connerie que j’aie entendue.’”
Pour elle, la langue des bouchers n’est autre que du français “en caoutchouc”. Le principe : on prend un mot français et on le met en verlan (par exemple, “boucher” devient “ouchéb”), on ajoute un “l” devant, et à la fin, on colle une syllabe qui n’a rien à voir ; ce qui donne “louchébem”. Donc littéralement, parler le louchébem, c’est parler la langue des bouchers. Si la théorie semble simple, Madame Mandelbaum-Reiner calme toute ardeur : “S’ils (les bouchers) vous parlent en louchébem, il n’y a aucune chance que vous compreniez. Cela suppose un entraînement sportif de haut niveau pour le parler et le comprendre.”
Boucher, une caste à part
Selon Madame Mandelbaum-Reiner, ce langage remonte au Moyen Âge. À cette époque, beaucoup de corporations avaient leur propre argot. Mais ce qui explique que le louchébem a perduré jusqu’à maintenant, c’est que la corporation des bouchers de Paris était très riche et puissante. Aussi, c’est un métier à part, de par son rapport au sang et la mort qui lui offre une place fantasmatique dans la société. C’est pour briser cette image du “boucher avec son grand tablier plein de sang et son grand couteau” qu’en 2012, la CFBCT a d’ailleurs demandé à une trentaine d’écrivains et célébrités d’écrire dans un journal intitulé Le Louchébem.
Et ce langage étant aussi étrange qu’ancien, il n’est pas si étonnant de trouver aujourd’hui des mots qui en sont issus entrés complètement dans le langage courant, comme “loufoque” qui, en argot, veut dire “fou” –même si Madame Mandelbaum-Reiner est formelle : ce n’est pas du louchébem à proprement parlé mais du “largomuch du louchébem”, c’est-à-dire l’argot du louchébem. Pour ceux qui aiment pinailler.
Une conspiration de bouchers ?
“Les bouchers d’une soixantaine d’années parlent tous louchébem”, assure la spécialiste. Un “argot de travail” que seuls ceux qui tuent les bêtes et découpent la viande ont le droit de parler. Les femmes de bouchers le comprennent mais, traditionnellement, ne l’utilisent pas. Les plus jeunes, eux, connaissent seulement quelques mots très spécifiques, comme l’explique le boucher de La Grande Boucherie, rue Saint-Honoré à Paris : “C’est plutôt des mots qu’on dit maintenant, on va pas faire trop de phrases. C’est une tradition, sur des morceaux de viande, sur des clients, on dit une ‘lamdé’ pour une dame, un ‘lesieumic’ pour un monsieur.” Une des raisons de la création du louchébem est de “vider la chambre froide”. En effet, combien de noms de parties de l’anatomie bovine ou ovine connaissons-nous ? Trois ou quatre au mieux. Donc il faut, pour que la bête morte soit totalement vendue, que le boucher trouve un stratagème : “Si la cliente ou le client demande du quasi de veau, il faut la(le) contenter même s’il ne reste plus de quasi de veau, explique Madame Mandelbaum-Reiner. Le but est alors de lui vendre ce qu’il y a de plus proche. Le patron communiquera le nom de cette pièce à son commis en louchébem pour ne pas être compris. Mais cela demande aussi de la mémoire, parce que si cette même personne revient et qu’elle veut absolument la même viande que la fois précédente, il faut se rappeler ce qu’on lui avait donné.” Bref, “pour être boucher, il faut avoir un sacré cerveau”.
Pourtant, l’avenir du langage des métiers de la viande paraît incertain. La patronne d’une boucherie dans le XXe arrondissement de la capitale est catégorique : “Chez moi, je leur interdis de parler comme ça.” Beaucoup de bouchers disent aussi ne plus le parler parce que “c’est pas très très poli pour le client”, même si apparemment, le client ne s’en rend jamais compte. Alors le louchébem va-t-il réellement disparaître ? Selon Madame Mandelbaum-Reiner, cette langue secrète depuis toujours sera encore parlée dans des centaines d’années, “parce qu’il y a toujours besoin de clandestinité dans la langue, que ce soit pour l’amour, pour le crime ou pour le commerce. Il n’y a pas de langue sans l’argot.” Pas de côté clair de la force sans le côté obscur.
George Khosi, le ring et les gangs

Il est 6h. Les rues du centre-ville de Johannesburg sont pleines de bagnoles ralenties par la foule. Des passants les contournent d’un pas rapide. Tout se passe dans un boucan rythmé par un mélange de klaxons et de kwaito, la house locale. Plantée à un coin de rue, derrière deux grillages et trois tonnes de barbelés, une vieille station-service bleu givré et blanc cassé. Décrépite. Le Hillbrow Boxing Club. “George est à l’intérieur”, souffle un boxeur à la trogne fatiguée assis dehors, à coté du ring. La salle est remplie. Certains poussent de la fonte, d’autres s’acharnent sur des sacs de frappe. De son côté, George rythme une séance de stretching. “One two, one two”, gueule-t-il aux deux femmes installées sur des tapis face à lui. Il a un trou sur la jambe droite, une sale cicatrice. Sur les murs en brique, plusieurs clichés retracent sa jeunesse. L’un d’eux est encadré. Avec, en bas de la photo, écrit à la main : “‘THE BEST’, 266 FIGHTS, LOST 4, WON 262.” Ruisselant de sueur, le quadra clopine, attrape une serviette et essuie les gouttes qui lui coulent le long de son œil blanc. Essoufflé, il finit par lâcher : “Je finis la séance et après, je te raconte.”

Entre 1986 et 1998, George Khosi a mené une carrière de boxeur professionnel qui ne lui était pas franchement offerte. Car avant d’être le champion local, il était le gamin d’Hillbrow, quartier réputé pour être l’un des plus dangereux de Johannesburg. Le coach James Ike a lui aussi grandi dans le coin. “Si t’as pas d’amis ici, tu vis dans la peur”, pose-t-il, accoudé au ring. Puis, il rembobine l’histoire du quartier. “Quand j’étais petit, il n’y avait que des Blancs ici, c’était un
quartier juif. Puis, c’est devenu une ‘grey area’, il y avait de la diversité. Joburg est une ville d’opportunités. Pour les étrangers, c’était un endroit qu’ils pouvaient appeler ‘chez eux’. Un sourire goguenard et le type claque des doigts. À la fin de l’apartheid, les Blancs sont partis. Ils devaient avoir le sentiment qu’ils avaient perdu une bataille, c’étaient pas les plus courageux.” Résultat : des immeubles entiers ont été désertés du jour au lendemain et ont été récupérés par les gangs. Dans les années 90, Hillbrow traînait une réputation de “coupe-gorge” incurable. “Ça va mieux aujourd’hui. Avant, c’était un enfer mais ça s’améliore un peu.” Depuis une dizaine d’années, Hillbrow est une zone d’urbanisation prioritaire et les hijacked buildings sont peu à peu récupérés par des entreprises privées. Mais le quartier en compte encore quelques-uns. Des bâtiments vétustes, aux fenêtres éclatées et aux façades noircies par les incendies liés à la précarité des accès à l’eau et à l’électricité. Des familles s’y entassent, et payent un loyer qui tombe directement dans la poche des hijackers.

De la taule aux rings de Soweto
De fait, George a lui aussi tâté des gangs d’Hillbrow. “À 13 ans, je faisais de la merde, des vols, des agressions, évacue Khosi en bouffant ses mots. J’y connaissais rien, à la vie.” Le déclic de la boxe a eu lieu au détour d’une arrestation et d’un séjour en taule. “Je me suis battu quand ils m’ont arrêté. Je me battais tout le temps. Alors, en sortant de prison, je me suis dit : “Mets-toi à la boxe.”” Et le ring devient vite une passion pour George, qui enquille les victoires. “Je me rappelle mon plus grand match. C’était contre un Blanc, la salle était pleine. Et ça se passait à Soweto, alors mon entraîneur m’a dit : “Il vaut mieux que tu le gagnes, celui-là. Si tu perds, on a intérêt à partir vite””, décrit l’homme en esquissant un sourire qui découvre ses dents du bonheur. Mais la carrière de Khosi s’arrête net, un soir de 1998, quand deux voleurs débarquent dans son appartement. “Ils m’ont mis une balle dans la tête et m’ont tiré dans les jambes, raconte-t-il en découvrant une petite cicatrice à côté de son œil droit. Des gamins m’ont trouvé et m’ont emmené à l’hôpital, la boxe était terminée pour moi.” George est remis sur pied deux ans plus tard et se met alors à entraîner les gamins du quartier. “C’est important que ces enfants ne traînent pas dans les rues comme je l’ai fait, je suis content de ce que j’ai accompli.” En 2004, l’église du coin lui confie la station-service, qui fait alors
office de centre d’hébergement pour de très jeunes sans-abri. La petite affaire de Khosi est un véritable carton. “Il doit y avoir une centaine de gens qui viennent s’entraîner ici, ça n’arrête jamais, les cours pour les enfants sont gratuits ; les autres, on les fait payer 120 ZAR (soit 9 euros la séance, ndlr). J’aimerais bien que ce soit moins cher mais la ville ne file aucun coup de main, donc qu’est ce que je peux faire ?” soupire-t-il en descendant l’escalier qui va à la cave, où une douche est installée. C’est là que vit George. Sa chambre est cachée derrière un rideau. Une vieille télé de récup’ et d’autres photos en vrac. Khosi sort deux, trois peignoirs de boxeur d’un tiroir, pour les filles qui se battent ce week-end. Il remonte l’escalier. “Attention la tête!” lâche-t-il en désignant le plafond, un peu bas, sur lequel est écrit “DANGER” au feutre noir. Une fois à l’étage, le coach interpelle deux boxeurs en sifflant. Il est l’heure de s’y remettre.

“George, c’est pas un tendre”
Parmi les jeunes que Georges entraîne, il y a Archie Gaba, 23 ans, physique longiligne. Plutôt frêle, pas franchement la carrure d’un boxeur. “Ça fait un petit moment que j’ai décroché de la boxe”, se justifie-t-il, le visage barré d’un large sourire. Et de renchérir : “Mais venir ici, ça a sauvé ma vie, sans George et sans ce sport, je serais dans la rue.” Archie a 17 ans quand son frère ramène son pote George à la maison. “Quand je l’ai vu pour la première fois, je me suis dit que c’était un gangster, le boss des tsotsies (mot zulu pour “gangster”, ndlr). À l’époque, je fumais, je passais mon temps dans les rues. Il m’a vu souffrir et m’a aidé. Une fois, je me suis ramené à la salle à 2h du mat’. Il m’a gueulé dessus, il était furieux. Il me criait : “Qu’est ce que tu fais dehors à cette heure-là, tu veux te faire tirer dessus ou quoi ?” Il m’a appris à me fixer un objectif et à me battre pour l’atteindre. La boxe, ça m’a appris à être patient, on ne devient pas un champion du jour au lendemain. Moi, je n’ai pas connu mon père et George joue un peu ce rôle-là pour les jeunes. Mais George, c’est pas un tendre. Il peut être très dur, il dit toujours qu’il est là pour nous aider à monter la première marche. Après, c’est à nous de jouer”, assure le jeune homme qui gagne sa vie en faisant le coursier. Il espère pouvoir suivre prochainement une formation à l’entrepreneuriat.

Au boxing club, Archie n’est pas le seul à avoir un parcours cabossé et à s’en être sorti grâce à la boxe. Dans un coin, le Gabonais Patrick Mavoungou, vice champion d’Afrique en 2009 et 2011, cogne un sac de toutes ses forces. Au bout de dix minutes, il titube. Celui qui cache son visage derrière ses gants de boxe rafistolés a 36 ans mais l’air d’en avoir 50. Il s’appuie au mur, le temps de reprendre ses forces. “Je suis arrivé l’an dernier et j’attends mes papiers. Sans ça, je ne peux pas boxer en pro. Mon problème, c’est que je ne mange pas, assure-t-il. Je suis venu parce qu’on m’a dit qu’il y avait beaucoup de combats à Joburg et que je pourrais m’en sortir. Je me lève à 4h du mat’ et je cours plusieurs heures, puis je viens ici. Ensuite, je dors un peu et j’essaye de manger.” De son sac de sport, il sort trois vieilles photos. Des souvenirs de ses succès. George les lui arrache des mains. Pas question de parler du passé. Patrick se remet à frapper le sac. “Ça, c’est tout ce que je sais faire et je ne peux rien faire d’autre.”
Pascal Cherki : “On est français pour le meilleur et pour le pire”

Vous avez publiquement affiché votre opposition à la déchéance de nationalité pour les binationaux. Pourquoi ?
Je suis contre la déchéance pour les binationaux comme pour les autres. Ce n’est pas une réponse pertinente et ça n’a aucune efficacité dans la lutte contre le terrorisme. Ce qu’on attend d’un gouvernement dans la lutte antiterroriste, c’est qu’il empêche les attentats ou en tout cas la plupart d’entre eux, puis qu’il retrouve les auteurs et, s’ils sont vivants, qu’il les condamne pour les crimes commis. Tout le reste, c’est du débat politicien qui n’a aucun intérêt. Le seul résultat, c’est le trouble dans notre pays. Je suis contre la déchéance de nationalité pour les binationaux. Elle existait déjà pour les naturalisés et on a toujours été contre son extension envers les nés-français. On est français pour le meilleur et pour le pire.
Cette mesure symbolique n’empêchera pas les actes terroristes…
(Il coupe) Ce n’est pas qu’elle soit symbolique, le problème, mais qu’elle soit contraire à toute tradition juridique. Jusqu’à présent, on avait toujours considéré qu’il ne fallait pas toucher aux mécanismes d’attribution de la nationalité française : par la filiation, le sang, le droit du sol. On est en train de faire quelque chose d’absolument contraire à nos valeurs juridiques et républicaines.
C’est le Premier ministre, Manuel Valls, au moment de la présentation de la réforme constitutionnelle, qui disait qu’elle était symbolique.
Premièrement, cette mesure a des effets stigmatisants. Deuxièmement, en matière de terrorisme, il faut prendre des engagements efficaces tout en maintenant nos principes fondamentaux juridiques ; or cette mesure y est contraire, selon moi, et n’a aucune efficacité. Ça ne sert à rien de couvrir d’opprobre les binationaux, il faut réunir les Français autour de la cause commune de la défense des valeurs de la République.
On perd du temps sur ce débat, selon vous ?
Absolument. La sagesse commanderait qu’on abandonne purement et simplement ce projet de déchéance de nationalité, que ce soit pour les plurinationaux ou les mononationaux, pour ne pas se mettre à fabriquer des apatrides. Même si ça a été présenté par le président durant le Congrès, il ne faut pas retenir cette réforme constitutionnelle. S’il faut ‘marquer le coup’ en prenant une mesure symbolique, je ne vois qu’une seule chose à faire –et une partie de la gauche est d’accord là-dessus : créer une peine de déchéance des droits civiques. On n’a pas besoin de toucher à la Constitution, il suffit de modifier le code pénal. La peine serait prononcée par un juge durant un procès pour crime terroriste. Il ne faut pas bouleverser la Constitution pour ça et on ne touche pas à la nationalité.
Quelle politique serait plus appropriée pour combattre le terrorisme ?
Je pense avant tout que la lutte contre le terrorisme est une affaire de services spécialisés. Il faut prévenir les attentats, donner des moyens à la police, à la justice antiterroriste. Des moyens humains et matériels. En sachant que le risque zéro n’existe pas. Dans le passé, nous avons déjà connu des attentats dans notre pays. Et ça reviendra à chaque fois que la politique extérieure de la France sera engagée à bon ou mauvais droit –mais plutôt bon à l’heure actuelle– contre les intérêts de groupes terroristes. Ils auront la tentation de faire pression. Il faut dire la vérité aux Français. Il faut sortir de l’émotion pour entrer sur le terrain de la rationalité. Bien sûr, cela pose d’autres questions : notre politique étrangère, la cohésion nationale, le rassemblement du peuple français… C’est une illusion de croire qu’on va régler le problème terroriste en modifiant la Constitution et en prenant des mesures sous le coup de l’émotion avec des buts politiques ou politiciens alors que la lutte antiterroriste nécessite avant tout des moyens.
Est-ce que ce n’est pas aussi se voiler la face et ne pas assumer la part de la France, pour des raisons diverses (sociales, sociétales, économiques), dans la radicalisations de ces terroristes français ?
Attendez, il n’y a pas d’excuses au terrorisme ! Le fait de se sentir opprimé ou tout ce que vous voulez ne justifie pas que vous alliez commettre un crime
terroriste en tuant des dizaines de personnes dans une salle de spectacle. Après, faut-il réfléchir sur le pourquoi de la radicalisation de gens basculant dans un combat internationaliste imaginaire ? Oui. Pour moi, c’est la même symbolique et la même dérive qui ont fait basculer des personnes dans les années 70 jusqu’au milieu des années 80 dans le terrorisme de l’ultragauche, style Action directe ou la Bande à Baader. Ils vont en Syrie de la même manière qu’ils s’engageaient dans la Bande à Baader. Que ça renvoie à une fracture dans la société française et qu’il faille s’y attaquer? Tout à fait. Mais c’est un combat différent de celui qui consiste à donner les moyens pour prévenir les attentats et protéger la population.
Cette déchéance de nationalité pour les binationaux, Nicolas Sarkozy l’avait proposée. Avez-vous l’impression que François Hollande et Manuel Valls virent à droite ?
Ce qui est sûr, c’est qu’elle est complètement étrangère au combat et aux valeurs des socialistes depuis que le Parti socialiste existe. Le Premier secrétaire, Jean-Christophe Cambadélis, l’a rappelé en disant que ce n’est pas une mesure de gauche. Je pense qu’il a raison, c’est une mesure d’extrême droite et une vieille revendication du FN.
Vous vous reconnaissez encore dans le gouvernement actuel en tant que socialiste ?
Je n’ai pas voté la confiance envers le gouvernement de Manuel Valls les deux fois pour des faits qui ne sont pas liés aux événements actuels. J’étais sceptique concernant la politique macroéconomique. Mais je préfère toujours ce gouvernement à celui de Sarkozy et Fillon.
Après le 13-Novembre, quelle mesure ‘de gauche’ aurait dû être prise, selon vous ?
Certaines mesures prises ont été très utiles, comme le renforcement des moyens pour recruter des policiers, du personnel dans les services de renseignement, des magistrats antiterroristes. Indépendamment des attentats, il faut s’attaquer aux inégalités. En janvier 2015, le Premier ministre a quand même dit à la presse qu’il y avait des pans entiers du territoire victimes d’apartheid social et ethnique. Quand on fait un constat de cette gravité, on doit avoir des mesures à la hauteur. C’est une question d’égalité républicaine. On ne peut pas se satisfaire du fait que dans certains endroits, il y ait 40 ou 50 % des jeunes au chômage ; qu’en zone rurale et en banlieue, les services publics soient délaissés et abandonnés par la République et ses institutions. Il faut faire du principe d’égalité une chose concrète et non abstraite pour les gens. Des actions sont faites, notamment dans les zones d’éducation prioritaires mais ça ne suffit pas et ça renvoie à d’autres débats sur la politique économique menée en France et en Europe.
The Wolfpack, le documentaire

The Wolfpack, de Crystal Moselle, retrace l’histoire des six frères Angulo, enfermés depuis leur naissance par leurs parents dans leur appartement de Manhattan, totalement coupés de la société. L’école leur est faite par leur mère à la maison et ils ne sortent qu’en cas de « nécessité », neuf fois, une fois, voire pas du tout au cours d’une année.
Leur seule échappatoire ? Leur passion pour le cinéma. Ils se feront ainsi une idée de la vie à travers plus 5 000 films en VHS, visionnés depuis leur canapé et à partir desquels ils se créeront un monde, costumes en carton ultraélaborés à l’appui.
Revoir : The Wolfpack, six frangins hors du monde, le samedi 9 janvier à 23h25, dans TRACKS, sur Arte.
Frites from Desire
 On dirait pas comme ça, mais ça fait beaucoup, un kilo.
On dirait pas comme ça, mais ça fait beaucoup, un kilo.“Victoire ou défaite, l’important c’est ma bite.” Les joueurs d’un club de Fédérale 3 de rugby qui célèbrent en chœur une troisième mi-temps ? Non, mais pas loin : des étudiants d’une école de chimie qui participent à un concours. Pas n’importe lequel. La grande finale de la première édition du championnat inter-écoles du plus gros mangeur de frites se tenait ce jeudi, chez De Clercq, Le Roi de la Frite, rue de Tolbiac dans le XIIIe arrondissement de Paris. Un bâtiment inauguré il y a un an et demi. “On a deux autres restaurants à Paris, mais c’est là qu’il y a le plus de place. Et puis, c’est un quartier étudiant”, justifie le fondateur de la chaîne, Thibaud de Clercq (“J’ai gardé le même nom parce que j’ai un nom belge. Pour faire de la frite, c’est crédible”). Début novembre, pour la phase préliminaire, l’homme avait réussi son coup marketing : sept écoles avaient répondu positivement à son concours, et les concurrents –au nombre de trois par établissement, désignés grâce à une présélection interne– s’étaient déplacés avec une armée de sympathisants venus boire et chanter à la gloire de leur promo, ambiance école sup’ oblige. Le tout vêtus de t-shirts à sigle. Ce coup-ci, pour la finale, les délégations sont beaucoup moins chargées. Seules trois écoles ont fait le déplacement : Chimie ParisTech, AgroParisTech et l’ESCPI. Le froid, les exams, les attentats ont eu raison de la motivation de certains. Mais pas que. “On a une soirée du BDE à Châtelet après, justifie un participant. Les gars n’ont pas voulu se fatiguer avant d’y aller.” Pire, une école, pourtant qualifiée, s’est désistée en début de semaine. “C’est le problème avec les étudiants, c’est pas toujours fiable, note l’entrepreneur. Il suffit qu’ils aient la flemme ou qu’ils aient pris cher la veille… Pour le prochain concours, on essaiera de contacter des comités d’entreprise. Ou alors la police, ils viennent souvent ici. Ils m’ont dit qu’ils étaient chauds. Il y a beaucoup de mecs du Nord dans les effectifs de police du coin, ils viennent ici faire découvrir à leurs collègues.”


C’est en jouant la carte de la frite belge authentique que De Clercq compte se différencier des autres enseignes de fast-food : ici, la pomme de terre est plongée dans la graisse de bœuf en plus de subir une cuisson classique, et les tarifs sont student-friendly : 4,90 € le cornet d’un kilo de frites, 6 euros et quelques le combo cornet standard/sandwich (fricadelle, burger au maroilles, etc.). L’opération du jour, elle, vise à faire connaître la marque via le bouche-à-oreille et fidéliser la clientèle étudiante, le noyau dur de ses aficionados. En jeu, des frites gratuites et à volonté offertes par De Clercq lors d’une prochaine soirée organisée par le BDE de l’école gagnante. Néanmoins, pas besoin de privatiser le restaurant pour l’événement. Ce qui a pu poser quelques problèmes pour la clientèle lambda lors du premier tour, refroidie par le boucan et l’affluence. “Je pensais manger sur place mais je vais prendre à emporter, il y a nulle part où s’asseoir”, expliquait un quadragénaire venu commander une fricadelle/frites.



20h, ça s’active en cuisine. La sono envoie de la Fanfare For Rocky pour accompagner l‘entrée en piste des étudiants affamés. Malgré la pinte de bière à 5 euros, le verre de cabernet sauvignon en cubi à 2,50 euros, et l’happy hour –“trois pintes pour le prix de deux sur chaque chanson de Jacques Brel”–, peu de monde se bouscule au coin buvette. “Moi qui croyait que les étudiants picolaient”, soupire un salarié derrière sa tireuse. Les gens présents sur place sont surtout venus pour en découdre avec la pomme de terre. On parle quand même d’une finale. D’ailleurs, le niveau de performance s’en ressent. Les trois concurrents alignés par les écoles en lice alignent doivent chacun finir leur kilo de frites en un minimum de temps, le chrono cumulé étant déterminant. “Le dernier coup, on avait des plateaux finis en 18 minutes. Là, on voit qu’on est montés d’un cran”, analyse Benjamin, venu soutenir Chimie ParisTech. Il y a un mois, pourtant, il était attablé face à sa montagne de frites. “Ouais, mais on avait monté une équipe de bras cassés à la va-vite, ce coup-ci on s’est préparés. Et ceux-là sont meilleurs que moi.” Mais pas aussi doués que Cyril, le champion des champions, qui défend les couleurs de l’ESPCI. Il y a un mois, il avait ingurgité son kilo de frites en 4’25’’. Ce jeudi, il a su se hisser à la hauteur de l’événement en améliorant son record : 3’45’’. Son secret ? Là où tout le monde privilégie une cadence frite par frite, lui y va par poignées, qu’il pré-écrase dans la paume de sa main. “Le verre d’eau d’entrée de jeu m’a fait gagner une minute, je pense. Faut pas mâcher, ça devient de la purée une fois en bouche et au bout d’un moment, on ne peut plus déglutir, théorise l’étudiant. Donc, moi, j’avale sans mâcher, je fais glisser le tout avec de l’eau. En fait, je pense que plus que la quantité, c’est le chrono l’ennemi. Il y a un temps seuil au-delà duquel on ne peut pas finir.” Voilà l’ESCPI largement favorite. Son collègue, Xavier, dit ‘Mousse’, achèvera le travail au son des “mâche, mâche, mâche” de ses copains de promo. “Je vais te dire : voir les autres souffrir quand on a fini, c’est un plaisir”, expose-t-il, après ses huit minutes de calvaire. ‘Mousse’ peut être fier : lors des sélections en interne, il avait mis quasiment le double de temps. “Je me suis réveillé à midi, j’ai pas mangé. Et j’ai fait du sport. Mais bon, avoir les crocs, ça permet de se lancer au début, mais quoi qu’il arrive, à la fin, on est dégoûtés. C’est le mental qui joue.” Et l’expérience ? “C’est vrai que j’ai déjà fait des concours de reblochon.”

Jean-Yves Camus : “Le problème, c’est l’autisme des politiques”
 jean-Yves Camus
jean-Yves Camus
Quels sont les enjeux et les inconnues de ce second tour des élections régionales ?
Certains récents sondages montrent une hypothèse de zéro région pour le FN. On a même des sondages qui donnent une marge assez importante à Christian Estrosi (LR, PACA, ndlr), Xavier Bertrand (LR, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ndlr) et Philippe Richert (LR, Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine, ndlr). Le zéro victoire du FN me paraît toutefois un peu trop beau pour être vrai. Les sondages sont très serrés. On est dans ce qu’on appelle la marge d’erreur. Donc, c’est entre zéro et deux régions pour le Front national. Dans tout ça, il y a plusieurs inconnues et notamment les reports de la gauche sur les candidats de droite. Je pense que le report des voix de la gauche sur Estrosi va être plus compliqué que ce que les sondages disent. Quand on a répété pendant des années qu’entre Estrosi, Ciotti, Tabarot et le FN, il n’y avait quand même pas beaucoup de différences, c’est compliqué de dire à ses militants qu’on va non seulement disparaître de l’Assemblée régionale pendant six ans, mais qu’en plus, il faut voter pour Estrosi. Les activités sport, nature et montagne vont être assez vigoureuses en PACA dimanche…
Il y a aussi la question de savoir si des gens qui ont voté FN au premier tour reporteront ou pas leur voix sur un autre candidat. D’ailleurs, dès l’annonce des résultats du premier tour, il y a eu les discours du genre : ‘Nous avons entendu la colère.’ Puis, Nicolas Sarkozy a recommencé à adapter sa ligne en disant : ‘Le vote FN n’est pas immoral.’ Mais tout le monde se rend compte que ce sont des choses qu’on a entendues à chaque fois que le FN faisait un bon score dans les urnes… Ça marche, ce discours-là ?
Le problème, c’est l’autisme des politiques. Et Sarkozy, par exemple, sait que ce discours ne marche pas. Il sait, par exemple, que les électeurs frontistes sont aussi exaspérés par son passage au pouvoir. L’impression que j’ai, c’est que la machine est bloquée. Il faudrait qu’en direct, un homme ou une femme politique ose dire : ‘J’ai merdé pendant 30 ans. Françaises, Français, je vous le dis, je me suis trompé pendant 30 ans sur la nature du vote FN et sur les moyens d’y remédier.’ Si vous voyez quelqu’un capable de faire ça, moi je ne le vois pas. Alors, dans les conversations privées, on a cet aveu qui consiste à dire : ‘On ne comprend pas ce qu’il se passe. On n’arrive pas à y répondre.’ À gauche comme à droite. Mais sitôt que la caméra est là, on en revient au discours rodé, convenu. Le pire, malheureusement, c’est que si le FN ne gagne aucune région dimanche, ce discours sera validé.
On a l’impression que quoi qu’ils fassent, ils sont coincés. Que dans les régions où le FN est en tête, la liste en troisième position risque de valider le discours LRPS du FN en se retirant, et qu’en même temps si elle ne se retire pas et que le FN gagne, elle en sera tenue pour responsable… Mais alors c’est quoi la solution ?
Je ne sais pas. On a besoin d’un big bang parce qu’il y a un énorme blocage. Qui est très lié aussi au recrutement de nos élites politiques. La question se pose de savoir si on peut avoir une classe politique qui est composée d’élus et de collaborateurs d’élus, et de partis politiques qui deviennent eux aussi des partis d’élus et de collaborateurs d’élus qui se cooptent. Je ne suis pas un fanatique du modèle anglo-saxon où on passe du corporate au public et vice-versa mais on a besoin d’élargir le cercle.
Pourquoi la colère se traduit dans les urnes par le vote FN et pas par le vote Mélenchon, Front de Gauche ?
Le FN, c’est 1972. Avec une première percée électorale en 1983-84. Le Front de Gauche, c’est beaucoup plus récent. C’est très jeune. Deuxième chose : le Front de Gauche n’est pas uni. Jean-Luc Mélenchon, Pierre Laurent, ce n’est pas la même stratégie. Troisième chose : Jean-Marie Le Pen a eu le temps d’installer une habitude du charisme ‘lepénien’, habitude qui s’est assez bien transmise à sa fille. Et puis, quatrième chose : la classe ouvrière a disparu. Du moins, quand elle existe encore, la majorité des ouvriers ne se considèrent plus comme faisant partie de la classe ouvrière aujourd’hui.
Dans ce contexte, on dit de plus en plus que le vote FN a tendance à devenir un vote d’adhésion plutôt qu’un vote de protestation…
Tout dépend ce qu’on entend par adhésion. Si on veut dire par là que les électeurs du FN ont lu le programme, qu’ils l’ont décortiqué, et qu’ils peuvent pour chaque item vous dire ‘je suis d’accord parce que…’, ce n’est pas un vote d’adhésion. Mais on pourrait le dire aussi pour les électeurs d’autres partis. En revanche, sur le FN, il y a quand même une batterie d’items qui, depuis le début des années 1990, structurent ce vote et qui sont plébiscités avant chaque élection
lorsqu’on demande aux gens leurs intentions: le chômage, l’insécurité, le rejet des élites, l’immigration… C’est un vote qui forme une vision de la société. Une vision autoritaire, une vision nationaliste, antieuropéenne, xénophobe. On est donc plutôt dans un vote qui se consolide. Et si vous prenez, dans l’histoire de France récente, les phénomènes de droite populiste et xénophobe, le mouvement Poujade naît officiellement en 1953. Mais cinq ans plus tard, en 1958 quand De Gaulle revient, le mouvement poujadiste est mort. Même après l’élection législative de 1956 où ce mouvement gagne les fameux 52 députés, dont Jean-Marie Le Pen, très vite les dissensions le minent. La guerre d’Algérie prend le dessus sur tout ça, et la protestation poujadiste part en miettes. Avec le FN, on est quand même face à un parti qui a franchi la barre des 10% en 1984. C’est quand même qu’il s’enkyste. Sur la carte de France du vote FN, on voit bien maintenant qu’il n’y a plus un seul département où on est à moins de 10%. Dans les années 1990, il y avait encore des départements, la Vendée, la Lozère, le Pays de Vienne, la Dordogne, la Creuse, où il fallait que le FN aille à la chasse aux champignons pour trouver des candidats qui faisaient 5%. On n’en est plus là. Même en Bretagne, qui a quand même été une terre de mission pendant très longtemps pour le FN, on est à 20%. Et la Corse dépasse tout juste la barre des 10%.
Certains analystes disent cependant que le FN ne progresse pas. Qu’il progresse certes en pourcentage mais pas en nombre de voix…
L’argument, à mon avis, est biaisé dans la mesure où on est à 6 millions d’électeurs, contre 6,4 millions à l’élection présidentielle. Sauf qu’on sait avant le scrutin régional que la participation sera beaucoup moins forte. La participation à l’élection présidentielle est traditionnellement beaucoup plus forte qu’aux élections intermédiaires. Donc, un différentiel de 400 000 voix entre la présidentielle et les régionales, ça ne témoigne peut-être pas d’une progression, mais en tout cas d’un socle qui se consolide. Et on constate que les électeurs du Front national renouvellent leur vote de scrutin en scrutin. Et aussi quel que soit le candidat. Parce que c’est un parti qui marche sur l’effet de marque plutôt que sur la personnalité. Que le candidat s’appelle Jean Dupont ou Pierre Tartempion, ce n’est pas très important pour l’électeur. On le voit bien. Les affiches sont parfaitement normées : Jean Dupont avec Marine Le Pen, Pierre Tartempion avec Marine Le Pen.
Qu’est ce qui fait que ce vote se consolide ? La crise, le chômage, ça on en parle mais est-ce qu’il y a d’autres facteurs ?
C’est lié au fait qu’on n’a jamais, depuis les années 80, résolu le problème de l’emploi. Mais la grande imposture du FN, c’est de faire croire qu’on reviendra aux Trente Glorieuses. Parce que, qu’on le déplore ou qu’on s’en réjouisse, on n’y reviendra pas. La machine à remonter le temps n’existe pas. Il y a effectivement la crise, il y a la panne de l’ascenseur social qui, moi, me paraît un thème fondamental. Cette idée selon laquelle les gens de ma génération savaient que leur avenir serait meilleur que celui de leurs parents. Mes enfants, je ne peux pas le jurer. Et y compris dans des milieux à fort capital culturel. La précarisation dans le milieu intellectuel, ça existe. Puis, vient se greffer là-dessus le rejet des élites. Songez au sondage qui est paru avant les européennes sur ce thème, la confiance dans les partis politiques, le Parlement… Il n’y avait que les maires qui s’en sortaient à peu près bien : 63% des Français pensent que le maire sert à quelque chose. Rejet des partis politiques : 80%, taux de syndicalisation en berne… Ça dit tout ! Et puis après, vous avez effectivement la question de l’identité. Il y a une demande identitaire et autoritaire.
Est-ce qu’il n’y a pas un décalage total entre le résultat de ces élections régionales, au premier tour, et l’élan qu’on a pu voir lors des mobilisations qui ont suivi les attentats de début d’année, ce qu’on a appelé “l’esprit du 11 janvier” ?
Je suis allé à la marche. Mais je n’ai pas spontanément adhéré au discours qui consistait à dire que c’était un tournant. Parce que ça me paraissait reposer sur une émotion à chaud, sur une très belle réaction morale qui est éminemment positive. Mais je n’y ai pas vu de débouché politique. Je ne me suis pas dit que tous ces gens-là allaient se transformer en électeurs, s’engager, se mettre à militer dans des partis, dans une association, etc. Je n’ai pas vu ces manifestations comme étant le début d’une grande ère d’engagement politique.
Lire : Les droites extrêmes en Europe, de Jean-Yves Camus et Nicolas Lebourg (éd. du Seuil)
Nicolas Pereira (Nouvelle Donne) : “Rénover la démocratie, c’est rénover le personnel politique”

Comment vous est venue votre conscience politique ?
Le point de départ est le même que nombre de personnes qui se sont engagées à Nouvelle Donne : cette impression que la politique n’avance plus, qu’elle est seulement l’affaire de quelques-uns, et que ces quelques personnes sont complètement déconnectées des réalités. Parfois, on se sent l’envie de sauter le pas et de militer politiquement pour changer les choses et redonner le pouvoir aux citoyens.
Pourquoi vous engager pour Nouvelle Donne ?
J’avais déjà une conscience politique avant, mais l’offre politique ne me convenait pas. Pour être franc, aux dernières élections européennes, je n’ai pas voté pour Nouvelle Donne mais pour une autre liste citoyenne dont je ne me souviens plus du nom. Je n’avais pas voté pour un grand parti et je commençais à me demander s’il ne serait pas plus efficace que les gens arrêtent de voter pour montrer aux politiques qu’ils ne sont plus légitimes. Et puis, après les européennes, je me suis renseigné un peu plus sur les listes, surtout les mouvements que je ne connaissais pas, j’ai lu les professions de foi et j’ai découvert Nouvelle Donne. Une démarche qui peut paraître un peu à l’envers, mais bon. J’ai assisté à une première réunion pour voir ce que ça donnait. Et cette première réunion m’a donné envie de me rendre à une deuxième.
La manière de Nouvelle Donne de désigner les listes, entre tirage au sort et jury citoyen, n’est pas très claire…
Il y a du hasard dans certaines listes départementales, du total hasard, mais pour
la tête de liste régionale, on a quand même constitué un jury : pour diffuser les idées du mouvement, il valait mieux qu’une personne puisse convaincre un jury avant… Pour la désignation de la tête de liste régionale, c’est un jury d’adhérents qui a été constitué et qui a fait passer une audition aux candidats. J’ai été désigné pour en être le représentant. Dans les départements, ils ont choisi de faire des tirages au sort du premier jusqu’au dernier de la liste, parmi tous les adhérents – qui ont un droit de retrait. ‘Est-ce que tu veux être en tête de liste ?’ Si le premier dit non, on passe au deuxième, puis ainsi de suite. La tête de liste en Charentes-Maritimes, qui est une femme, elle était arrivée onzième dans le tirage au sort, mais tout le monde s’est désisté.
Et ce jury qui vous a désigné, il consiste en quoi ?
Comme tous les jurys, il a une grille de lecture avec des questions imposées qu’on ne connaît pas à l’avance. Il nous parle de notre engagement en dehors de Nouvelle Donne, notre engagement dans le tissu associatif, notre rapport à Nouvelle Donne, ce qu’on y a fait, nos motivations. Il évalue la capacité à parler, à expliquer le programme… Des critères qui semblent assez généraux, même si on n’a pas eu accès à la grille de notation.
Le jury citoyen, le tirage au sort… Il y a un petit côté Étienne Chouard dans votre manière de fonctionner.
Il était d’ailleurs venu à l’une de nos journées d’été, c’était en 2014. Il a proposé effectivement son système. Je ne suis pas tout à fait convaincu que ce soit très pertinent aujourd’hui dans sa globalité. Peut-être que ce le sera demain, mais aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Mais il y a des propositions qui sont bien partout, je ne suis pas sectaire. Les propositions d’Étienne Chouard, sur la nouvelle façon de pratiquer la politique, et notamment cette idée du tirage au sort, c’est intéressant. Ce n’est pas lui qui nous a inspirés, mais on est ravis qu’il puisse porter cette idée.
Le programme Nouvelle Donne, c’est rénover la démocratie. Qu’est-ce que cela veut dire et comment on applique ça à l’échelle régionale ?
‘Rénover la démocratie’, il y en a beaucoup qui le disent. On pense apporter un message nouveau, mais en fait il y a plein de gens qui disent qu’ils vont rénover la politique… Là où on diffère, c’est qu’on applique nos idées dans nos pratiques internes. On a trois propositions phares. La première, c’est le non-cumul strict des mandats. On est élu pour un mandat et pas pour cinq. On est élu une fois, on renouvelle une fois ce mandat et après, on laisse la main, parce que ça permet de diriger de nouvelles idées de la politique. Quand les gens sont là depuis trop longtemps, il y a une forme de routine qui s’installe. Rénover la démocratie, c’est rénover le personnel politique. Non pas parce qu’on veut absolument que les vieux s’en aillent, on ne fait pas du jeunisme absolu, mais il est important que de nouvelles personnes plus ‘fraîches’ puissent apporter de nouvelles idées. Ensuite, on propose aussi de mettre en place une rémunération des élus. L’indemnité des élus, elle est fixe. Elle sera de 2 600 euros et des poussières en Aquitaine. Et du coup, on considère que comme dans toute activité, la rémunération d’un élu implique sa participation active ou non aux travaux du Conseil régional. Dans une enquête de France Télé, on a vu des élus qui viennent pointer le matin, qui repartent et qui ne sont pas là l’après-midi. C’est extrêmement symbolique parce que ça discrédite absolument le système politique. Pour le rendre plus transparent, on souhaite que la rémunération des élus soit liée à leur absence au Conseil régional. Enfin, pour des grandes décisions en régions, on souhaite créer des jurys de citoyens tirés au sort pour qu’ils soient codécisionnaires avec les élus sur les grandes décisions. Parce que même si les élus les représentent, aujourd’hui avec ce premier parti de France qu’est l’abstention, ils ne sont représentatifs que de 25% de la population… Donc, il faut que les citoyens qui ne sont pas forcément politisés puissent être consultés.
Nouvelle Donne prône le partage du temps de travail. Mais à l’échelle régionale, c’est quand même difficilement applicable…
Justement, ce que l’on dit, c’est qu’il y a eu, à l’époque de De Robien, une expérimentation sur le partage du temps de travail : quatre jours par semaine, travail de 32h. Ça a marché chez Mamie Nova, ça a marché chez Fleury Michon. Donc ça veut dire que c’est possible. Pour le soutenir au niveau régional,
on considère que la région a aujourd’hui des leviers d’action qui sont ceux de la subvention. Que subventionnent les régions ? Généralement, l’innovation technologique parce qu’on considère que ça améliore le bien-être. Donc, dans le même cadre, on considère que la région peut choisir de soutenir des entreprises lorsqu’elles mettent en place une nouvelle innovation organisationnelle. Quand elle met en place des méthodes nouvelles d’organisation du travail. Ça évite de détruire des emplois et ça améliore le bien-être des salariés, donc ça participe bien au bien-être commun. C’est le seul levier pour éventuellement appuyer le partage du temps de travail dans les entreprises. Mais on peut quand même aborder la création d’un fonds de soutien à la trésorerie des PME. C’est une adaptation du programme national, où l’on constate que 60 000 entreprises en moyenne meurent chaque année du manque de trésorerie, parce qu’elle ne sont pas payées en temps et en heure par leurs clients. On souhaite créer un fonds régional qui va venir soutenir les PME lorsqu’elles ont des retards de paiement : il avancera la trésorerie et ira lui-même récupérer l’argent auprès du mauvais payeur. C’est quelque chose de très pragmatique, mais ça permet de sauver des dizaines, voire des centaines d’emplois.
La moyenne d’âge des candidats aux régionales est de 50 ans, et vous en avez 24. Comment vivez-vous ce décalage ?
Ça ne pose vraiment pas de problème et même, il y a une position très bienveillante à l’égard des jeunes qui s’engagent en politique. Quand on va sur les marchés, les personnes âgées commencent à me reconnaître. Donc, ça veut dire qu’on a réussi à communiquer efficacement. Et elles ont un regard bienveillant, elles disent : ‘C’est bien qu’il y ait des jeunes parce qu’on en a marre de ces vieux cons.’ Elles utilisent directement le tutoiement aussi, c’est presque comme si j’étais leur fils ou leur petit-fils, c’est assez amusant comme relation. Enfin, les jeunes attirent les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui nous ont contactés parce que, justement, pour eux, la politique, c’était ‘un truc de vieux’. Y voir un jeune, ça pousse les gens à se renseigner. Dans mon entourage direct, certains ne sont pas trop politisés mais ils valident mon engagement. Même une de mes amies qui n’était pas du tout politisée m’a demandé d’être sur la liste parce qu’elle avait envie de me soutenir. Mais j’évite de faire du prosélytisme à longueur de temps dans le privé.
Quand on doit faire le tour des télés régionales et des radios à 24 ans et qu’on n’est pas forcément formé à ça, on suit une préparation ?
Absolument pas. On n’a rien préparé. D’ailleurs, ça se sent. On fait comme on peut et on y va, juste avec l’envie de vouloir convaincre. C’est un exercice intéressant, on est quand même loin du militantisme quand on est à la radio et à la télé. L’avantage, c’est que le message est diffusé beaucoup plus largement. On a la capacité, grâce à ces médias qui sont vus ou entendus par des milliers ou des centaines de milliers de personnes, de délivrer un message, certes pas très long, mais qui peut attiser la curiosité des gens et leur permettre de revenir vers nous par la suite. Il y a beaucoup de gens sur Facebook ou sur les réseaux sociaux qui m’ont contacté après mes passages pour me dire que la démarche était intéressante.
Vous avez rencontré Bruno Gaccio ou Pierre Larrouturou ?
Oui, je les connais bien maintenant. Bruno Gaccio, je l’ai vu moins souvent pour le coup, j’ai eu l’occasion d’échanger trois fois avec lui. Ce fut assez succinct, sauf une fois où on a un peu plus approfondi. Tout le monde a son mot à dire en politique. Il apporte une vision qui est vraiment extérieure au système politique. Il le critique et il le dénonce tout le temps, et à juste titre. Je trouve qu’il apporte une façon neuve d’analyser les choses. C’est beaucoup plus simple à comprendre parce qu’il n’y a pas de discours politique à proprement parler. Il fait un travail formidable ‘d’éducation populaire’ autour de la politique. Même si son nom est associé aux Guignols, je pense qu’il n’est pas connu par la majorité des français.
The Dizzy Brains, d’Andravoahangy à Rennes
 The Dizzy Brains / © Rijasolo
The Dizzy Brains / © RijasoloIl est environ 19h ce mardi soir de la fin novembre, et la nuit a déjà enveloppé Antananarivo, alias Tananarive, en pleine île de Madagascar, lorsque trois silhouettes apparaissent au détour d’une rue du quartier d’Andravoahangy. Aux avant-postes, il y a Eddy et son frère Mahefa. Tous les deux ont la petite vingtaine. Si ce n’était leur lieu de naissance et de résidence exclusive, l’un comme l’autre feraient de parfaits modèles pour une de ces pubs Dior, période Hedi Slimane, censées vanter les mérites de la maigreur rock et son corollaire de jeans serrés à la taille, de poses arrogantes et de cheveux ébouriffés juste ce qu’il faut. Seul accroc au cliché : au lieu de se balader dans la rue collés-serrés avec des Kate Moss de Madagascar encore mineures, les deux leaders du groupe punk malgache The Dizzy Brains ont fait le déplacement accompagnés par… leur père. Ce dernier ne tenait pas à laisser sortir ses fils de 25 et 21 ans tout seuls la nuit. Car Madagascar ne ressemble pas au New York hipster des environs de Williamsburg, à l’East End londonien ni aux abords du Bus Palladium dans le IXe arrondissement parisien. Alors même si Eddy et Mahefa connaissent par cœur
ces rues de Tananarive où ils ont souvent dormi après leurs concerts à même le bitume, ils n’ont pas forcément envie de les magnifier : “Pour ne pas prendre le risque de nous prendre un coup de couteau en rentrant chez nous après nos concerts, on a souvent préféré dormir dans la rue.” Il faut dire qu’à cet endroit même, fin octobre, un dessinateur de presse, Rakima, a été poignardé par deux voleurs, venant s’ajouter à la liste des victimes de l’insécurité dans cette partie de la capitale. Mais si le père des deux Dizzy Brains est ici, c’est également car il n’est pas pour rien dans les velléités rock’n’roll de ses fils. Il vit même sans doute son rêve de découverte du monde grâce au rock à travers le groupe de ses enfants. Du coup, rien de plus normal que de l’entendre rembobiner, avec une certaine fierté, sur ce qui l’anime et ce qui forme également la bande originale de sa génération : “Moi-même je suis musicien. Pas réputé, hein, mais je sillonne les scènes avec des gens qui ont déjà une petite aura, des groupes qui jouent dans les cabarets. On joue du rock, du blues, parfois de la country. Pendant mon enfance, on a vécu la musique rock à fond dans l’île en écoutant les groupes célèbres de l’époque : Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Simon & Garfunkel, etc.” Eddy à la relance : “Avant, dans les années 70, il y avait les Kinks. Ils étaient très populaires ici, je crois. En tout cas, j’en ai entendu parler. Les mecs de la génération de mon père n’arrêtaient pas de nous vanter les disques de ces gars. Mais avec le temps, ce feeling rock s’est dilué dans l’île. C’est même devenu une pratique underground. Nous, on joue dans des bars minuscules pour pratiquement rien. Au maximum 40 personnes viennent nous voir. De toute façon, les gens de mon âge préfèrent la pop commerciale qui vient des États-Unis et les trucs tropicaux qui font remuer les fesses.”
Serge Gainsbourg, Jacques Dutronc et les clones de Beyoncé
Le père et ses deux gamins allument une petite lumière et guident à travers le dédale des ruelles d’un Tana à l’éclairage public rare, voire absent lorsque surviennent les très fréquentes coupures d’électricité. Une grille en fer, une petite cour d’immeuble, une porte d’entrée exiguë et quelques étages dans un escalier sombre avant d’entrer dans un appartement douillet. Les Dizzy Brains accueillent à domicile et indiquent le chemin du salon. Un vrai salon familial, avec canapé, fauteuils, télé et chaîne hi-fi. C’est d’ailleurs grâce à cette dernière, en 2011, qu’est né le groupe, comme le proclame fièrement Eddy : “J’étais descendu aux toilettes, il y avait cette chanson que mon père jouait sur la chaîne hi-fi : 7 heures du matin, de Jacqueline Taïeb. Ça m’a fait un déclic dans la tête : pourquoi ne pas faire du rock ? Et le déclic s’est confirmé quand, quelques semaines plus tard, on est tombés sur des vidéos de Serge Gainsbourg et Jacques Dutronc à la télé. On a vu ces mecs tellement cinglés, qui déchiraient avec leurs textes, qui déchiraient avec leur attitude sur scène. On a eu l’idée du nom du groupe : The Dizzy Brains. Parce que tout chez ces mecs nous filait le vertige. Là encore, c’est grâce à notre père qu’on a été exposés à ça !” Même si Eddy dit avoir voulu devenir avocat avant de réellement se consacrer au rock, le parcours du combattant qu’il se remémore ressemble à une vieille histoire.
D’abord, le groupe commence à répéter dans des caves. Il fait avec les moyens du bord et un art consommé de la débrouille, emprunte la guitare du paternel, les amplis d’un ami de la famille, écrit des chansons sur quelques accords saturés, se gave de vidéos YouTube des Arctic Monkeys, de The Stooges ou de The Strokes pour parfaire son attitude. Les thèmes des chansons ? Ce qu’ils connaissent le mieux : la corruption à chaque coin de rue à Tananarive, le danger, le manque d’argent et de perspectives, la sexualité qu’on réprime, la censure. À tous les coups, cela donne des morceaux pleins de fièvre punk assez loin de ces clones de Beyoncé un peu cheap dont les disques mal produits se vendent sous le manteau ou de ces musiciens tropicaux qui peuvent parfois réunir jusqu’à 40 000 personnes sur leurs seuls noms. Naissance d’un nouvel underground ? Ce qui est certain, c’est que parmi ces morceaux, il y en a un, immense, qui s’intitule Vangy et dont la vidéo en noir et blanc commence à beaucoup se relayer sur les réseaux sociaux entre jeunes malgaches restés au pays et expatriés. Ici, caché derrière quelques accords saturés, de l’urgence et des paroles qui doivent parler à pas mal de jeunes de Tananarive (“Pauvre comme tu es tu n’as que 1 200 ariari ((la monnaie locale, ndlr) et une clope pour affronter cette dure journée”), il y a donc ce que les Sex Pistols appelaient clairement le no future. Car en fin de compte, la rage d’être un jeune punk sans perspective est la même dans tous les pays du monde, à toutes les époques, comme le souligne Eddy : “Depuis que les réseaux sociaux existent, on sait que les jeunes de Tananarive ont les mêmes préoccupations que les jeunes, disons, de Paris ou des environs, hein. On parle de sexe, de soirées avec de l’alcool, de l’impasse dans laquelle on est tous. Parce qu’on n’a pas beaucoup de perspectives. Sauf que nous, on est juste plus pauvres encore et peut-être plus censurés qu’ailleurs.”
La peau dure
Avant de raccompagner et de remercier chaleureusement pour la visite chez eux, Eddy, Mahefa et leur père font comme s’ils n’avaient pas remarqué qu’un flic se livre à un contrôle plutôt musclé sur un taxi local en pleine rue d’Andravoahangy. Devenu hermétique à ce genre de scènes, Eddy préfère soulever les épaules et dresser ce constat : “Faire du rock à Madagascar, ce n’est pas une carrière, ça ressemblerait même plutôt à un combat permanent. D’abord, dans la rue, tu te fais constamment racketter par les flics pour aller d’un point A à un point B. Ensuite, si tu veux jouer, tu n’as pas le choix. Il faut passer par l’underground et tenir bon. Tu dois te produire dans les petits bars de nuit, les cabarets assez glauques. Si tu tombes sur un programmateur de soirées cool, on te file l’équivalent de 100 euros pour tout le groupe. Mais le plus souvent, tu tombes sur un patron bourré. Lui va te laisser jouer dans un premier temps. À un moment il va quand même venir te dégager de la scène à coups de pied au cul si ce qu’il entend de ta musique ne lui plaît pas.” En esquissant un sourire désolé, Mahefa cloue même : “On a connu ce genre de situations un peu borderline tout le temps. On est restés parmi les mendiants, d’accord, mais ça ne nous a pas empêchés de persévérer. Alors maintenant, quoi qu’il nous arrive, on a la peau dure…”
La peau dure, c’est sans doute ce qui pourrait permettre aux Dizzy Brains de ne pas perdre le sens de leurs réalités. Depuis qu’ils ont appris leur présence à l’affiche du festival français des Transmusicales de Rennes, là où Nirvana, Daft Punk, Björk, Noir Désir, Portishead et plus récemment Rodriguez ont donné leurs premiers concerts français voire européens, tout s’est subitement emballé : intérêt croissant des médias, des producteurs, articles dans la presse de Madagascar soulignant “la fierté nationale” à voir un groupe punk représenter dignement (?) hors de l’île. “Il y a encore quelques mois, personne n’aurait misé le moindre ariari sur nous et maintenant, même des anciennes copines veulent reprendre le contact avec nous”, frime un peu Eddy.
“Elle est pas belle la vie ?”
Pour rationaliser son illumination de programmer, quasi en tête d’affiche, un groupe punk inconnu et originaire de Madagascar, Jean-Louis Brossard, directeur artistique du festival, a décidé de pousser au maximum ses capacités d’enthousiasme : “Ces gamins, donc, ils font du rock. Ils vont me mettre le feu, j’en suis persuadé. Parce que le rock, enfin ce qu’il véhicule de révolte contre quelque chose, ça a sans doute un peu perdu de son sens dans nos pays occidentaux. Alors que chez eux, à Madagascar, dans un pays pas facile, ils incarnent ce truc qu’on avait aimé dans l’Angleterre punk de la fin des années 70 ou à New York. Ce qu’ils chantent à un sens. Ça vient vraiment de la rue. Il y a une révolte !”
Et sa révolte, c’est peu dire que le groupe malgache n’a pas l’habitude de l’exporter. Eddy se met à raconter son premier voyage hors de Tananarive, encore jetlagué : “Ça a été 14 heures de vol, quand même. Donc, on a tous ressenti une grosse fatigue. Jamais on n’avait pris l’avion de notre vie. On n’était jamais sortis de Tananarive. C’était une expérience bizarre parce qu’il y avait de la bonne bouffe gratuite et des films. On ne savait pas que dans l’avion, les choses étaient gratuites. Moi, j’ai maté Batman sur le petit écran en face de mon siège. Mais quand tu arrives en France, tu compares forcément avec l’ambiance à
Tana et tu vois que les gens, ils ont tous l’air stressés, même si tu ne comprends pas pourquoi. Dans les rues, tout le monde marche vite, tu te fais bousculer, on ne te regarde jamais.” Il marque une pause et s’illumine : “Et malgré cette sensation bizarre de gens qui sont stressés pour aucune raison, tu te dis : ‘Elle est pas belle la vie ?’” Pour ce qui est du festival, Eddy avoue : “On ne sait pas à quoi s’attendre ici. On n’a jamais su à quoi ressemblait une grande scène. Notre plus gros concert jusqu’à présent, c’était chez nous, au festival Libertalia devant 300 ou 400 personnes. Là, on nous a dit qu’on allait voir des milliers de têtes. Alors, bien sûr, on est impatients, mais on a peur aussi de décevoir !” Car les gazettes locales, parlent de cette série de concerts en France comme d’une véritable fierté pour le pays. Les anciens potes d’adolescence, celles et ceux qui ont toujours pris Eddy, Mahefa et leur bande pour des losers, reprennent le contact. Le père, resté au pays (“On ne pouvait pas lui payer un billet d’avion pour la France. On a essayé, mais c’est plusieurs mois de salaire rien que pour l’aller”), attend des nouvelles, mais attendra longtemps car, là encore, impossible de se permettre d’investir dans des communications entre l’Europe et Madagascar, trop coûteuses.
Un vrai potentiel scénique
En ce début de mois de décembre rennais, les quatre Dizzy Brains observent, les yeux écarquillés et à bonne distance, les us et coutumes d’un festival occidental. Dans un coin de la salle du Liberté, le spot principal des Transmusicales, c’est la soirée d’ouverture. Une fanfare venue de Thaïlande, le Khun Narin Electric Phin Band, joue une musique qui mélange des éléments de folklore traditionnel et de psychédélisme sentant très fort le champignon hallucinogène. Les quatre remuent la tête mais sans en faire trop. Encore un peu sur la réserve. Puis, les voilà qui fondent sur le buffet dinatoire. Mais au moment de piocher dans ces assiettes où les toasts côtoient des fars aux pruneaux, ils hésitent : “A-t-on vraiment le droit de se servir ? N’y aurait-il pas un flic caché dans un coin pour demander un bakchich en échange d’une crêpe ?” Mahefa : “Ici c’est tellement calme. Les gens parlent doucement. Ils se saluent doucement.” Pour faire le lien entre ce nouveau monde et l’ancien, les Dizzy Brains sont accompagnés par Christophe David, un homme dont le CV dégaine des expériences de producteur dans la musique, de documentariste globe-trotter, de programmateur de concerts du côté de La Réunion. S’il n’est pas à proprement parler leur manager, ce quinquagénaire aux cheveux gris et longs avec des faux airs d’ancien surfeur encore capable de raconter sa rencontre avec “une vague métaphysique”, est un des premiers à avoir perçu un vrai potentiel scénique, mais surtout une vraie histoire derrière le groupe. Une histoire qui coïncide avec sa découverte de
Madagascar en 1992, après son premier divorce, un nouveau mariage, puis son installation sur place : “Madagascar, c’est le même principe que l’Inde. C’est un pays qui ne te laisse pas intact. J’ai fait deux mois et demi de pirogue pour les besoins d’un documentaire sur les pêcheurs Vezo. À partir de là, Madagascar m’a fait comprendre ce qu’est le fatalisme et l’animisme. C’était en 2003, et j’y suis toujours.” Si le lien que Christophe David a tissé avec Madagascar lui permet de relativiser ce qu’il se passe ailleurs dans le monde (“Ici, des villages entiers sont massacrés par les voleurs de zébus. Les hommes politiques en place détournent l’aide envoyée par l’ONU pour leur profit personnel. Si tu as un euro en poche, la police va venir te racketter et te prendre 80 centimes”), il s’est également très vite intéressé à la culture et en particulier à la musique nationale. Sa rencontre avec les Dizzy Brains part d’ailleurs de ce constat : si tout cela est encore frais, peut-être que ce groupe est à l’avant-garde. “Ça s’est passé dans une cave du centre ville de Tananaride. À l’époque, ils répétaient dans leur coin et c’était un ami qui m’avait conseillé d’aller les voir. C’était en 2013, je crois. À Madagascar, normalement, il n’y a pas de showman et Eddy, lui, savait occuper la scène, se déplacer. Ce qui est très étonnant pour un Malgache. Donc, comme ils me touchaient, je leur ai proposé de jouer au festival Libertalia, mais à cette condition que les deux frères, Eddy et Mahefa, remplacent leur guitariste de l’époque et leur batteur. Ces deux-là n’étaient vraiment pas au niveau et depuis, ils se sont adjoints deux très bons musiciens pour les pousser. Ils jouent du rock, mais surtout, ils sont les seuls à dénoncer un peu de ce qui ne va pas dans ce pays. Ils représentent cette nouvelle génération malgache qui veut le changement.” Celle qui commence à revendiquer de meilleures conditions de vie dans le Madagascar des années post-décolonisation.
Une première partie pas comme les autres
Avant leur concert d’hier soir, avant de devenir peut-être l’avant-garde incontestable d’une deuxième attaque punk qui viendrait, cette fois-ci, des pays du Sud, les Dizzy Brains savent qu’il va falloir apprendre à maîtriser d’abord leur sève rock devant un public qui en a vu d’autres. Les organisateurs des Transmusicales de Rennes ont eu la bonne idée de proposer au groupe un tour de chauffe devant le public… de la maison d’arrêt de Rennes. Il est 14h30 ce mercredi 3 décembre, et dans le coin du gymnase réquisitionné pour le live, c’est devant la batterie préalablement disposée sur scène que les quatre membres des Dizzy Brains écarquillent les yeux. Les deux frères Eddy et Mahefa se poussent même du coude en se demandant s’il y aura autant de monde pour leur vrai concert aux Transmusicales alors qu’il devrait y en avoir… 100 fois plus au minimum. Si la vingtaine de taulards qui se sont installés avouent avoir fait le
déplacement plutôt pour encourager le passage sur scène d’un groupe sorti de l’atelier hip-hop de la prison que pour écouter les Dizzy Brains dont ils ne connaissent rien, il ne faudra pas plus de cinq minutes à Eddy, Mahefa et les autres pour électriser le gymnase. Alors bien sûr ce n’est pas l’ambiance du célèbre live au pénitencier de Folsom, Californie où Johnny Cash recevait des cris d’extase de son public quand il chantait “et j’ai tué à mec à Reno juste pour le plaisir de le voir crever”, mais c’est quand même la vraie énergie du punk.
Cette semaine rennaise est peut-être bien la première du reste de la vie des Dizzy Brains. Eddy marque une pause et fixe un point imaginaire à l’horizon : “On est étonnés d’être ici, hein, parce que tout est nouveau, mais on apprécie chaque moment. Déjà, on sent que rien ne peut arriver de mal ici. À l’aéroport, en présentant notre passeport pour partir en France, on a encore dû donner de l’argent à un fonctionnaire. C’est toujours comme ça. Corruption et violence. Quand tu marches dans la rue, le moindre regard peut dégénérer. Tu te fais attaquer à l’arme blanche. Si l’alcool le veut, les choses s’enveniment très vite. Tu es littéralement mort pour rien du tout chez nous.”
Demandez le programme!

« Tu préfères Noël Chuisano ou Isabelle Bonnet ?”
Pas toujours facile de trouver des réponses. Pas toujours facile de connaître, comprendre et se retrouver dans les programmes des nombreux candidats aux régionales.
Pour vous aider à y voir plus clair, Society s’associe à Voxe.org. Juste ici,
dans la colonne de droite, il y a désormais un comparateur simple et efficace :
1. Cliquez sur votre région.
2. Choisissez deux candidats.
3. Sélectionnez le thème qui vous intéresse.
4. Et voilà !
Pascal Canfin : “Le climat n’est pas seulement une question environnementale”

On nous vend la COP21 comme un événement historique et déterminant. Mais on a envie de dire : en quoi par rapport aux 20 sommets sur l’environnement qui l’ont précédée ?
Parce que c’est vraiment LA conférence où l’on doit réussir ce que l’on a échoué à faire en 2009 à Copenhague : autrement dit obtenir le premier accord universel sur le climat, signé par la Chine, le Brésil, les États-Unis, etc. Le deuxième élément déterminant, c’est qu’il faut que cet accord respecte ce que les scientifiques nous demandent, à savoir ne pas dépasser deux degrés de réchauffement climatique. En gros, le réchauffement climatique, c’est comme une fièvre. La température moyenne de la planète, c’est quinze degrés. Si on augmente de deux, les scientifiques disent : ‘Ça augmente, c’est pas bon, mais ça reste gérable.’ Mais si on augmente de trois, quatre, cinq, alors on franchit ce qu’ils appellent un ‘point de non-retour’ et on entre dans une réalité inconnue, avec aujourd’hui sept, demain neuf milliards d’habitants sur la planète…
Les arguments des climatosceptiques, c’est souvent de dire que ces thèses alarmistes ne reposent sur aucune certitude scientifique…
Franchement, aucun de leurs arguments ne tient la route. Oui, certes, on a connu dans le passé des périodes de refroidissement et de réchauffement. Mais on n’était pas neuf milliards d’habitants et ce n’était pas sur 100 ou 200 ans, mais sur des centaines de milliers d’années. Donc ce n’était ni le même enjeu pour l’humanité ni le même temps d’adaptation. Le rythme que l’on connaît aujourd’hui n’a jamais existé. Jamais. Il suffit d’aller en Californie, en Afrique ou en Aquitaine pour voir que les effets se produisent concrètement, parce qu’on a déjà un degré de réchauffement.
Ces dérèglements climatiques peuvent-ils mener à des troubles politiques ?
C’est le cas dans le conflit syrien ou avec Boko Haram en Afrique. En Syrie, entre 2006 et 2010, il y a eu quatre ans de sécheresse historique. Avec pour conséquence des centaines de milliers d’agriculteurs qui ont rejoint les grandes villes, et un million de personnes environ qui a migré vers l’intérieur du pays.
Cela a clairement participé à déstabiliser le pays. Imaginez que cela arrive en France : le pays serait pareillement déstabilisé. En ce qui concerne le développement de Boko Haram, même si ce n’est pas la cause unique et que ce serait absurde de le laisser croire, le réchauffement climatique joue également un rôle. Boko Haram a prospéré autour du lac Tchad. Or, le lac Tchad a diminué de 80% ces dix dernières années. Imaginez quand vous perdez 80% de vos ressources en eau. Les conséquences sur l’irrigation, la sécurité alimentaire… Cela déstabilise une société. Les gens sont appauvris, alors ils se tournent plus facilement vers ceux qui sont capables de leur assurer des revenus. Autrement dit une économie illégale, mafieuse ou liée au terrorisme. Finalement, les dérèglements climatiques sont ce que l’on appelle un multiplicateur de menaces. Ils renforcent et aggravent les tensions politiques. C’est pour ça que l’enjeu du climat n’est pas seulement une question environnementale, mais profondément une question de paix et de sécurité.
Y a-t-il des pays qui ont intérêt à voir échouer la COP21 ? À Kyoto, le Sud n’était pas engagé, à Copenhague les États-Unis et la Chine, les deux plus grands pollueurs, attendaient que l’autre fasse le premier pas et finalement, cela a été un échec…
D’abord, il y a la Russie. Pour des raisons assez éloignées du climat. Déjà, c’est cynique, mais la Russie considère que la fonte des glaces au Nord lui libère la route de l’exploitation du pétrole et du gaz. Puis, il y a le risque que Poutine, pour des raisons purement diplomatiques –la Syrie par exemple–, choisisse de refuser de signer. Ce serait une façon de prendre en otage la COP21 pour envoyer des messages sur d’autres sujets. C’est un scénario possible. L’Arabie saoudite, qui a apporté une contribution insuffisante et tardive, est le pays qui a le plus bloqué l’avancée des négociations sur la COP. Elle est clairement en première ligne pour faire en sorte que l’accord de Paris soit le moins ambitieux possible. Ensuite, il y a l’Inde. L’Inde, qui sera le pays le plus peuplé en 2022, c’est un vrai sujet de développement : est-ce que les Indiens vont penser que l’accord va les contraindre dans leur développement ou, au contraire, considérer qu’il peut leur permettre d’accéder à des technologies vertes, à plus bas coût, plus facilement ? Enfin, le dernier élément, ce sont les pays africains. Aujourd’hui, il y a un sous-financement massif de ce qu’on appelle ‘l’adaptation’. C’est-à-dire aider les pays qui sont à la fois les plus pauvres et les plus vulnérables au dérèglement climatique, comme ceux de la bande sahélienne, par exemple. On est très en dessous des engagements qu’on avait pris avec ces pays.
Sur de nombreux points, certains pays n’ont pas respecté leurs engagements passés. En fait, ce genre d’accord, c’est un peu comme les campagnes électorales, les promesses n’engagent que ceux qui y croient, non ?
Absolument. C’est comme un contrat de mariage. On ne peut pas vous empêcher de sortir du jeu, de dire : ‘Ça suffit, je reprends mes billes.’ Pourtant, le contrat de mariage, il existe. Paris, c’est un peu ça : on s’associe pour lutter ensemble contre le réchauffement climatique avec un objectif commun, les fameux deux degrés. Mais si un Républicain est élu à la Maison-Blanche l’année prochaine –ce que je ne souhaite pas pour de nombreuses raisons, bien au-delà du climat–et qu’il dit : ‘Moi, l’accord de Paris, jamais entendu parler, je défais les lois américaines qui sont celles qui vont permettre d’appliquer cet accord’, eh bien à ce moment-là, effectivement, l’engagement est détricoté et il ne tient plus. Donc, au fond, l’accord de Paris repose sur la volonté des gouvernants à le mettre en œuvre. Mais c’est vrai pour tous les contrats. Si on voulait vraiment être ambitieux et à la hauteur du sujet, il faudrait faire pour le climat ce qu’on a fait pour le libre-échange. L’OMC a été capable de créer un tribunal qu’on appelle l’ORD (l’Organe de règlements des différends, ndlr) : quand un État applique une politique qui n’est pas jugée conforme par l’OMC, il y a un tribunal. L’accord de Paris ne produira pas ça, je le regrette, mais pour moi, c’est clairement la prochaine étape.
En quoi est-ce que lutter contre le réchauffement climatique peut susciter l’avènement de modèles économiques vertueux ?
L’Organisation internationale du travail a récemment sorti une étude qui montre que l’accord auquel on souhaite parvenir à Paris devrait créer dans le monde jusqu’à 60 millions d’emplois net –donc en tenant compte de ceux qui vont disparaître, dans le charbon par exemple. C’est bien la preuve que l’idée selon laquelle il faudrait opposer les emplois, les entreprises, l’industrie, la compétitivité à cette transition, est absurde. C’est une question de moyens, de volonté, et de lutte contre ceux qui ne veulent pas que ça bouge. La prédiction des experts en 1900 à Paris était que la principale menace, c’était le crottin de cheval. Parce qu’il y avait 80 000 chevaux qui circulaient tous les jours. Ils avaient fait une courbe et étaient arrivés à la conclusion qu’en 2020, Paris croulerait sous le crottin de cheval ! J’imagine que les constructeurs de diligence ont du faire un lobbying d’enfer pour que l’automobile ne se développe pas. Mais on a inventé la vapeur, l’électricité, les vaccins dans le passé, pourquoi on serait tétanisé à l’idée d’inventer l’économie bas carbone ? On va le faire !
Lire : Climat – 30 questions pour comprendre la conférence de Paris, par Pascal Canfin et Peter Staime (Les Petits Matins)
Fary : « On me dit tout le temps que je ressemble à Nicolas Batum, ça me met hors de moi »

Il va bien. Mieux. Il va bien mieux, parce qu’il le faut. « J’ai été en deuil pendant deux, trois jours mais après, tu penses aux familles des victimes, aux rescapés et tu relèves la tête. » Lui n’a pas été touché directement, mais quand même. Une semaine après les attentats, il devait faire des blagues sur la scène du Bataclan. Trois dates. Qu’il attendait avec impatience depuis des mois. “Je vivais Bataclan, je mangeais Bataclan, je dormais Bataclan.”
Fary a 24 ans, des cheveux qu’il affectionne particulièrement et, devant lui, une assiette où deux tranches de bacon grillé recouvrent quatre œufs au plat, pour accompagner son orange pressée. Un petit déjeuner comme un autre. À 18h.
La scène, il la côtoie depuis longtemps: à 11 ans, il fait son premier one man show grâce à son oncle qui organise des soirées trimestrielles pour les enfants et trouve qu’il imite parfaitement bien Jamel dans son sketch sur une arrestation au Maroc (« Les mains du l’air »). Mais c’est au lycée – Marcelin-Berthelot, à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne– que tout prend vraiment un sens. Lors de sa deuxième seconde, il se découvre un amour pour l’histoire et un avenir dans l’humour grâce à une prof, Jessie Troja, qui le pousse à faire de sa répartie un métier en l’aidant à écrire un spectacle et en lui achetant des accessoires. « Comme une deuxième maman. C’est d’ailleurs assez rare dans l’Éducation nationale, les gens qui t’aident à faire ce que tu sais faire.”
Il ne la voit plus trop. Il ne voit « même plus trop [s]on petit frère alors [qu’ils habitent] dans la même maison“. La réalisation de son rêve, celui d’être artiste, prend désormais trop de place. Trop de temps. Depuis deux ans, il est un peu partout. Sur les plateaux télé, dans des émissions de radio et des vidéos YouTube, dans Océane de Philippe Appietto et Nathalie Sauvegrain ou encore dans On n’demande qu’à en rire sur France 2. Et c’est désormais avec Jason Brokerss, du Jamel Comedy Club, qu’il écrit. Le Jamel Comedy Club, il ne voulait pas y passer, à la base : “Je suis un mec de banlieue mais je ne voulais pas être cantonné à un mec de banlieue, je préférais me mettre à part. » Et puis, de fil en aiguille… Il gagne un prix au festival L’Humour en capitales et joue son spectacle « devant six personnes” au Paname. C’est là qu’il rencontre Kader Aoun, dont il est “un grand fan” depuis qu’il l’a “découvert dans les bonus du DVD de Jamel”. L’homme derrière l’humour français l’intègre d’abord à son projet Adopte un comique “avec Hugo tout seul, Camille Combal, David Bosteli, Tom Villa…” puis le convainc d’intégrer la troupe de Jamel. Fary fait mouche en taclant le legging en sarouel. Les six personnes du Paname sont devenues 115 au Point-Virgule et seront près de 900 ce week-end à Bobino. Parce que c’est dans les moments compliqués “que le métier d’humoriste est le plus important ».
Qu’est-ce que tu n’es pas ?
Un clown. Je ne suis pas le mec drôle du groupe. Je suis celui qui observe.
Qu’est-ce que tu n’as pas ?
Des pecs. Mais j’en aurai bientôt.
Qu’est-ce qui ne te manque pas ?
Je ne manque pas d’amour.
Qu’est-ce que tu ne comprends pas ?
Les gens fermés d’esprit.
Quel sport n’as-tu jamais pratiqué ?
Le patinage artistique. Je suis pas à mon avantage dans un collant.
En quoi est-ce que tu ne crois pas ?
J’ai beaucoup de mal à croire à la fidélité. Parce que je ne l’ai jamais été. Je n’ai jamais su l’être.
À qui/quoi tes lunettes ne te font pas ressembler ?
À Nicolas Batum. On me dit tout le temps que je lui ressemble, ça me met hors de moi. Je déteste ressembler à qui que ce soit.
À quelle heure ne doit-on pas t’appeler ?
À midi. Je dors.
Quel métier ne voulais-tu pas faire quand tu étais petit ?
Un travail dans un bureau.
Quel acteur ne jouera pas ton rôle dans ton biopic ?
Omar Sy. Parce qu’il est beaucoup trop noir.
Qu’est-ce que tu ne veux pas savoir ?
Je n’ai pas envie de connaître mon avenir. Je considère que tout est possible. Et savoir ce qu’il va se passer, ça enlève toute notion de destin.
Qu’est-ce que la vie ne t’a pas appris ?
À être dur. Dans le sens insensible, fort.
Qu’est-ce que tu fais pour ne pas sauver la planète ?
Je prends des douches de quinze minutes.
Quel est le dernier film que tu n’es pas allé voir ?
Certainement un film français. Le cinéma français, c’est très rare qu’il me fasse me déplacer dans une salle de cinéma.
Qu’est-ce qui ne te fait pas rire ?
La moquerie.
Quel cadeau ne faut-il pas t’offrir à Noël ?
Des vêtements. On se trompera forcément.
Pour qui n’as-tu pas voté à la dernière élection présidentielle ?
François Bayrou. Voilà, comme ça, je me mouille pas.
Avec quel artiste n’as-tu pas du tout envie de faire un duo ?
Jamel Debbouze. Parce qu’il est beaucoup trop drôle pour moi.
À quoi est-ce que tu ne penses pas là tout de suite ?
À autre chose.
Quel média ne t’a pas encore interviewé ?
Les Inrocks. Peut-être qu’ils sont intimidés par moi. Ou alors, je suis pas assez hype pour eux. Ou trop.
De quoi ne parles-tu pas dans tes sketchs ?
D’IKEA. J’ai absolument rien à raconter sur IKEA.
Qui ne cites-tu pas dans tes sketchs ?
Ma grand-mère. Pourtant, elle me fait beaucoup rire. En général, quand t’as des personnages dans tes spectacles, tu t’inspires de ceux qui sont drôles malgré eux. Ma grand-mère n’est pas drôle malgré elle, c’est une vanneuse.
Qu’est-ce que tu ne fais pas après ton spectacle ?
Je ne rentre pas me coucher.
Pourquoi ne faut-il pas aller voir ton spectacle ?
Si tu ne veux pas rire. Si tu ne veux pas rire, il faut pas venir voir mon spectacle.
Voir : Fary au Point-Virgule jusqu’au 2 janvier (COMPLET), Fary à Bobino les 27, 28 et 29 novembre (en remplacement du Bataclan), Fary au Grand Point-Virgule à partir du 13 janvier (du mercredi au samedi à 21h30)
“La vie est trop courte pour être trop sérieux”
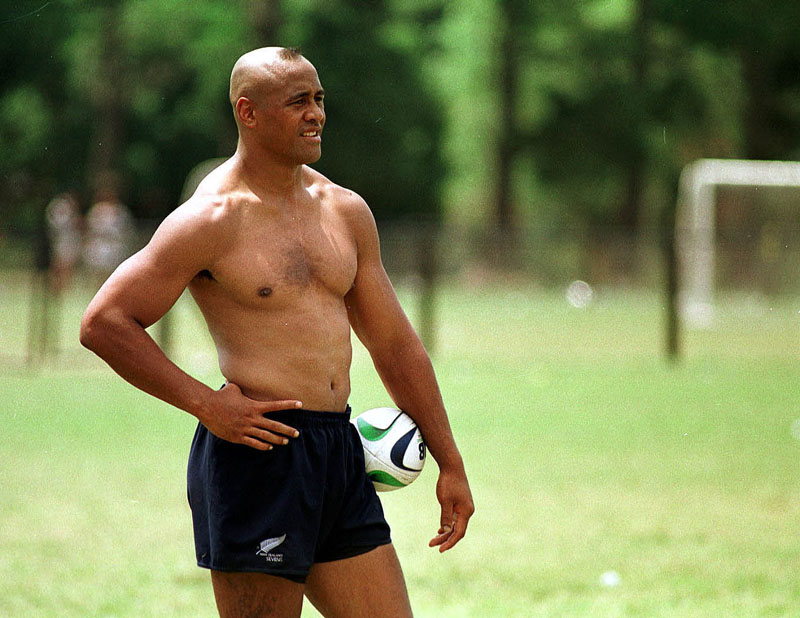
L’histoire du rugby est bien sûr traversée de joueurs légendaires. La liste est forcément injuste et oublieuse. David Campese était un génie cabot avec un physique de mécanicien, Gareth Edwards une référence indépassable à rouflaquettes pour les plus de 50 ans, Michael Jones un illuminateur de jeu mais jamais le dimanche – qu’il réservait à Jésus –, Serge Blanco un épicurien de la relance et de la vie, John Eales le plus parfait des joueurs, Jonny Wilkinson le plus admirable, François Pienaar le plus Mandela, Richie McCaw le plus hors jeu…
Lui n’a jamais été champion du monde. Il a connu une carrière aussi fulgurante que frustrante, la faute à un corps hors norme en apparence mais pas décidé à le laisser en paix. Jonah Lomu est pourtant l’unique superstar du rugby. Le seul dont les impies de la mêlée ouverte, les agnostiques du ruck et les indifférents à l’arrêt de volée peuvent citer le nom d’instinct. Jeune quadragénaire, l’ancien ailier des All Blacks est un père de famille heureux, un amoureux lucide de son sport et un homme apaisé, comme peuvent l’être ceux que le sort n’a pas épargnés. Depuis sa maison d’Auckland, la légende du rugby revient sur une vie et une carrière traversées tout en raffuts.
Vous êtes né à Auckland, mais vous avez passé les six premières années de votre vie aux Tonga. Quel souvenir gardez-vous de cette époque ?
Je me revois pieds nus, à courir partout, toujours en liberté. Il y avait aussi la mer et les bagarres. Je me souviens de mes oncles et à quel point ils étaient gros. Mais je ne repense pas trop à cette époque. Je suis une personne qui regarde simplement ce qui se passe devant et qui poursuit son chemin.
Pourquoi vos parents ont-ils choisi de quitter les Tonga ?
Ils voulaient nous donner une meilleure éducation et de meilleures opportunités. Cela n’aurait pas été possible là-bas. Mes deux parents travaillaient dans une usine.
À Auckland, vous avez grandi dans l’un des quartiers les plus durs de la ville. Cette violence a-t-elle marqué votre personnalité ?
Dans le coin où j’ai passé ma jeunesse, tout le monde connaît tout le monde, mais cela ne signifie pas que tu es en sécurité pour autant. Si tu baisses ta garde, tu
peux avoir des ennuis. Et même si tu es sur tes gardes, des gens essaient quand même de te causer des ennuis. À South Auckland, si tu ne sais pas te battre, tu te fais tout le temps cogner. Donc, il fallait gagner le respect et cela prenait du temps, tout simplement parce que si tu montrais ne serait-ce qu’un instant de faiblesse, tu savais que les gens en profiteraient. Je crois que ça m’a appris à être vigilant. J’y retourne parfois. Le problème, c’est que les choses dans ce quartier sont toujours les mêmes. Comme tout le reste, la situation empire avant de pouvoir s’améliorer.
Quelle place avait le rugby là-bas ?
C’était un élément incontournable de la vie du quartier. Tout le monde aimait jouer. C’était aussi un bon apprentissage pour les enfants. On avait l’habitude de jouer sur le béton, dans la rue.
Mais vous jouiez sans contact ?
Ah non, on se plaquait (rires).
Vous pratiquiez d’autres sports ?
J’ai commencé le rugby sérieusement à 14 ans. Avant, et même après, je me suis intéressé à d’autres sports : le kick-boxing, la boxe, l’athlétisme… Dans ma famille, on donne plutôt dans les sports de combat. L’un de mes cousins entraîne : Ray Sefo, qui a combattu Cyril Abidi et Jérôme Le Banner (deux légendes du K-1 en France, ndlr). C’est chez lui que je m’entraînais. Je ne pensais pas que j’allais devenir un joueur de rugby. Je pensais qu’en grandissant, je finirais boxeur. J’ai même pensé à devenir pro. J’aimais ça et je m’entraînais beaucoup. Je m’en suis d’ailleurs servi pour le rugby, que ce soit mentalement ou physiquement.
Et l’école dans tout ça ?
Vous savez, il existe deux types d’élèves : ceux qui s’assoient au premier rang et ceux qui dorment au dernier. Je dormais (rires). Pourtant, j’étais plutôt pas mauvais à l’école, mais à cause de l’endroit d’où je venais, j’avais appris à ne pas être trop malin. Après, ma mère m’a envoyé dans un internat. J’ai mis beaucoup de temps à m’adapter là-bas. Je n’aimais pas être privé de liberté.
La liberté, comme prendre votre BMX et arpenter tout Auckland avec votre bande…
Je le fais encore, vous savez ! Ça m’a beaucoup manqué. C’était juste la liberté à l’état pur que de monter sur le vélo et aller où je voulais. Mes amis et moi avions l’habitude de pédaler de chez moi jusqu’à la plage, ce qui fait bien quatre ou cinq heures aller-retour. On adorait ça, toute cette liberté, on découvrait le centre-ville d’Auckland. C’était une ville complètement différente. Pendant la journée, les gratte-ciel, et la nuit, l’agitation des boîtes de nuit, des bars, des gens qui se saoulent, qui s’embrouillent, qui se battent, qui se font poignarder. Enfin, c’était comme ça à l’époque, quand j’étais jeune.
Vous avez souvent dit que le rugby vous avait écarté du mauvais chemin. Comment l’expliquez-vous ?
Quand tu découvres le rugby, tu apprends comment te contrôler. Comment contrôler la violence, surtout. Si tu peux contrôler cette violence, tu réussis dans ce que tu fais. Si tu es agressif, sans contrôle, alors tu vas perdre. Dans le rugby comme dans la vie.
Et à quel moment vous prenez conscience d’être un joueur différent des autres ?
Il y a beaucoup de gens qui veulent être les meilleurs. Moi, ce n’était pas ‘je veux être le meilleur’, c’était ‘je veux voir à quel point je suis bon contre les meilleurs’. Et si j’étais assez bon pour les battre, alors j’espère que j’étais le meilleur. C’était juste ma façon de jouer. Je respecte mon adversaire mais je ne le crains jamais.
Tout est allé très vite pour vous. À 19 ans, en 1994, vous débutez et perdez avec les All Blacks contre la France. Vous aviez été très critiqué à l’époque. Il paraît que vous aviez failli signer avec les Sydney Bulldogs en XIII. C’est vrai ?
Je pense que c’était juste parce que j’étais le plus jeune. J’avais l’impression d’avoir été traité de manière injuste. À ce moment-là, j’étais persuadé que je venais de jouer mon dernier match avec la sélection. J’ai commencé par le XIII, et je suis passé à XV en pension. J’ai toujours pensé que j’y retournerais. Mais non, finalement.
Vous avez beaucoup souffert physiquement lors de la longue préparation pour la Coupe du monde 1995. À l’époque, vous aviez déjà des problèmes de rein. Pourquoi n’avoir rien dit ?
Parce que je ne voulais pas susciter la compassion. Je voulais juste être choisi pour mon niveau. Si je suis assez bon pour être dans l’équipe, je suis assez bon pour être dans l’équipe. Si je le ne suis pas, je rentre à la maison.
Dès le premier match contre l’Irlande, vous crevez l’écran en quelques actions. On vous propulse star de la compétition. Cela ne doit pas être facile à gérer à 20 ans.
Pendant la Coupe du monde, je ne lisais pas les journaux, je regardais juste des films, aucune chaîne de télévision. Donc, je ne savais pas ce qui se racontait à l’extérieur sur moi. Je n’en ai jamais eu la moindre idée. Moi, je tenais juste à jouer pour mon pays et mon équipe.
Quand on vous voit marcher sur vos adversaires comme l’Anglais Mike Catt en demi-finale, on a l’impression d’un adulte qui s’amuse avec un enfant. Vous aviez aussi cette sensation de facilité ?
Pour moi, Mike Catt était au bon endroit au mauvais moment. C’est comme ça que je l’explique. Au bon endroit pour moi, mais au mauvais moment pour lui. J’étais en train de trébucher sur cette action. S’il avait été peut-être à deux pas ou même un seul en arrière, j’aurais pu m’effondrer à ses pieds. Mais sa présence à cet endroit précis m’a aidé à retrouver mon équilibre. Je lui en suis reconnaissant à chaque fois que je le vois. Mais nous n’en parlons pas, j’ai trop de respect pour Mike et sa carrière.
Tony Underwood a lui aussi passé un sale moment ce jour-là. Avant le match, il avait expliqué que vous aviez croisé des ailiers faibles et qu’il avait un plan pour vous stopper. Vous étiez décidé à lui répondre sur le terrain ?
Oh oui. J’adore quand quelqu’un essaie de me défier. En fait, le rugby est un sport de combat : apporte ce que t’as de mieux, j’apporte ce que j’ai de mieux, et on verra qui est le meilleur.
Vous étiez un joueur craint pour votre physique, mais vous n’étiez pas trop bagarreur sur un terrain. Vous n’aviez pas besoin de l’être ?
Pour moi, ce n’était pas nécessaire. Le rugby est un jeu magnifique où tu joues selon des règles. Si tu es là pour quoi que ce soit d’autre, comme essayer de blesser ton adversaire, tu ne devrais pas jouer. Qu’est-ce que j’aurais gagné à faire mal à quelqu’un ? J’aurais pu être suspendu et mon équipe se serait retrouvée punie. Pourquoi ? Pour avoir été stupide. Ça ne valait pas le coup.
On dit parfois que l’équipe des Blacks en 1995 était la meilleure qu’on n’ait jamais vue, et pourtant, vous avez perdu en finale contre l’Afrique du Sud. Comment l’expliquez-vous ?
C’est l’essence même du rugby. À quel point vous êtes fort n’a pas d’importance, c’est ce qui se passe pendant 80 minutes qui compte. Mais il faut rendre le respect qu’elles méritent aux équipes qui nous ont battus. Les Français en 1999 et les Sud-Africains quatre ans plus tôt ont bien joué. Je les ai toujours respectés, parce qu’ils arrivaient et jouaient leur jeu pour nous contrer. C’est la beauté du sport, non ? Parfois, tu gagnes, parfois, tu perds. C’est comme la vie.
Après vos quatre essais en demi-finale, les Springboks avaient préparé un plan anti-Lomu. Vous l’aviez tout de suite perçu sur le terrain ?
Je savais qu’ils prévoyaient quelque chose. Mais notre problème, c’est que nous n’avons pas réussi à terminer nos actions. Je prenais des trous, j’ai eu des occasions, mais nous avions des problèmes de finition. Il y a des jours comme ça. Pour moi, le tournant de cette finale arrive quand je reçois le ballon de Walter Little et que je suis arrêté pour une passe en avant. Ce moment-là (il marque une pause)… À mes yeux, il n’y avait pas en-avant. L’arbitre était très loin de l’action donc je ne sais pas comment il a pu le voir. C’est sa décision et tu dois l’accepter. Pour moi, quand on parle de souvenirs douloureux, je pense à ce moment précis. J’ai eu l’occasion de marquer l’essai qui aurait pu faire toute la différence.
Il y a aussi toutes ces rumeurs sur l’empoisonnement dont certains de vos partenaires auraient été victimes…
Dans le fond, ce ne sont que des rumeurs. Nous n’étions juste pas assez bons pour gagner cette finale. Et puis, ce match appartient aux livres d’histoire à présent. Donc, on ne peut plus débattre sur ce sujet. Pour vous dire la vérité, quand je pense à cette défaite en 1995, je me dis que si nous avions gagné, les gens ne se souviendraient pas de cette Coupe du monde. C’était quelque chose de plus grand, de bien plus important que le rugby. C’était un mouvement, une nation, l’Afrique du Sud, qui était en passe de se réconcilier avec elle-même. Les Sud-Africains avaient besoin de ce résultat pour être tous réunis sous un seul drapeau, un président et un capitaine. C’est plus grand que tout. Ce jour-là, nous étions 22 joueurs mais nous affrontions 44 millions de personnes. Lorsque vous vous dites ça, ça veut dire beaucoup. Je ne peux pas parler pour mes coéquipiers, mais pour moi, ça a en quelque sorte apaisé la douleur de la défaite. Peu de joueurs, peu d’équipes peuvent dire qu’ils ont joué un match qui a changé l’histoire d’un pays.
Vous avez pu parler avec Nelson Mandela à cette occasion ?
Je lui ai parlé avant le tournoi, lorsqu’il est venu nous voir. Le plus drôle, c’est quand vous essayez de penser à quelque chose d’intelligent à dire à quelqu’un comme lui et quand il arrive, vous bloquez et dites simplement : ‘Salut, heureux de vous rencontrer.’
L’Australien John Eales a dit que vous avez fait découvrir le rugby au monde entier en 1995. Vous aviez conscience de votre importance ?
J’en avais conscience. C’est difficile de mettre le doigt dessus mais je suppose que c’est ce qui arrive quand vous jouez un type de rugby unique et que les gens aiment regarder. Après, ils veulent en savoir plus, en voir plus. Je trouve ça marrant maintenant que des enfants qui n’étaient même pas nés quand j’ai commencé avec les All Blacks regardent mes vidéos sur YouTube et qu’ils soient là, genre : ‘Wow Jonah !’ C’est un phénomène intéressant la célébrité (rires).
On a aussi l’impression qu’il manque un joueur qui sort du lot comme vous à l’époque pour parler au grand public. Comment l’expliquez-vous ?
Il y a beaucoup de joueurs qui essaient de se projeter, de devenir des superstars, mais ce sont les gens qui décident pour vous. S’ils ne veulent pas faire de vous une superstar, cela n’arrivera jamais. Vous savez, je jouais au rugby parce que j’aimais ça et je pense que les gens l’ont compris, que ce soit avec les All Blacks, Auckland ou Wellington. Je ne sais pas si les jeunes de nos jours jouent pour la passion ou pour la paye. Quand tu vois la passion que les joueurs avaient, comme Serge Blanco après son essai contre l’Australie en 1987, c’était juste de l’émotion à l’état pur. Ces gars avaient cet amour du maillot qu’ils portaient alors qu’ils étaient encore amateurs. Je crois que j’ai eu la chance d’être amateur pendant deux ans puis professionnel pendant le reste de ma carrière. Les jeunes de maintenant n’auront jamais cette chance. Ils ne sauront jamais ce que c’est de jouer juste par passion. À présent, ils ne pensent plus qu’à leur contrat, leur prochain club et tout le reste. Je n’ai rien contre, mais les priorités sont différentes de celles de l’époque.
L’argent serait-il en train de changer la nature profonde du rugby ?
C’est l’évolution logique de ce jeu. Mais cela pourrait être préjudiciable pour certains pays en termes de développement. Quand vous avez un tel afflux d’étrangers dans un pays, vous ne donnez pas leur chance aux joueurs locaux qui vont se retrouver barrés par des internationaux néo-zélandais ou australiens. C’est une histoire compliquée. Il y a des joueurs fantastiques en France, par exemple, mais l’afflux d’étrangers n’aide pas votre rugby. C’est bien pour les clubs et c’est ce que veulent leurs propriétaires, mais la sélection ne dispose plus de ce terreau propice à l’éclosion d’un grand nombre de jeunes. On devrait vraiment trouver une solution pour réguler cela.
Les Français estiment ne pas avoir de grands joueurs au niveau international, d’ailleurs…
Thierry Dusautoir reste un grand leader. Et ce n’est pas le seul. Mince, quel est son nom ? Un demi d’ouverture… Il a été blessé très tôt pendant la finale en 2011. Je l’aime bien. Mince ! Il a été blessé parce qu’il avait plaqué Ma’a Nonu et il s’est assommé.
Morgan Parra ?
Ouais, c’est lui ! Très bon buteur. S’il ne s’était pas blessé, je pense que vous auriez été en mesure de mieux jouer au pied et de gagner le match. J’essaye toujours de m’intéresser au rugby des autres pays. Là, il y a des Samoans qui sont en train de percer mais aussi des Fidjiens. Beaucoup de jeunes sont en train d’éclore, des joueurs très excitants.
Est-ce qu’une de ces équipes peut rêver d’une victoire en Coupe du monde un jour ?
C’est tout à fait possible. Beaucoup de Fidjiens, Tongiens ou Samoans viennent en France. C’est bien pour eux, c’est aussi ce que les clubs veulent et cela profite à ces sélections. Ils sont de plus en plus forts grâce à leur expérience du très haut niveau en Top 14 ou en Coupe d’Europe. Mais encore une fois, je pense que cela contribue à ce que le réservoir des jeunes joueurs français s’amenuise, puisqu’ils disposent de moins de temps de jeu.
En parlant des Français, vous avez réussi à comprendre cette défaite incroyable de 1999 ? Avant la demi-finale, la question était de savoir de combien de points vous alliez gagner.
C’était quasiment un match où chaque équipe a eu sa mi-temps. Si vous regardez bien, je pense qu’il y a quelque chose comme 18 ou 20 minutes avant même que
je touche le ballon en seconde période. Quelle frustration! Nous avons dévié du plan de jeu et les Français ont trouvé un second souffle. C’était l’une de ces fois où rien ne fonctionnait pour nous alors que tout souriait aux Français. Leurs coups de pied atterrissaient où ils voulaient, le ballon rebondissait exactement comme ils en avaient besoin… Mais c’est typique des Français. Quand ils décident d’appuyer sur le bouton, c’est une équipe magique à regarder. J’ai une très grande admiration pour leur style. À la fin du match, je suis resté pour serrer la main de chaque joueur, les féliciter et leur souhaiter bonne chance pour la finale, parce que les Français avaient livré une performance digne d’une finale.
Il n’empêche que le retour en Nouvelle-Zélande a dû être difficile…
Je suis très vite passé à autre chose. Je m’occupais de ce dont je devais m’occuper. Je me suis préparé pour la saison suivante. J’adore juste jouer au rugby, c’était la chose la plus importante pour moi. Je n’ai jamais considéré le rugby comme un travail.
En 2004, on vous transplante un rein. Après cette opération, vous n’avez plus été le joueur dominant de vos jeunes années. Comment avez-vous vécu cette situation et les critiques qui sont allées avec ?
Pour dire la vérité, ça n’a même pas été un problème. Les choses que j’ai dû vivre afin de pouvoir rester en bonne santé de nouveau, je ne pense pas que quelqu’un d’autre aurait réussi à les supporter. C’était un autre type de bataille, de domination. C’était une domination mentale dont j’avais besoin. Je devais être fort mentalement pour être en mesure de dominer les grands démons que représentent la maladie et une greffe de rein. Un jeu différent. Pas seulement un match de rugby, mais un match sur la vie. Je devais juste me préparer mentalement et physiquement pour être en forme et continuer à vivre.
Et maintenant, comment vous sentez-vous avec votre traitement, qui reste très lourd ?
Ça va bien. Aussi bien que ça puisse aller. Je suis toujours en attente d’une greffe de rein, je fais encore des dialyses mais je suis heureux dans mon mariage et j’ai deux enfants que j’aime à en mourir. Qu’est-ce que je peux demander de plus?
Dans le documentaire Le Souffle de la colère, vous expliquez que vous aviez 0,001% de chance d’avoir des enfants à cause de tous vos traitements. Devenir père tient du miracle pour vous ?
À cause de l’un des traitements que je devais suivre, si je voulais avoir des enfants, je devais stocker mon sperme. C’est ce qu’on m’a expliqué à l’époque. Et j’avais effectivement 0,001% de chance d’avoir des enfants à cause de mon nombre de spermatozoïdes selon les statistiques des médecins. J’étais dévasté quand j’ai appris la nouvelle. C’était un sujet dont je devais parler avec ma femme : si elle voulait des enfants, je n’étais pas vraiment la bonne personne… Heureusement, elle pensait le contraire. Nous avons eu Brayley en 2009 et Dhyreille en 2010. Notre plus jeune est né en France, à Marseille. Je suis très heureux. La vie est vraiment bonne avec moi.
Quel souvenir gardez-vous de votre passage à Marseille ? C’était assez improbable pour vous d’évoluer dans un club amateur en Fédérale sur des petits terrains.
Les gens et la ville étaient fantastiques, ainsi que la nourriture. Mais le club n’était tout simplement pas honnête avec moi. Ce n’était même pas à propos des structures ou du niveau. Ils n’ont seulement pas été honnêtes dès le début sur beaucoup de choses, en termes de sécurité pour ma famille notamment. Je ne veux pas en dire plus… Mais avec ma femme, on se dit que si on en avait l’occasion, on retournerait en France demain. Parce que nous avons toujours aimé ce pays. Notre plus jeune fils a 5 ans et continue de nous dire : ‘Je veux retourner à Marseille.’ Il est né là-bas, alors c’est notre petit Français. Il y a beaucoup d’influence française en lui. Par exemple, il aime vraiment le fromage. Je n’ai jamais vu un Tongien qui aimait autant le fromage.
Dernièrement, vous étiez à Salt Lake City. Une ville importante pour vous puisque vous êtes mormon. Vous racontez avoir perdu la foi avant de découvrir cette religion.
C’est une très longue histoire mais la version courte est que ma femme est membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et que je me suis converti. Mais il y a aussi des membres dans ma famille. Je n’ai jamais perdu la foi, je la cherchais juste. J’ai toujours récité des prières avant le match. La religion a toujours occupé une grande place dans ma carrière. C’est jusque que je ne m’étais jamais vraiment engagé dans une seule foi. Je crois en ce que je crois, mais je ne cherche pas à dire à qui ce soit ce qu’il doit faire, ce qui est juste ou pas. C’est un choix très personnel.
Après votre carrière de joueur, vous vous êtes essayé au culturisme. C’était une façon pour vous de combler le vide laissé par le rugby ?
J’ai fait un tas de choses. Du culturisme, de la boxe aussi. C’était juste une question de plaisir, une façon de profiter de la vie. Simplement m’amuser. Mon pote, la vie est trop courte pour être trop sérieux et se laisser retenir par les ‘vous ne devriez pas être ci ou vous ne devriez pas être ça’. Je me suis juste amusé. Pour moi, c’est le plus important. Prendre du plaisir et profiter de mes deux fils.
L’actuel sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, Steve Hansen, estime qu’on n’a jamais pu voir le vrai Lomu à cause de vos problèmes de santé. Et vous, avec le recul, comment jugez-vous votre carrière ?
Je suis définitivement fier. Aussi courte que fut ma carrière, j’en chéris tous les moments. Je suis vraiment heureux d’avoir participé à 63 test matchs. Je ne voudrais rien changer, pas même les défaites. Tout simplement parce que cela m’a fait moi, ça a fait de moi une meilleure personne, mais ça m’a aussi appris beaucoup de choses très utiles sur la vie. Je pense aussi aux grands amis que je me suis faits à travers le monde : Émile Ntamack, Brian O’Driscoll et Ronan O’Gara, Jonny Wilkinson… Ces gars-là, je peux les appeler mes amis. Je me suis aussi fait des amis dans la génération précédente, comme Serge Blanco. C’était l’un de mes héros, je l’admirais en tant que joueur. Philippe Sella aussi, Philippe Saint-André… Je suis très chanceux d’avoir frayé avec ces gars-là, d’avoir joué avec mes pairs, comme Michael Jones, Ian Jones ou Andrew Mehrtens, dans une grande équipe de All Blacks. Je ne changerais rien.
Comme pour toutes les éditions précédentes, les Néo-Zélandais débarquent dans cette Coupe du monde 2015 comme les grands favoris…
On a l’habitude. On a commencé beaucoup de tournois en tant que favoris et on n’a jamais gagné à l’extérieur (les Blacks ont remporté la Coupe du monde 1987 et 2011 devant leur public, ndlr). Je n’aime pas être le favori. Passons déjà la phase de poule et après, j’espère que ce sera un replay entre la Nouvelle-Zélande et la France. Sauf que cette fois, les All Blacks vont gagner, je suppose (rires). En 2011, une équipe de télévision française est venue m’interviewer chez moi. J’ai annoncé une finale avec une victoire d’un point des All Blacks contre la France. Et je crois que j’ai eu raison. Après le match, les journalistes sont venus vers moi en courant et m’ont demandé : ‘Mais comment est-ce que tu savais?’ Comme on jouait à la maison, je savais qu’il y aurait la même finale qu’en 1987, dans le même stade.
Vous avez conscience que Jonah Lomu Rugby est un jeu vidéo culte pour toute une génération ?
Ah oui, bien sûr. C’est drôle parce qu’il est toujours numéro un mondial des ventes de jeux vidéo de rugby. Et j’en suis l’heureux et fier propriétaire. Il a cartonné parce qu’il était vraiment facile à jouer. Tout le monde pouvait s’amuser avec. Vous pouviez même jouer avec votre petite amie. Et puis les commentaires étaient drôles. C’était un succès à l’époque et je trouve qu’il se défend encore.
 www.jonahlomu.com
www.jonahlomu.com
Voir : le film documentaire sur sa vie ici.
Lire : Tampon! #1
Sébastien Pietrasanta : “On doit s’adapter au temps de la guerre tout en préservant notre État de droit’’

On est à un niveau maximal de lutte antiterroriste. Pourtant, on ne peut pas empêcher des évènements comme ceux d’hier de se produire. Pourquoi ?
Nous avons, depuis deux ans maintenant, un dispositif antiterroriste qui a été particulièrement renforcé avec le plan anti-Djihad, avec la loi sur le terrorisme qui date –hasard du calendrier ?– du 13 novembre 2014, et puis encore récemment avec la loi sur le renseignement. À cela s’ajoutent de nouveaux dispositifs qui ont été renforcés et annoncés à la suite des attentats du 11 janvier. Plus de 2 500 agents supplémentaires qui sont en train de renforcer les services de renseignement en France et le déploiement de l’opération Sentinelle. Nous avons une législation forte et des moyens pour les services de renseignement sans commune mesure. Néanmoins, il faut avoir l’honnêteté de le dire aux Français, on peut prendre 100% de précaution comme on le fait, ça ne veut pas dire zéro risque. D’ailleurs, les régimes les plus autoritaires comme la Chine, la Russie ou des pays qui ont des services de renseignement particulièrement bien
dotés, comme Israël ou les États-Unis, avec le Patriot Act qui va très très loin, connaissent quand même des actes terroristes. Donc, oui, nous avons une vigilance absolue face à une menace terroriste qui n’a jamais été aussi forte, mais nous sommes en guerre. Nous avons des victoires, nous avons des attentats qui sont déjoués, ça a été le cas encore récemment à Toulon. Mais nous avons aussi un territoire, des Français, qui seront à nouveau touchés dans les semaines, les mois, voire les années qui viennent.
Très concrètement, pourquoi ne parvient-on pas à empêcher certains individus de passer entre les mailles du filet ?
Il y a aujourd’hui plus de 13 000 agents dans les services de renseignement. Mais on fait face à un défi qui est triple. Le premier défi, c’est celui du nombre. On a 5 000 ressortissants français que l’on sait liés à l’islam radical, dont 2 000 qui sont impliqués directement dans les filières djihadistes irako-syriennes. C’est un chiffre sans précédent. Deuxième défi : la diversité. Aujourd’hui, nous avons 90% des départements qui sont concernés. Ça ne concerne pas que les jeunes issus de l’immigration, des banlieues : on a un quart de convertis, sur quasiment tous les départements ; il y a des femmes, des mineurs. C’est complètement inédit. Donc, aujourd’hui, c’est beaucoup plus difficile pour les services de renseignement à appréhender. Puis, le troisième défi, c’est celui du mode opératoire. Le réseau, comme on a pu le voir hier soir, le passage à l’acte individuel, les techniques et surtout la détermination. Ces gens-là sont prêts à mourir pour leur cause. Là, il y avait des kamikazes. On a aussi l’exemple de la décapitation en Isère. Nous avons atteint un autre stade. Ces gens-là sont déterminés et ce sont des gens intelligents puisqu’ils s’adaptent à nos législations et à nos dispositifs de sécurité.
Il y a eu une arrestation le 5 novembre dernier en Allemagne qui pourrait être liée aux attentats de Paris. La voiture des assaillants était immatriculée en Belgique. C’était un problème qui était soulevé l’été dernier avec les attentats du Thalys : est ce que la coopération entre les différents services de renseignement européens va assez loin ?
Il y a une coopération accrue, notamment avec la Belgique et l’Allemagne. On peut toujours faire mieux et plus. On est également en attente de ce qu’on appelle PNR européen (Passenger Name Record : un fichier regroupant des données à caractère personnel recueillies lors de déplacements en provenance ou à
destination de pays ne faisant pas partie de l’Union européenne, ndlr) qui permettrait de mieux tracer les individus lorsqu’ils prennent l’avion. Mais là aussi, il faut encore renforcer nos dispositifs, notre coopération. Même si elles sont déjà bonnes. Il y a eu des cas précédents. Évidemment, un Espagnol qui est fiché risque de venir en France mais, évidemment, il y a une coopération entre les services de renseignement espagnol et français. L’enjeu dépasse celui de la France. Il faut une réponse européenne et internationale. Et cette réponse, elle doit se traduire par une intensification des frappes sur Daech, en Syrie et en Irak.
Pour la suite, peut-on imaginer une stratégie plus « offensive » en termes de surveillance des individus déjà fichés ? Laurent Wauquiez disait ce matin (hier, ndlr) qu’il voulait que les 4 000 personnes vivant sur le territoire français et fichées pour terrorisme soient placées dans des « centres d’internement antiterroristes spécifiquement dédiés ».
D’abord, la loi sur le renseignement permet d’accroître considérablement les techniques de renseignement. Ça a été beaucoup critiqué à l’époque, on a parlé de surveillance massive sur Internet. On n’en est pas à la surveillance massive mais cette loi va effectivement permettre de détecter les comportements suspects sur Internet. Ça, c’est déjà une première étape. Il y a eu d’autres techniques de renseignement, comme la sonorisation d’un certain nombre de lieux comme les voitures ou les appartements qui pourra être effectuée. Après, l’émotion elle est
légitime. Mais je ne voudrais pas qu’on soit dans le concours Lépine de celui qui fait la proposition la plus…qu’on soit dans la surenchère. On est dans un État de droit. Et il n’y aurait rien de pire que la France perde ses valeurs. Concernant ces centres de rétention (dont parle Wauquiez, ndlr), l’idée peut être séduisante de prime abord mais elle ne correspond à rien. Les individus qui rentrent de Syrie, il ne faut pas croire qu’ils sont tous laissés en liberté. Dans 99% des cas, ils sont emprisonnés, ils sont en préventive jusqu’à ce qu’ils soient jugés. Donc, si on a des individus qui sont fichés S et qui ne sont pas en prison, c’est qu’ils sont à surveiller mais qu’ils n’ont rien commis. Et ça, c’est toute la question dans laquelle on est. Aujourd’hui, avoir des idées religieuses radicales n’est pas répréhensible si on ne fait pas d’apologie du terrorisme.
L’ancien juge antiterroriste Marc Trévidic considère que les pouvoirs publics n’ont pas les moyens de faire face à l’explosion du terrorisme et qu’il faudra sans doute attendre deux ou trois ans pour qu’elle soit à niveau par rapport à l’ampleur de la menace.
Évidemment, quand on voit les évènements du 13 novembre, c’est un échec collectif. Après, je ne sais pas dans quel état sera la France dans deux ou trois ans. Il faut former un certain nombre d’individus dans les services de renseignement. Ça peut prendre du temps. Il faut aussi embaucher un certain nombre de spécialistes. Je sais qu’il y a eu des annonces de recrutement qui ont été faites. Donc, on monte en puissance. Mais le temps de la démocratie n’est pas celui du temps de guerre. Et aujourd’hui, on doit s’adapter au temps de la guerre tout en préservant notre État de droit.
La crème de la crème

On s’excuse auprès des poteaux qu’on bouscule.
On se fait toujours servir en dernier quand le bar de la boîte est bondé.
Dans le vestiaire aussi, tout le monde nous double.
On répond « et que les tiennes durent toujours » après un « à tes amours ».
On donne rendez-vous à notre pote en bas de chez lui.
Nos parents écoutaient les Beatles et Alain Souchon.
On a donné de l’argent à Wikipédia. Et à Greenpeace. Et aux pompiers.
On n’a jamais publié les commentaires “Mais ferme un peu ta gueule” qu’on avait commencé à écrire sous les statuts idiots de nos amis Facebook.
On connaît les problèmes de tous nos collègues, ils viennent à notre bureau nous les raconter en détails.
Quand on s’énerve, on fait peur à tout le monde.
Mais dix minutes plus tard, on revient s’excuser.
Et la nuit qui suit, on dort mal.
Nos potes doivent se dire qu’on aime bien les cadeaux de merde.
On a participé à la cagnotte pour l’anniversaire de Sylvie de la compta alors qu’on peut pas la blairer.
On est de tous les déménagements.
On est de tous les rangements les lendemains de soirée.
On répond régulièrement “Merci, vous aussi” à la serveuse qui nous souhaite bon appétit.
Et quand elle revient pour savoir si on prendra des desserts et que tous nos potes font non de la tête avec une tête de gens rassasiés, bon bah on fait pareil. Tant pis pour les profiteroles.
On n’a jamais osé mettre de pancarte “Sorry we’re closed” sur la porte de notre chambre.
On ne dit rien quand les gens nous passent devant dans la file d’attente.
Parfois, on écrit “ahahah” alors que c’était pas si drôle.
La première fois qu’on a vu nos beaux-parents, ils avaient fait de la paella. On a dit que c’était très bon alors qu’on déteste ça. Ça fait quatre ans qu’ils font de la paella à chaque fois qu’on va chez eux, pour nous faire plaisir.
On a passé la moitié de notre vie à culpabiliser.
On propose aux témoins de Jéhovah d’entrer boire un café.
C’est beaucoup trop court mais le coiffeur est sympa, alors quand il nous demande si “ça va comme ça”, on dit oui. Quand il nous propose un shampooing à 20 euros, on dit oui aussi. Et on laisse un pourboire.
Quand on était petit(e), on invitait quand même à notre anniversaire ceux qui ne nous avaient pas invité(e) au leur.
On s’est fait virer de la boîte où on était videur parce qu’on faisait rentrer tout le monde.
On dit “allez oui, c’est d’accord” quand le boucher nous met pour 1,4 kilo de rôti alors qu’on a demandé 800 grammes.
On n’arrive pas à avoir des plans cul. On a des copines.
Une fois, on est allé(e) acheter une paire de baskets chez Foot Locker. On est reparti(e) avec une paire de baskets, un produit nettoyant, une bombe imperméabilisante, un chiffon en poil doux de chamois, deux paires de semelles et un chausse-pied.
On est incapable de vendre nos vieilles affaires sur LeBonCoin, on a l’impression d’arnaquer les gens.
On sait rire sur commande.
“Comment ça les heures supp sont payées ???”
On like les messages d’anniversaire de tout le monde sur notre wall, même de ceux qui disent “happy !” ou “bonne annif miss”.
On achète beaucoup de chewing-gums mais on en mange assez peu.
On n’a jamais pris l’avion mais qu’est-ce qu’on connaît bien le dépose-minute de l’aéroport !
On a souvent perdu sciemment.
Quand au menu, c’est poulet rôti, on se retrouve toujours avec le haut de cuisse.
Peu importe qu’on ne comprenne rien à l’informatique et qu’on déteste Sylvie, on va quand même passer la nuit sur des forums pour lui installer sa suite Adobe crackée.
“Non mais je vais pas te laisser devant une station de métro quand même. Et puis ces embouteillages vont bien finir par se résorber.”
D’ailleurs, sur Blablacar, on a coché “je me plierai en quatre” dans l’onglet Détours.
On s’excuse toujours d’être bourré en taxi.
On ne dit pas “de rien” mais “il n’y a pas de quoi, tout le plaisir était pour moi”.
On est fan des Dieux du Stade et de Clara Morgane mais on a quand même un calendrier des éboueurs et un autre de La Poste, au cas où.
On a acheté huit des dix carnets de tombola de notre neveu. C’est pour l’école.
On s’est déjà auto-vouvoyé en se croisant par hasard dans une glace.
Quand on demande “une baguette pas trop cuite s’il vous plaît”, on dit quand même “merci, bonne journée, au revoir” à cette ordure de boulangère qui a volontairement choisi la plus rousse.
Elle avait pourtant promis qu’elle offrirait les cafés parce qu’elle s’était trompée dans notre commande… Tant pis, pourboire.
On insiste quand l’autre dit « non c’est pour moi » à la fin d’un restau.
Et aussi quand l’autre dit “c’est pas toi, c’est moi” à la fin d’une histoire.
On regarde vraiment les premiers courts-métrages de nos amis.
On tient la porte à l’entrée du métro. Genre longtemps avant.
On se sent toujours obligé(e) d’inventer des excuses extraordinaires au moment de mettre un plan à quelqu’un.
D’ailleurs demain, il faut qu’on aille acheter une plante et en fait c’est relou parce que c’est une plante rare et lourde, ça va nous prendre toute la journée mais on préfère quand même y aller seul(e), t’inquiète.
On laisse notre place de bus à des gens qui ne sont ni vieux ni handicapés.
On fait le ménage à la fin de notre soirée d’anniversaire surprise.
On laisse notre ex inviter nos amis pour le Nouvel An.
On est celui (celle) qui finit par baisser les yeux.